Histoire - Page 63
-
KTO : comment évangéliser ? loin des slogans, les leçons de l’histoire missionnaire
Lien permanent Catégories : Culture, Eglise, Enseignement - Education, Foi, Histoire, Idées, Patrimoine religieux, Religions, Société, Spiritualité, Témoignages 1 commentaire -
La fin de la chrétienté (Chantal Delsol)
De la Chaîne officielle TVLibertés :
La philosophe, Chantal Delsol, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vient de publier un essai décapant : "La fin de la chrétienté". Elle met ici en évidence le processus plusieurs fois séculaire qui a conduit à la disparition quasi complète de ce qui fut la civilisation chrétienne, par nature difficilement conciliable avec la modernité. Ou l'impossible conciliation entre "l'emprise légitime de l'Eglise sur la société si elle veut accomplir sa mission apostolique" et la conception moderne de la liberté. Chantal Delsol est interrogée par Jean-Pierre Maugendre.
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Foi, Histoire, Livres - Publications, Société 0 commentaire -
Ce que disent aujourd'hui les amis de la Russie en France
Enquête En France, certains politiques, universitaires et religieux défendent depuis longtemps la Russie de Vladimir Poutine. La Croix a voulu savoir si leurs discours avaient changé depuis l’agression militaire de l’Ukraine le 24 février 2022.
Condamner la guerre en Ukraine, sans renier ses liens passés, c’est l’exercice d’équilibre auquel se livre l’évêque de Bayonne, Mgr Marc Aillet, sur Radio Présence le 21 mars 2022. « Je n’ai pas une perception autorisée de cette guerre, commence l’évêque, prudent. Je suis au courant par les médias qui relaient un certain nombre d’images, un certain nombre d’analyses, de tractations, et je n’ai pas assez de recul pour comprendre ce qui se passe… » Vraiment, près d’un mois après le début des opérations russes ? L’évêque de Bayonne, qui n’a pas souhaité répondre à La Croix, s’était rendu à Moscou en avril 2014 à la tête d’une petite délégation de catholiques soucieux de la « protection de la morale chrétienne ».
→ RELIRE. Mgr Aillet explique les raisons de son voyage d’études en Russie
Vladimir Poutine, alors en mal de soutiens internationaux, venait d’envahir la Crimée et commençait à discrètement armer les milices indépendantistes du Donbass. Huit ans plus tard, la Russie – « l’un des rares pays du monde chrétien engagé sur la protection des lois naturelles du développement de la personne humaine », selon la délégation – est violemment sortie de l’ambiguïté. Mais sur Radio Présence, pas de condamnation explicite de l’agression russe. Mgr Aillet regrette seulement «l’impact (des combats) sur les sociétés civiles ».
« La Russie reste sur une voie intéressante »
À quelques exceptions près, les élites prorusses françaises contactées par La Croix n’ont pas changé de discours depuis le 24 février. Elles font simplement le gros dos en attendant une résolution du conflit, ou à défaut une accalmie. Oui, reconnaissent-elles, la guerre en Ukraine est tragique, mais les bombardements ne sauraient invalider leurs thèses. «On regrette que des gens meurent, affirme Alain Escada, président de l’association intégriste Civitas, mais avec ses efforts de redressement de la politique familiale et de la christianisation, la Russie reste sur une voie intéressante. »
« La guerre a rendu très peu audibles nos idées de rapprochements, mais je me projette sur le temps long, anticipe l’avocat médiatique Pierre Gentillet, fondateur du cercle Pouchkine. On a intérêt à discuter avec la Russie et ça reste légitime. » « On jugera plus tard, Poutine a peut-être des infos qu’on n’a pas », imagine le parlementaire RN Thierry Mariani. « Tout le problème, ce sont les États-Unis », pense, comme avant le conflit, le juriste Philippe Arnon, rédacteur pour le site Boulevard Voltaire. L’extrême droite à l’unisson.
« L’invasion de Kiev, c’est un mythe »
La perception de la Russie, globalement méconnue en France, a toujours été pétrie de préjugés, explique l’historien Yves Hamant, spécialiste en études russes et soviétiques : «Pour beaucoup de Français, la Russie est une espèce de page blanche sur laquelle on peut écrire ce que l’on veut. À l’époque de la guerre froide, c’est “le paradis du prolétariat”. Aujourd’hui, certains catholiques la voient comme “la citadelle de la chrétienté”. Plus largement, à droite, on y projette des valeurs romantiques un peu kitsch : c’est “la Sainte Russie”, “l’âme russe”, “l’âme slave”… »
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Histoire, Idées, International, Politique 0 commentaire -
L'unité de l'Eglise catholique serait menacée
Du site d'Ouest France ( François VERCELLETTO) :
28 mars 2022
ENTRETIEN. Jean-Louis Schlegel : « L’unité de l’Église catholique est menacée »
Le sociologue des religions, ancien directeur de la rédaction d’Esprit, Jean-Louis Schlegel analyse les raisons de la crise qui affecte une institution menacée, selon lui, « d’implosion », alors que le pape François fait l’objet de critiques virulentes de la part des courants traditionalistes. Entretien.
Le catholicisme traverse une crise grave, quels en sont les symptômes ?
En France et ailleurs en Europe, fût-ce à un degré moindre, on constate d’abord une baisse généralisée de la pratique religieuse. La pratique dominicale – en principe obligatoire ! – est aujourd’hui inférieure à 2 %. Tous les autres « signaux sacramentels » – baptêmes, confirmations, mariages –, mais aussi les inscriptions au catéchisme, les professions de foi, et même les enterrements religieux sont au rouge. Les vocations sacerdotales restent à l’étiage d’une centaine d’ordinations par an (pour 800 décédés ou partis), dont un quart issu de communautés « traditionnelles », comme la communauté Saint-Martin ou d’autres. Et il y a deux ans, une enquête de l’Ifop a montré que moins de 50 % des Français croyaient en Dieu.
Mais ce tableau concerne les pays occidentaux. Il n’y a jamais eu autant de catholiques dans le monde…
Oui, les statistiques publiées chaque année par le Vatican sont à la hausse, notamment pour le nombre de prêtres dans certaines régions du monde, comme l’Asie (l’Inde surtout) et l’Afrique. Mais dès que la modernité démocratique avec ses libertés et son individualisme consumériste s’impose, comme en Pologne ou en Croatie, les chiffres sont en baisse. Et si on y regarde de plus près, on voit de fortes disparités : les religieuses dites actives, par exemple, sont en net recul, en Afrique entre autres. Faut-il s’en étonner ?
Cette tendance s’est-elle accélérée après les révélations sur les crimes sexuels ?
Ce qui a fait vraiment vaciller l’Église, plus que tout le reste, c’est depuis trente ans la révélation des abus sexuels et spirituels « systémiques » de toutes sortes. Et nous ne sommes qu’au début des enquêtes sérieuses par pays. On n’a encore rien vu pour l’Italie ou pour l’Espagne, grands pays catholiques, peu pour la Pologne… Et qu’apprendront des enquêtes en Afrique, en Asie, en Amérique latine ? On peut s’attendre à des choses extrêmement attristantes.
François, élu en mars 2013, avait soulevé beaucoup d’espoirs. Or, il est très violemment contesté…
Oui, presque de suite, de la part de courants traditionalistes. Des attaques aussi contre sa personne, d’une ampleur et d’une violence inégalées. Peut-être plus que Jean-Paul II, Benoît XVI était le pape « selon leur cœur », et faire son deuil au profit d’un pape en rupture sur tout avec Benoît dépassait leurs capacités d’accueillir le nouveau. Il faut dire aussi que contrairement à Benoît, François a pris acte que les discussions pour les ramener dans le « giron » de l’Église du concile Vatican II ne servaient à rien. En revenant, l’été dernier, sur les facilitées accordées par son prédécesseur pour l’usage des rites anciens – la messe en latin pour simplifier –, François a mis fin à une fiction, et le feu aux poudres.
Le différend dépasse la question du latin…
Bien sûr. François est inquiet pour l’unité de l’Église. Il a constaté que la permission des rites anciens n’a pas servi à réconcilier, mais a au contraire renforcé la création d’une Église parallèle, traditionaliste, opposée au concile.
Quels sont les principaux reproches des « tradis » vis-à-vis du pape ?
Ils se présentent comme des fidèles exemplaires de la règle de foi et des exigences morales de « l’Église de toujours », contrairement aux conciliaires libéraux, qui, selon eux, « en prennent et en laissent ». Pour les « tradis », c’est la loi de Dieu et de l’Église qui « tient » les sociétés. Sinon, c’est l’anarchie. Ils se retrouvent donc sur la ligne de Jean Paul II, opposés à toutes les législations qui « permettent » (la pilule, l’IVG, le divorce, la PMA, la recherche sur les embryons…). Ne parlons pas du mariage gay !
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine, Eglise, Ethique, Foi, Histoire, Patrimoine religieux, Religions, Société, Théologie 5 commentaires -
Écoutez cette soliste chanter un « Kyrie » ukrainien du XVe siècle
Publié sur le site web « aleteia » par J-P Mauro :
Enregistré il y a quelques jours par deux jeunes chrétiens orthodoxes de Lettonie, ce “Kyrie” ukrainien date du XVe siècle. Écoutez cette prière qui élève les âmes, en ces temps de détresse et de guerre.
Dans une vidéo postée sur Facebook, la soliste Aleksandra Špicberga interprète avec un ami une magnifique version ukrainienne d’un “Kyrie eleison” datant du XVe siècle. Une façon de rendre hommage à tout un peuple qui souffre et de prier pour lui.
Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Culture, Eglise, Histoire, International, Jeunes, liturgie, Patrimoine religieux, Religions, Spiritualité, Témoignages 1 commentaire -
Les évêques de France, la persécution des juifs et le Vatican
De Limore Yagil, docteur en histoire contemporaine, sur le site de la Revue Catholica :
L’Église de France, la persécution des juifs et le Vatican (1940-1944)
22 mars 2022
La grande majorité de l’Église de France, surtout la hiérarchie épiscopale, accueillit avec enthousiasme et espoir les propositions de « rénovation nationale » énoncées par le maréchal Pétain, chef du gouvernement de Vichy. Dès le lendemain de sa constitution, le nouveau régime édicta quelques décrets qui laissaient clairement présager ses intentions concernant les juifs. La hiérarchie catholique, à quelques exceptions près, n’a pas encouragé l’antisémitisme officiel du régime de Vichy. Par tradition, l’Église affirme que l’obéissance à l’autorité est pour les fidèles une obligation de conscience. Si la majorité des évêques ont été concrètement fidèles à Pétain, certains ont distingué entre la légitimité de l’État et la validité de sa législation, et encouragé leurs fidèles, en particulier les religieuses et les prêtres de leurs diocèses, à agir pour secourir des juifs, et ceci bien avant l’été 1942. Face aux rafles des juifs en été 1942, six évêques ont riposté publiquement, chacun avec un style différent.
Ce qui est intéressant, c’est que d’autres prélats restés silencieux ne sont pas restés passifs dans leur diocèse. « Les évêques avaient su maintenir intactes les exigences de la conscience chrétienne sur les enjeux fondamentaux concernant la personne humaine et notamment la persécution antisémite », a précisé le cardinal Lustiger[1].
-
Terres de Mission : La vie de saint Pierre
L’historien spécialiste de la papauté, Christophe Dickès, présente son dernier livre sur l’apôtre Pierre. Un ouvrage d’érudition dans lequel il emprunte une voie multidisciplinaire pour mieux comprendre la vie du premier des évêques de Rome. “Saint Pierre – L’évidence et le mystère”, est d’ores et déjà une référence en la matière et semble constituer un incontournable de l’Histoire de l’Eglise.
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Eglise, Foi, Histoire, Livres - Publications, Médias 0 commentaire -
Une consécration "en communion avec tous les évêques"
D'Anita Bourdin sur zenit.org :
« En communion avec tous les évêques », la consécration de la Russie et de l’Ukraine
Et même en communion avec tout le Peuple de Dieu
C’est ce qu’annonce le directeur de la Salle de presse du Saint Siège, Matteo Bruni, dans ce communiqué en italien de ce 18 mars, en réponse aux questions de la presse: « Le Pape François a invité les évêques du monde entier et leurs prêtres à se joindre à lui pour prier pour la paix et pour consacrer et confier la Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie. »Appel à toutes les communautés diocésaines
La prière de consécration sera donc faite par tous les évêques en communion avec le pape François, comme le fera son envoyé à Fatima, le cardinal polonais Konrad Krajewski, aumônier apostolique, comme le Saint-Siège l’a indiqué mardi dernier, 15 mars.
Plus encore, c’est toute l’Eglise que le pape a invitée à prier cette prière avec lui, après l’angélus du 13 mars, en disant: « Je demande à toutes les communautés diocésaines et religieuses de multiplier les moments de prière pour la paix. »
En présence de quelque 25 000 personnes, le pape en a appelé « au nom de Dieu » à l’arrêt « des bombardements et des attaques », dénonçant avec vigueur une « inacceptable agression armée » en Ukraine, une « guerre atroce », un « massacre », une « barbarie », une « profanation du Nom de Dieu » et le « martyre » de la ville de Marioupol.
On se souvient aussi que le pape avait déjà invoqué Marie Reine de la paix, à l’audience du mercredi 23 février, à la veille de l’invasion russe en Ukraine, demandant à tous une journée de prière et de jeûne pour la paix en Ukraine le mercredi 2 mars, Mercredi des Cendres : « Que la Reine de la Paix préserve le monde de la folie de la guerre. »
Le pape François a renouvelé cette consécration et la renouvellera
Au début de son pontificat, le pape François a renouvelé la consécration de toute l’humanité au Coeur de Marie de façon très sobre – c’est son style – par une prière, place Saint-Pierre, devant la statue de Notre Dame de Fatima, le dimanche 13 octobre 2013, au terme de la messe. C’était une « Journée mariale » organisée dans le cadre de l’Année de la foi.
Rappelons aussi que dès le 13 mai 2013, le pape François, qui a canonisé les pastoureaux à Fatima, à l’occasion du centenaire des apparitions, en 2017, avait fait consacrer son pontificat a la Vierge de Fatima, par le cardinal patriarche de Lisbonne, José da Cruz Policarpo.
Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Histoire, International, Politique, Spiritualité 1 commentaire -
La parution, en français, du 1er tome de la biographie de Benoît XVI par Peter Seewald
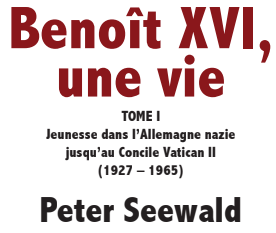
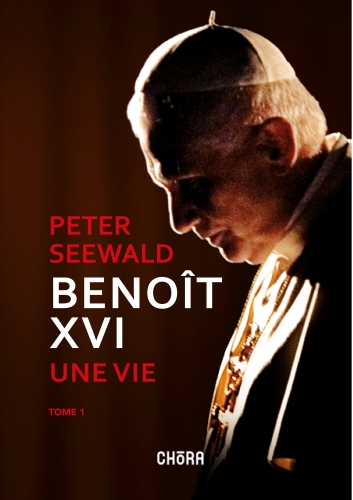
THÈMES du tome I
• La jeunesse de Joseph Ratzinger.
• La Seconde Guerre mondiale en Allemagne.
• Ses débuts en tant que prêtre et professeur de théologie.
• Le Concile Vatican II.POINTS FORTS
• La biographie définitive d’un géant de notre époque.
• Un best-seller international.
• Une biographie complète et très documentée.
• 16 pages de photos.« Mon impulsion fondamentale était de dégager le véritable noyau de la foi sous les couches sclérosées et de donner force et dynamisme à ce noyau. Cette impulsion est la constante de ma vie. » Benoît XVI
LE LIVRE
Dans le nouvel ouvrage définitif et monumental sur Benoît XVI, son biographe Peter Seewald a découvert des éléments nouveaux sur la vie et le caractère du pape émérite, et notamment son rôle dans le Concile Vatican II, « extrêmement important ». Le visage de Benoît XVI nous est révélé dans ces lignes très bien documentées, laissant entrevoir enfin l’humanité d’un homme qui aura marqué notre siècle. La voix de Peter Seewald se fait entendre, sa biographie tend à transmettre au lecteur la vérité de ce que lui-même a découvert à travers toutes ces heures passées à récolter minutieusement les témoignages et anecdotes sur ce grand théologien.
ISBN : 9788831414142 - Format : 220x145 mm - Pages : 592 - Prix : 24,80 €
L’AUTEUR
Peter Seewald, né en 1954 en Bavière, à Bochum, est un écrivain et journaliste allemand. Il est rédacteur en chef du journal « Der Spiegel », puis journaliste pour le journal « Stern », il travaille ensuite pour la revue « Süddeutsche Zeitung ». Il vit et travaille à Munich (Bavière). En 1993, son journal l’envoie auprès du cardinal Ratzinger. Écrivain et confident pendant plus de 25 ans, il noue une relation privilégiée avec Joseph Ratzinger. De leurs entretiens sont nés plusieurs ouvrages : Le Sel de la terre (1996), Dieu le monde (2000), Lumière du monde (2010) et Dernières conversations (2016), tous traduits en plusieurs langues et aujourd’hui devenus best-sellers.
QUELQUES MOTS DE L’AUTEUR
« Il existe aujourd’hui une multitude de livres sur Benoît XVI, mais aucun n’a montré la biographie de Ratzinger et son enseignement en rapport avec les événements historiques. Une vie essaie de raconter la vie, l’œuvre et la personne du pape allemand d’une manière passionnante car elle correspond à sa vie, dans tout son drame et son importance pour l’histoire de l’Église et du monde.
À cette fin, j’ai effectué des recherches approfondies, analysé des archives et mené des conversations avec une centaine de témoins contemporains. Enfin, le pape Benoît XVI s’est mis à disposition pour ce projet lors d’innombrables rencontres.
On a toujours pensé que l’ascension de l’ancien professeur de théologie était une progression sans heurts, une carrière sans faille. Mais les hauts et les bas sont nombreux, avec des drames qui l’ont conduit au bord de l’échec [...] Et ce n’est pas par hasard qu’il est considéré dans le monde entier comme l’un des grands penseurs de notre époque.
Son travail est important et sa vie passionnante. En outre, la biographie, avec son contexte historique contemporain, n’est pas seulement un voyage spirituel et historique à travers un siècle captivant et dramatique ; elle montre également les leçons à tirer de toutes ces décennies et les réponses de pointe qu’elles apportent à la crise actuelle de la foi et de l’Église en Occident. »,
Peter Seewald
LA PRESSE INTERNATIONALE EN PARLE
« L’intérêt qu’il suscite est dû à son exhaustivité, à une richesse d’informations et de détails inédits, qui est aussi le résultat du dialogue habituel et continu de Seewald avec Benoît. » Francesco Macri, dans le quotidien italien « Corriere della Sera » du 17 décembre 2020.
« Une vie est l’encyclopédie de la vie de Benoît XVI. La figure du pape émérite est un pont entre notre époque et le XXe siècle. » Cezary Kościelniak, département d’Anthropologie et d’Études culturelles, Université Adam Mickiewicz, Poznan, Poland.
« Le récit de la jeunesse dans une famille de condition très modeste et d’une foi catholique profonde, qui a conduit les deux frères Ratzinger à entrer au séminaire, est passionnant. Le contexte est celui de la campagne bavaroise des années 1930, alors que le régime nazi devient oppressif, conduisant à l’extermination des juifs d’Europe et à la guerre. La reconstitution de Seewald suit méticuleusement, dans les dures années d’après-guerre, la formation du jeune clerc. » Giovanni Maria Vian, dans le journal italien « Vita e pensiero » du 21 novembre 2020.
« Benoît XVI est généralement considéré par les catholiques libéraux – à tort, je pense – comme l’inverse du gentil et empathique pape François. Vous vous souvenez du film Les deux papes qui juxtaposait un Anthony Hopkins constipé sur le plan émotionnel, dans le rôle de Benoît XVI, à son successeur chaleureux et amateur de football ? Ce livre montre un Joseph Ratzinger très différent : un garçon timide, intelligent et sensible qui est devenu un théologien profondément doué et qui a eu une formidable influence libéralisatrice lors du Concile Vatican II. » Melanie McDonagh, dans le magazine britannique « the Oldie ».
Chora est une maison d’édition qui explore les domaines culturels, scientifiques, spirituels et philosophiques. Les publications variées s’inscrivent au cœur des questionnements et des débats contemporains, et s’engagent à promouvoir une culture de la Beauté et de l’Espérance.
«LA VIE DE JOSEPH RATZINGER EST LA BIOGRAPHIE D’UN SIÈCLE.» Peter Seewald
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Eglise, Foi, Histoire, Livres - Publications, Spiritualité, Témoignages, Théologie 0 commentaire -
Arménie-Haut-Karabakh : un peuple chrétien-martyr abandonné par ses coreligionnaires occidentaux…
D'Alexandre Del Valle sur Atlantico.fr :
Arménie-Haut-Karabakh : la destinée douloureuse d’un peuple chrétien-martyr abandonné par ses coreligionnaires occidentaux…
Cette semaine, Alexandre del Valle s’est entretenu avec Tigrane Yégavian, chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R), membre du comité de rédaction de la revue Conflits, spécialiste du Caucase, qui vient de faire paraître un ouvrage passionnant et très instructif sur la Géopolitique de l’Arménie*, particulièrement marqué par un réalisme et une grande lucidité sur les liens entre politique interne, géopolitique et diplomatie.
14 mars 2022
Tigrane Yégavian nous a donné des clefs de décryptage du conflit du Haut-Karabakh, qui a sévi un an avant la guerre ukrainienne et qui s’est conclu par la victoire des agresseurs turco-azéris en novembre 2020. Il nous explique aussi les liens qui peuvent établis entre les dossiers russo-ukrainien et azéro-turco-arménien, deux conflits de l’espace post-soviétique où le rôle de la Russie demeure souvent imprévisible, comme celui de la Turquie d’Erdogan et de la dictature pétro-gazière azérie, entre lesquelles les Arméniens du Caucase sont pris en tenailles, avec comme seul protecteur relatif mais récurrent, la Russie.
Avant d’aborder le thème du terrible conflit arménien qui a fait souvent couler du sang depuis les années 1990, sans même parler du terrible génocide des années 1896-2015, et sachant que vous établissez à plusieurs reprises des liens entre les deux théâtres dans votre livre, expliquez-nous en quoi la guerre en Ukraine va avoir un impact sur l’Arménie ?
Ayant scellé son destin à celui de la Russie, l’Arménie va se retrouver davantage fragilisée car elle ne dispose d’aucun levier, ni de moyens de diversifier ses alliances. La diplomatie arménienne a opté jusqu’à présent pour une attitude de prudence, affichant une neutralité totale afin de privilégier un règlement diplomatique. Le jour du déclenchement de la guerre (24 février 2022), on apprenait la démission du chef d’état- major de l’armée arménienne et la convocation à Moscou du ministère de la Défense. Cette guerre en Ukraine donne l’occasion à l’Azerbaïdjan de bomber le torse et de négocier des livraisons de gaz aux Européens en alternative à celui que la Russie ne livrera pas. L’Ukraine a choisi son camp, celui de l’OTAN et de la Turquie, mais aussi celui de l’Azerbaïdjan. Les Arméniens de leur côté, n’oublient pas que pendant la guerre de l’automne 2020, ce sont des bombes au phosphore made in Ukraine qui avaient causés des ravages auprès des soldats et des forêts de l’Artsakh…
Lire la suite sur Atlantico ou ICI
*Tigrane Yégavian, Géopolitique de l’Arménie, Editions Biblimonde, Préface de Gérard Challiand, Paris, 2022.
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Histoire, International, Livres - Publications, Politique, Solidarité 0 commentaire -
Les conservateurs pro-Poutine sont victimes d'une erreur culturelle
Des propos recueillis par Nico Spuntoni sur la nuova Bussola Quotidiana :
Les conservateurs pro-Poutine sont victimes d'une erreur culturelle
14-03-2022
L'historien britannique Tim Stanley, chroniqueur au Telegraph, explique à la NBQ pourquoi l'idée d'une Russie post-soviétique comme rempart chrétien contre un Occident sécularisé n'a jamais été vraie : "Poutine a essayé de restaurer la Russie telle qu'elle était vers 1900". Mais en même temps, il est faux de penser que l'Ukraine se bat au nom de la démocratie : "La vérité est qu'ils se battent pour leurs maisons, leurs terres et leurs familles".
"Qu'est-il arrivé à la tradition ? History, Belonging and the Future of the West", publié en 2021 par Bloomsbury, est un texte qui mérite d'être lu pour s'orienter dans le monde du conservatisme mondial qui se remet de l'effet de la pandémie et de la gueule de bois Brexit-Trump. Son auteur Tim Stanley, historien et chroniqueur au "Telegraph", de confession catholique, s'est également attardé - avec un regard critique - sur la restauration de Poutine qui a également impliqué directement l'Église orthodoxe russe.
L'image d'une Russie post-soviétique et post-eltsinienne comme rempart du christianisme face à un Occident de plus en plus sécularisé a eu un certain succès dans le monde conservateur. Mais, est-ce encore acceptable après l'éclatement de la crise ukrainienne ? En réalité, pour Tim Stanley, cela n'a jamais été vrai et il explique ses raisons dans cet entretien avec la Nuova Bussola Quotidiana.
Lorsque vous avez parlé de la symphonie de l'Eglise et de l'Etat en Russie, vous avez écrit : "lorsque la foi et la nation deviennent synonymes, il y a un risque que la foi devienne un label d'identité plutôt qu'un système de croyance vécu". Craignez-vous que cela ne devienne la motivation idéale pour une offensive militaire en Ukraine ?
Il y a deux points de vue sur la foi et l'invasion. L'une consiste à dire que Poutine, contraint d'agir en raison de la menace d'expansion de l'OTAN, est le défenseur de la civilisation orthodoxe, qu'il prend des mesures pour unir un peuple divisé et pour tenir tête au sécularisme occidental agressif. Je ne sais pas combien de Russes pensent réellement cela, car il est difficile de distinguer la propagande du Kremlin du sentiment populaire. L'autre opinion est que les actions de Poutine sont l'antithèse même du christianisme : violence, intimidation, massacre des innocents. Nous assistons donc à un conflit classique entre la foi en tant qu'identité ethnique/politique et la foi en tant qu'ensemble de croyances spirituelles qui devraient réellement transcender l'ethnicité. Ce dilemme est partout. À un certain niveau, je suis moi aussi nationaliste : j'aime mon pays et je veux le voir gagner, et je veux protéger son caractère chrétien distinctif contre les civilisations concurrentes. D'un autre côté, ma foi est universelle : lorsqu'une partie de l'église humaine souffre, qu'il s'agisse d'orthodoxes à Kharkiv ou de musulmans à Alep, tout le corps hurle de douleur.
Vous avez lancé un appel aux conservateurs il y a plus d'un an : ne tombez pas dans le piège de penser que Poutine mène une contre-révolution culturelle. Pensez-vous que la fascination des conservateurs pour Poutine survivra à cette guerre ?
Presque personne en Occident, à droite ou à gauche, n'a déclaré que l'invasion de Poutine était moralement légitime. Tucker Carlson et quelques-uns de la droite américaine disent que "ce n'est pas notre affaire", sans doute parce qu'ils s'arrachent la loyauté de l'électeur moyen de Trump - mais ce faisant, ils se trompent en réalité sur Trump. Il prétend avoir menacé de bombarder Moscou si Poutine l'envahissait et dit maintenant que l'Otan est trop mou. Je pense que la réputation de Poutine en a pris un coup terrible. En revanche, j'ai été fasciné de constater comment ma propre mère a réagi émotionnellement aux réfugiés ukrainiens. "Ils sont tellement religieux", dit-elle avec approbation, "et ils aiment leurs grands-mères". Ce n'est pas une guerre Est contre Ouest, c'est presque une guerre civile entre communautés chrétiennes.
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Europe, Histoire, Idées, International, Politique 1 commentaire -
Les saints de 1622 : la réponse de Dieu aux crises dans l'Église
Lu sur le site web du National Catholic Register, cet article du Père Raymond de Souza, fondateur du magazine « Convivium » :

« Ce samedi, le Vatican commémore le 400e anniversaire de la reconnaissance de la sainteté des saints. Thérèse d'Avila, François Xavier, Ignace de Loyola, Philippe Neri et Isidore de Madrid.
Les canonisations font partie de la routine de la vie de l'Église, mais certaines canonisations sont plus égales que d'autres. Pensez à Maria Goretti en 1950, où Assunta Goretti a été la première mère à assister à la canonisation de son propre enfant. Encore plus remarquable, Alessandro Serenelli, l'homme qui a assassiné Maria, était également présent, ayant eu une conversion complète de la vie en prison. Ou considérez, 50 ans plus tard, la canonisation de sœur Faustine Kowalska, la première sainte du nouveau millénaire, « l'apôtre de la miséricorde divine ».
Il n'y a cependant jamais eu de canonisation comme celle du 12 mars 1622, dont le 400e anniversaire sera célébré ce samedi. Le pape Grégoire XV a mené la plus grande cérémonie de canonisation de l'histoire, reconnaissant en même temps la sainteté d'Isidore le Laboureur (ca. 1070-1130), François Xavier (1506-1552), Ignace de Loyola (1491-1556), Thérèse d'Avila ( 1515-1582) et Philippe Neri (1515-1595).
Étant donné les deux saints jésuites, le pape François devrait assister à la principale célébration jésuite dans leur église principale à Rome, Il Gesu , Le Saint Nom de Jésus.
Assister à une canonisation pourrait être un événement unique dans une vie pour un catholique ordinaire. Il y a très peu d'événements uniques pour l'Église dans son ensemble, car sa vie est de deux millénaires et compte. Pourtant, ce mardi romain de 1622 était un événement unique pour la Sainte Mère l'Église. Hormis Saint-Isidore, les quatre autres étaient des géants du XVIe siècle, champions de la Réforme catholique.
Le pape Grégoire XV a servi dans une période post-conciliaire importante, celle du Concile de Trente. En janvier 1622, il institua l'une des réformes tridentines les plus importantes, créant Propaganda Fide , l'office romain clé pour promouvoir l'évangélisation des vastes territoires de mission qui étaient explorés. Ce qu'il a fait en janvier n'a peut-être pas été aussi important que ce qu'il a fait le 12 mars. Reconnaître de nouveaux saints peut être plus important que de créer de nouvelles structures. Les saints sont l'œuvre de Dieu, et les canonisations sont la reconnaissance de l'endroit où le doigt de Dieu a écrit ses desseins dans l'histoire. Les saints sont la réponse de Dieu aux crises de l'Église. Le XVIe siècle est une période de grande crise. L'Église en Europe occidentale a été déchirée. La réponse de Dieu fut, en partie, les saints de 1622 :
Sainte Thérèse d'Avila
Thérèse d'Avila était une maîtresse de la vie intérieure et une redoutable réformatrice. Elle a transformé la vie religieuse douce et réconfortante de son époque, sachant que les corruptions externes de l'Église du début du XVIe siècle étaient la manifestation d'une profonde dissolution interne. Les ordres religieux sont l'âme de l'Église, l'Église en prière et en adoration, contemplant les choses divines et recherchant la communion avec elles.
La vie religieuse dans certaines parties de l'Église aujourd'hui est florissante, mais il y a aussi beaucoup de dissolution, voire de décadence. Ce qui se passe maintenant s'est déjà produit auparavant ; nous avons encore besoin du même esprit réformateur de Thérèse. Sa sainte homonyme, Teresa de Calcutta, en est un exemple, ayant fondé l'ordre religieux féminin à la croissance la plus rapide de notre temps, consacré avec une égale rigueur à la prière et à la charité, au culte du Corps du Christ sur l'autel et au service de la Corps du Christ sous l'affreux déguisement du pauvre.
Nous appelons l'Église notre Mère, et tandis que les prélats de l'Église sont des hommes, l'Église elle-même est féminine. C'est théologiquement vrai, mais nous devons aussi en faire l'expérience. Là où les religieuses ont disparu, il est difficile de vivre la maternité de l'Église. Thérèse a dirigé la grande réforme de la vie religieuse des femmes à son époque ; il faut qu'elle intercède pour une autre réforme dans la nôtre.
Saint François Xavier et Saint Ignace de Loyola
François et Ignace nous rappellent que les disciples doivent rechercher l'excellence pour la plus grande gloire de Dieu - ad maiorem Dei gloriam, comme le dit la devise jésuite - au moins aussi ardemment qu'ils le font pour l'approbation humaine. La médiocrité n'est généralement pas un péché, mais elle peut saper l'énergie évangélique de l'Église. La léthargie et la paresse peuvent être plus meurtrières pour la vie de l'Église que la vie licencieuse, car la première se glisse plus subtilement.
Les premiers jésuites étaient un groupe de frères engagés dans la mission ; Ignatius, Francis Xavier et Peter Faber étaient tous colocataires universitaires à Paris. Frères en mission est une description appropriée de ce que signifie être chrétien. C'est ainsi que le pape François, le premier pape jésuite, a défini l'Église dans Evangelii Gaudium — une communion de disciples unis dans la mission.
Pour Ignace et François, cette mission était d'aller jusqu'aux extrémités de la Terre. François, le plus grand missionnaire depuis l'apôtre Paul, est mort au large de la Chine, après avoir évangélisé en Inde et au Japon.
Ignace a apporté son expérience militaire - combattant pour la gloire terrestre - au combat pour les âmes. De Rome, non seulement il envoya François Xavier en Extrême-Orient, mais les fils de saint Ignace furent les premiers missionnaires en Nouvelle-France et dans toute l'Amérique du Sud, en plus de devenir des martyrs en Europe protestante.
L'intérêt pour saint Ignace a connu un renouveau récemment, car de nombreux catholiques ont appris sa méthode de discernement à travers les Exercices Spirituels . Cette année, les jésuites célèbrent une « année ignatienne », commençant en mai dernier avec le 500e anniversaire de sa conversion et incluant cette année le 400e anniversaire de sa canonisation.
Saint Philippe Neri
Dans Redemptoris Missio , sa grande charte pour l'activité missionnaire, saint Jean-Paul II a enseigné que chaque chrétien doit être missionnaire et que chaque lieu est un territoire de mission.
Philip Neri a vécu cette réalité. Il voulait à l'origine partir à l'étranger comme Francis Xavier, mais son directeur spirituel lui a dit : « Rome sera tes Indes ». Rome était un territoire de mission !
Rome aux XVe et XVIe siècles était un gâchis spirituel. Pire que cela, c'était un scandale qui réclamait une réforme. Cette réforme produirait elle-même la douleur de la division dans la Réforme.
Saint Philippe a apporté cette réforme nécessaire à Rome même d'une manière tout à fait catholique. Il l'a fait en prêchant l'Evangile, de manière créative et séduisante, et en se consacrant au pardon des péchés dans le sacrement de pénitence.
Philippe était un génie pour se faire des amis et des pénitents, convertir ses amis et se lier d'amitié avec ses convertis. Il attirait plutôt qu'intimidait; il a proposé plutôt qu'imposé. De tous les saints de 1622, il était celui avec qui nous serions probablement le plus heureux de passer du temps, car sa joie était contagieuse - une contagion qui s'avérerait nécessaire pour soulager la lourdeur spirituelle de Rome.
Saint Isidore de Madrid
Contrairement aux quatre autres canonisés en 1622, il n'était pas un saint de la Réforme catholique. Il vécut quelques siècles plus tôt et mourut en 1130. Il ne doit pas être confondu avec le plus célèbre saint Isidore de Séville, bien qu'il porte le nom de ce saint.
Il est le saint patron de Madrid et était un agriculteur qui a vécu une vie conjugale sainte. En effet, sa femme, Maria, est également une sainte canonisée.
Saint Isidore nous enseigne le chemin ordinaire de la sainteté, même si le sien a été marqué par des événements miraculeux. Il a travaillé dur comme agriculteur et s'est également consacré à la prière, réalisant qu'une vie de prière n'était pas réservée aux prêtres et aux ordres religieux. Lui et Maria ont ouvert leur maison aux autres - en effet, certains des miracles de sa vie sont liés à sa capacité à nourrir plus d'invités qu'ils n'en avaient !
Saint Isidore a passé sa vie à faire des choses ordinaires d'une manière extraordinaire. Dépouillé des miracles, sa vie était faite de vie domestique quotidienne, version familiale du « Petit Chemin » de la Petite Fleur. Les autres saints de 1622 vécurent sur la grande scène de l'histoire ; Isidore a apporté le grand drame de l'histoire à sa famille, à sa maison et à ses travaux agricoles.
Saints de la Réforme
Les saints sont les réformateurs nécessaires à l' Ecclesia semper reformanda , l'Église étant toujours réformée. La réponse de l'Église à la Réforme protestante — doctrinalement et en termes de gouvernance et de pratique ecclésiale — est venue au Concile de Trente (1545-1563). C'était nécessaire et l'œuvre du Saint-Esprit.
Mais on peut dire qu'une réponse définitive fut donnée le 12 mars 1622, avec la plus grande canonisation de l'histoire. »
Ref. Les saints de 1622 : la réponse de Dieu aux crises dans l'Église