
De Massimo Scapin sur le site de la Nuova Bussola Quotidiana :
Benoît XV, un pape prophétique (mais négligé)
22-01-2022
Il y a cent ans, le 22 janvier, mourait Benoît XV, né Giacomo della Chiesa. Très cher à Ratzinger, il reste dans les mémoires pour ses propos sur le "massacre inutile" de la Première Guerre mondiale et son engagement pour la paix. Mais il avait des mérites dans bien d'autres domaines, des relations avec les Orientaux à la résolution de la question moderniste. Et il a favorisé la musique sacrée, en promouvant la réforme de Saint Pie X.
Il y a un siècle, le 22 janvier 1922, le pape de la paix mourait à l'âge de 67 ans : Benoît XV, né Giacomo della Chiesa. Né à Gênes dans une famille noble le 21 novembre 1854, il obtient sa licence en droit à 20 ans, devient prêtre à 24 ans, secrétaire du nonce apostolique à Madrid à 28 ans, minuteur à 32 ans et député à la Secrétairerie d'État à 46 ans, archevêque de Bologne pendant sept ans à 53 ans, créé cardinal à 59 ans et élu pape trois mois plus tard.
Cette grande figure du XXe siècle est injustement négligée. Il y a eu un regain d'intérêt lorsque Benoît XVI, au début de son pontificat, a déclaré : "J'ai voulu m'appeler Benoît XVI pour me rattacher idéalement au vénéré pontife Benoît XV, qui a dirigé l'Église dans une période troublée à cause de la Première Guerre mondiale. Il a été un courageux et authentique prophète de la paix et il a œuvré avec un grand courage d'abord pour éviter la tragédie de la guerre et ensuite pour limiter ses conséquences néfastes" (Benoît XVI, Audience générale, 27 avril 2005).
La plupart des gens ne se souviennent de Benoît XV que pour son opposition à la Première Guerre mondiale, à "la plus sombre tragédie de la haine et de la démence humaines" (Benoît XV, Homélie, 30 juillet 1916). Ils rappellent l'auteur de l'Exhortation apostolique 'Dès le début', envoyée le 1er août 1917 aux chefs des peuples belligérants, dans laquelle sont indiquées des solutions particulières, propres à mettre fin à "cette lutte formidable qui, chaque jour davantage, apparaît comme un inutile massacre".
Pourtant, à y regarder de plus près, il y a beaucoup à dire sur son bref pontificat, qui a duré un peu plus de sept ans. En fait, comme l'écrivait le cardinal Giuseppe Siri (1906-1989), archevêque de Gênes, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort de Benoît XV : "Si quelqu'un se lève pour le scruter à fond, il rendra justice au grand pape et rendra l'histoire plus honnête" (J. F. Pollard, Il papa sconosciuto. Benedetto XV, 1914-1922, e la ricerca della pace, San Paolo, Milan 2001, p. 5). En examinant les nombreux domaines dans lesquels le pape génois était impliqué, nous trouvons : le rapport avec le monde oriental, en constituant une Sacrée Congrégation spéciale pour l'Église orientale et en fondant à Rome un institut pour les études de l'Orient chrétien ; le problème des missions, en promouvant l'organisation autonome des Églises locales dans les territoires de mission et la libération du conditionnement politique et économique par les nations européennes ; la question moderniste, en la résolvant avec prudence ; la discipline ecclésiastique, en promulguant le Code de droit canonique, voulu par saint Pie X ; la musique sacrée.
Si saint Pie X peut être appelé le grand pape de la musique sacrée, Benoît XV a également un mérite considérable pour la réforme décrétée par le pape Sarto. Il en a encouragé la mise en œuvre à plusieurs reprises par sa parole et sa main généreuse : au début de son pontificat, le 23 septembre 1914, lorsqu'il a reçu à Rome les représentants de l'Association italienne de Santa Cecilia et de l'École pontificale de musique sacrée ; lors d'audiences aux évêques et aux mélomanes ; lorsqu'il a béni les nouvelles institutions de musique sacrée aux États-Unis et en Espagne ; et lorsqu'il a envoyé des messages aux participants des congrès de musique liturgique ou sacrée.
L'école, fondée par saint Pie X en 1910 et inaugurée le 3 janvier 1911, a en réalité été fondée par Benoît XV qui, le 10 juillet 1914, par un rescrit de la Secrétairerie d'État, l'a déclarée "pontificale" et lui a accordé la faculté de conférer des grades académiques. Après un incendie qui s'est déclaré dans la soirée du 22 novembre 1914 dans ses premiers locaux très modestes de Via del Mascherone, 55, près de la Piazza Farnese, l'école, grâce à Benoît XV, a déménagé, peut-être le 15 mars 1915, au Palazzo dell'Apollinare, alors siège du Vicariat de Rome.
Le 7 mai 1915, Benoît XV accorde à l'École pontificale sa première audience. Après l'avoir encouragée à poursuivre "avec constance dans la voie qu'elle avait commencée", à se développer, à se perfectionner et à se maintenir "digne des plus nobles traditions des Instituts pontificaux romains", il ajoutait : "Notre encouragement s'est limité jusqu'à présent à donner à l'Ecole des locaux plus vastes et un siège plus digne ; mais nous espérons, dans des circonstances meilleures, pouvoir contribuer à lui donner une plus grande impulsion et un développement plus vigoureux" (Il primo decennio della Pontificia Scuola Superiore di musica sacra in Roma, in La Civiltà cattolica, quad. 1674, Rome 1920, p. 528).
Le Comité auxiliaire de l'Institut pontifical de musique sacrée, fondé au début de 1915 à New York par l'écrivain et musicienne Justine Ward (1879-1975), a pris une part active à ce développement, avec le double objectif de restaurer la musique sacrée aux États-Unis et de soutenir l'École pontificale de Rome. Avec un autre bienfaiteur américain, Herbert D. Robbins, Ward fit don du grand orgue Tamburini opus 74 à trois claviers et trente registres, situé dans l'historique Sala Gregorio XIII, la salle académique ou Aula Magna de l'Institut, inaugurée le 6 novembre 1921 par le célèbre organiste et compositeur Marco Enrico Bossi (1861-1925), qui interpréta pour la première fois ses Tre momenti francescani, op. 140 (voir E. Cominetti). 140 (cf. E. Cominetti, Marco Enrico Bossi, Gioiosa Editrice, Sannicandro Garganico 1999, pp. 49, 110).
Enfin, concernant l'intérêt du pontife génois pour la musique sacrée, il ne faut pas oublier la lettre 'Non senza vivo' du 19 septembre 1921, envoyée au cardinal Vincenzo Vannutelli (1836-1930), évêque d'Ostie et de Palestrina et doyen du Sacré Collège des cardinaux, à l'occasion de l'inauguration de la statue de Giovanni Pierluigi à Palestrina. Benoît XV voulait y "promouvoir de plus en plus cette ferveur de restauration musicale qui, heureusement commencée par Notre prédécesseur de vénérable mémoire, dans la première année de son pontificat, s'est répandue et intensifiée dans toutes les régions du catholicisme". Il ne voulait pas que la ferveur allumée par les "sages normes" de son prédécesseur se refroidisse, "surtout en ce qui concerne la polyphonie classique qui, comme on l'a si bien dit, a atteint le sommet de sa perfection dans l'école romaine par l'œuvre de Giovanni Pierluigi da Palestrina".










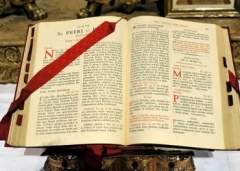 A propos d’un motu proprio qui ne passe décidément pas la rampe : tribune du journaliste et écrivain Laurent Dandrieu dans le journal « La Croix » du 25 janvier 2021 :
A propos d’un motu proprio qui ne passe décidément pas la rampe : tribune du journaliste et écrivain Laurent Dandrieu dans le journal « La Croix » du 25 janvier 2021 :


