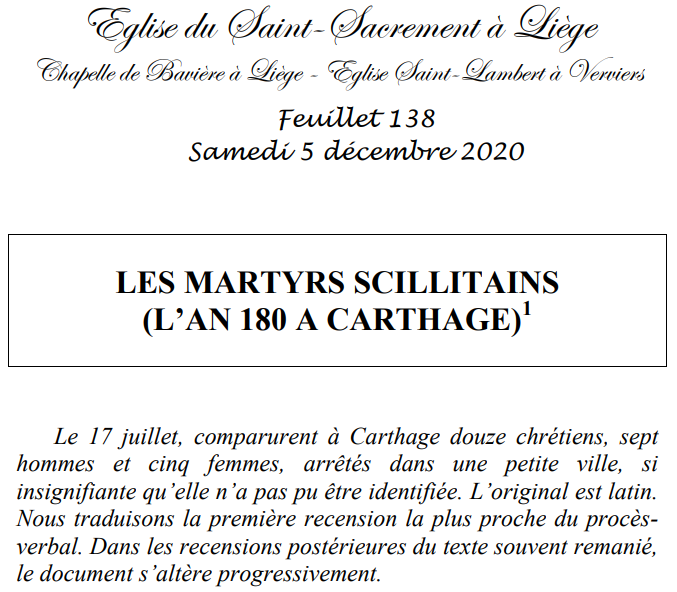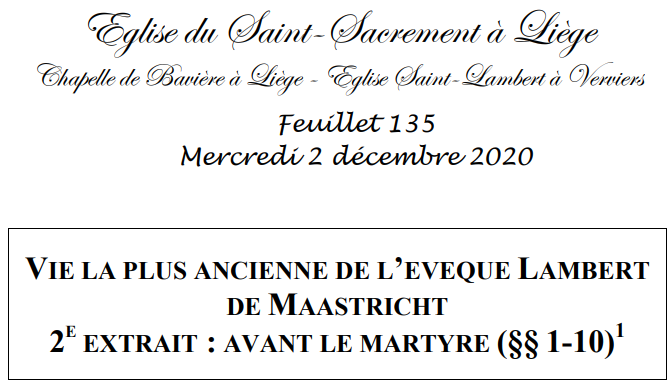De CNA (Catholic News Agency) :
Un évêque catholique clandestin meurt en Chine
31 déc. 2020
Selon la chaîne catholique AsiaNews, dont le siège est à Rome, l'évêque Andrea Han Jingtao, 99 ans, leader de l'Eglise catholique clandestine en Chine, est décédé le 30 décembre. Han Jingtao était l'évêque clandestin de Siping.
Au cours de ses premières années d'enfance dans une famille catholique, Han a reçu une formation et une éducation de qualité des missionnaires canadiens du Québec, qui dirigeaient le vicariat apostolique dans sa région de Chine avant la révolution communiste.
Après l'arrivée au pouvoir de Mao Zedong, le défunt évêque a été envoyé dans un camp de concentration où il a été emprisonné pendant 27 ans (1953-1980) "pour avoir refusé de participer à l'Église 'indépendante et autonome', comme le voulait Mao Zedong", rapporte AsiaNews.
Une fois libéré, sa maîtrise de la langue anglaise a fait de lui un atout pour le régime communiste, qui l'a enrôlé comme professeur d'anglais à l'université de Changchun, puis à l'université du Nord-Est pour des programmes de maîtrise et de doctorat. Selon AsiaNews, "il a initié de nombreux Chinois à l'étude des langues et cultures classiques, latines et grecques".
Après sa retraite académique en 1987, il a consacré ses efforts pastoraux à la Légion de Marie locale et à la congrégation religieuse qu'il a fondée, les Sœurs du Mont Calvaire.
Selon AsiaNews : "Il se souvient lui-même que dans les années 1950, le régime voulait "se débarrasser de l'ingérence du pape et expulser les missionnaires étrangers". À cette époque, j'ai réalisé que l'Église était confrontée à un grand défi et qu'elle avait besoin d'une forte endurance, sinon elle ne pourrait pas tenir debout. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une congrégation religieuse".
Il a été secrètement nommé évêque de Siping en 1982, mais son ordination clandestine n'a pu avoir lieu qu'en 1986.
Après avoir été placé sous haute surveillance à la maison en 1997, il a continué à garder son troupeau sous la menace constante, organisant des rassemblements secrets et encourageant les laïcs à rester fermes dans la foi et la charité.
Selon des statistiques récentes fournies par AsiaNews, son diocèse compte quelque 30 000 catholiques, dont les deux tiers appartiennent à l'Église clandestine. Il compte 20 prêtres et plus de 100 religieuses.

![Giotto di Bondone, “The Nativity of Jesus” [Scrovegni Chapel, Padua], 1303](https://publisher-publish.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pb-ncregister/swp/hv9hms/media/20201209011248_be48eb809f19cb08e69f5424dc46f18d8d45a1ddb6a3833d90c5c876b6379d9a.jpeg)