Extrait de l’éditorial de Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, dans Notre Église n°55 - Février 2015 :

[…] Quand Jésus inaugura son ministère public, il ne vint pas avec éclat et majesté, mais il se mit au rang des pécheurs, attendant son tour pour être baptisé par Jean dans le Jourdain. Désigné comme l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il n'avait pas besoin de ce baptême de repentir, mais par ce geste de son immersion, il annonçait prophétiquement la modalité de sa mission de salut : c'est par l'humiliation de la passion et la mort sur la croix, qu'il libérerait l'humanité.
Nous aussi nous attendons un libérateur pour notre temps, dont le pape Benoît XVI avait identifié le problème majeur : « En ce moment de notre histoire, le vrai problème est que Dieu disparaît de l’horizon des hommes et que tandis que s’éteint la lumière provenant de Dieu, l’humanité manque d’orientation, et les effets destructeurs s’en manifestent toujours plus en son sein ». En gommant les racines chrétiennes de notre culture, en faisant l’apologie d’une conception matérialiste, hédoniste et relativiste de l’existence qui conduit à ce que le pape François a appelé « le grand vide d’idées auquel nous assistons en Occident », nous faisons le lit du fondamentalisme religieux et de tous les extrémismes. En effet, comme le Saint-Père le rappelait devant le Parlement européen, en citant le Pape émérite, « c’est l’oubli de Dieu, et non pas sa glorification, qui engendre la violence ».
Ceux que l’on appelle les « islamistes radicaux », qui semblent rallier de plus en plus d’adeptes tant dans les pays à majorité musulmane qu’en France, où le nombre de conversions à l’Islam grandit, ont décidé de punir cette conception du monde qu’ils identifient de manière sommaire avec la civilisation chrétienne : c’est pourquoi les chrétiens, comme nous le constatons au Moyen Orient, au Nigéria ou au Pakistan, sont des cibles privilégiées de leurs exactions. Il s’agit pour eux de conquérir le monde à l’Oumma, en recourant à la violence la plus aveugle pour servir un idéal à la fois politique et religieux.
Nous ne saurions répondre à cette grave crise par le seul recours à une laïcité qui accompagne ce que saint Jean Paul II a appelé « une apostasie tranquille et silencieuse ». Aujourd’hui, après les attentats du mois de janvier à Paris, on semble même avoir oublié les victimes désarmées au profit d’idées que l’on appelle pompeusement les « valeurs de la République » : « Maintenir vivante la démocratie en Europe demande d’éviter les « manières globalisantes » de diluer la réalité : les purismes angéliques, les totalitarismes du relativisme, les fondamentalismes anhistoriques, les éthiques sans bonté, les intellectualismes sans sagesse » (Pape François devant le Parlement européen). Aveuglés sur les vrais enjeux, on s’obstine à idolâtrer la liberté d'expression. Mais une liberté d’expression qui n'est pas au service de l'affirmation des droits humains les plus fondamentaux, comme le droit à la vie et le droit à la liberté religieuse, peut devenir destructrice : en sombrant dans l'insulte et la dérision, elle attise la haine, engendre la violence et érige le manque de respect de l'autre en principe du vivre ensemble! Les événements récents en ont apporté la navrante démonstration.
Ni la violence, ni le laïcisme ne sont une réponse adéquate à la crise que nous vivons. La réponse des chrétiens est tout autre : c'est la grâce de l'Esprit Saint reçue au baptême ! Ce don est seul capable, en nous unissant réellement au Christ mort et ressuscité, de changer radicalement notre cœur, c'est-à-dire de le transformer à la racine, où se cachent les pensées perverses dont Jésus parle dans l'Evangile. On a beaucoup évoqué les islamistes radicaux ou radicalisés, qui exercent une violence inouïe au nom de leur croyance ou de leur religion. La radicalité du baptême se situe à un autre niveau, au plus intime de nous-même, dans la seule contestation qui soit efficace, celle qui s'attaque non aux autres, mais à la racine du mal qui est tapi dans les cœurs : une révolte d'amour contre l'esclavage des passions. En nous établissant dans une relation d'amitié avec le Christ, constamment nourrie par la Parole et les sacrements, la foi nous donne de vaincre le monde ! Alors, nous pourrons avec le Christ transformer l’histoire.
+ Marc Aillet
Ref: Confiance, j’ai vaincu le monde
JPSC
 On attendait François en France en 2015. Alors que son voyage a été reporté en 2016, c’est l’un de ses plus proches collaborateurs, le cardinal guinéen Robert Sarah, qui vient en visite dans l’Hexagone, à l’occasion de la sortie de son livre Dieu ou rien, entretiens sur la foi, écrit en collaboration avec l’écrivain Nicolas Diat (Ed. Fayard, 424 pages).
On attendait François en France en 2015. Alors que son voyage a été reporté en 2016, c’est l’un de ses plus proches collaborateurs, le cardinal guinéen Robert Sarah, qui vient en visite dans l’Hexagone, à l’occasion de la sortie de son livre Dieu ou rien, entretiens sur la foi, écrit en collaboration avec l’écrivain Nicolas Diat (Ed. Fayard, 424 pages).

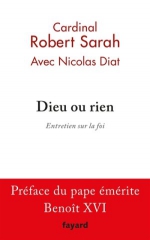



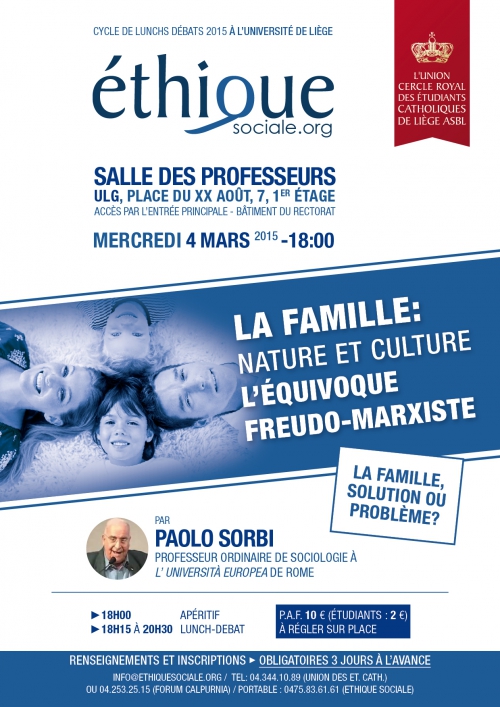

.jpg)




