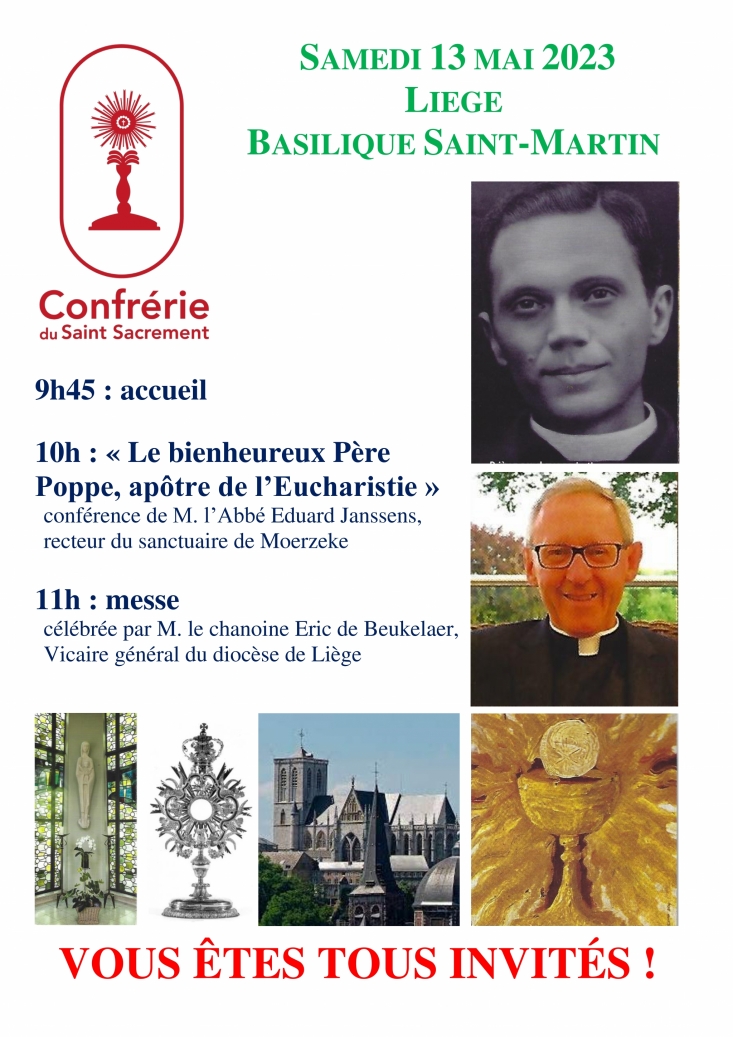Cette hymne célèbre a été composée par Guido d’Arezzo (entre Sienne et Florence) au XIe siècle. Remarquable pédagogue, ce moine musicien est à l'origine du système de notation musicale encore en vigueur. Ce système a révolutionné l'apprentissage de la musique car il a dispensé les artistes d'apprendre par coeur, à l'oreille, les morceaux de musique et de chant. Il a facilité la transcription des notes et leur lecture.
Les premières notations musicales à base de portées et de notes sont apparues au VIIIe siècle à Metz et à Saint-Gall (aujourd'hui en Suisse) à l'initiative des chanoines en charge du chant liturgique (ainsi appelle-t-on le chant qui accompagne les cérémonies religieuses).
Les musiciens ont d'abord utilisé des signes musicaux ou neumes en « campo aperto »sans ligne. Ensuite, pour aider les copistes à conserver les proportions verticales, on a introduit une, puis deux puis trois lignes.
Une main musicale
 Guido d'Arezzo a ajouté une quatrième ligne à la portée et, ce faisant, il a introduit un moyen mnémotechnique, la « main guidonienne », pour représenter les notes : dans ce système d'écriture, en effet, tous les degrés de l'échelle musicale peuvent être assimilables aux jointures et aux phalanges des cinq doigts de la main gauche ouverte.
Guido d'Arezzo a ajouté une quatrième ligne à la portée et, ce faisant, il a introduit un moyen mnémotechnique, la « main guidonienne », pour représenter les notes : dans ce système d'écriture, en effet, tous les degrés de l'échelle musicale peuvent être assimilables aux jointures et aux phalanges des cinq doigts de la main gauche ouverte.
Guido d'Arezzo a aussi ajouté au début de chaque ligne une lettre clef qui indique la valeur d'intonation de la série considérée et qu'il a appelé gamma, d'où le nom de« gamme » aujourd'hui donné à son système de notation musicale.
Les notes étaient auparavant désignées par les premières lettres de l'alphabet. Pour désigner les notes qui prennent place sur les quatre lignes de sa portée, Guido d'Arezzo s'est servi des premières syllabes d'une hymne à Saint-Jean-Baptiste (la dernière note, SI, est une contraction des deux initiales de Sancte Johannes) :
« UT queant laxis / Pour que puissent
« REsonare fibris / résonner des cordes
« MIra gestorum / détendues de nos lèvres
« FAmili tuorum, / les merveilles de tes actions,
« SOLve polluti / ôte le péché,
« LAbii reatum, / de ton impur serviteur,
« Sancte Iohannes. / ô Saint Jean.
Les écoliers italiens du temps de Guido connaissaient bien cette hymne, en effet, et la chantaient avec une mélodie qui montait de degré en degré. C'était pratique pour apprendre les hauteurs relatives de chaque degré de la gamme. Le si fut ajouté par Anselme de Flandres à la fin du XVIe siècle et le ut, jugé trop dur à l'oreille, transformé en do par Bononcini en 1673. Quant au mot solfège, il vient tout simplement des notes sol-fa.
La portée de Guido, étendue à cinq lignes, s'est généralisée très vite à l'ensemble du monde musical mais, à la différence des Latins, les Anglais et les Allemands sont restés fidèles aux lettres de l'alphabet pour désigner les notes. En anglais, do ré mi fa sol la si devient : C D E F G A B.
Ref. Guido d'Arezzo nous lègue sa notation musicale
JPSC