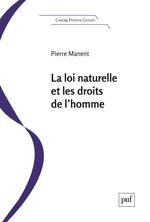D'AED-France :
Syrie: « A Damas, les chrétiens vivent dans l’angoisse de la mort »

Alors que la Syrie entre dans sa 8e année de guerre, l’offensive militaire se poursuit et touche particulièrement les habitants de la Ghouta orientale, et de Damas, toute proche, dont le quartier chrétien. Le point avec le Père Andrzej Halemba, responsable des projets au Proche-Orient de l’AED.
AED: Quelles sont les informations qui vous parviennent au sujet de la situation dans la Ghouta orientale ?
Père Andrzej Halemba : Les gens dans la Ghouta orientale sont piégés. Ils sont plusieurs milliers ! Ils n’ont presque aucun accès aux denrées alimentaires. Ils n’obtiennent aucun soin médical. De nombreux habitants sont blessés et doivent être opérés. Il n’y a pas de corridors d’évacuation. L’une des raisons pourrait être que les rebelles considèrent la population civile comme un bouclier humain. Et le gouvernement craint que parmi les réfugiés civils qui viennent à Damas, il y ait aussi des kamikazes qui apporteront encore plus de terreur dans la ville. L’angoisse et l’épouvante règnent partout. Les tirs de mortiers continuent sans interruption. Les chrétiens vivent dans l’angoisse de la mort.
Et tout cela pratiquement au seuil de la capitale syrienne avec plus d’un million d’habitants…
La Ghouta orientale n’est éloignée que de quatre kilomètres du centre de Damas. De là, les rebelles peuvent surveiller la ville. Parmi eux, il y a aussi des troupes proches d’Al-Qaïda. Au sud de Damas, il y a toujours quelques unités de Daech. Il faut donc mettre en lumière non seulement la méthode des troupes gouvernementales, mais aussi le fait que la capitale se trouve dans la ligne de mire des islamistes, avec des attentats au sein de la ville, et des tirs aux mortiers de l’extérieur. Le quartier chrétien de Bab Touma, qui se situe à la lisière orientale de la vieille ville, est aussi sévèrement touché. Les belligérants sont conscients qu’à chaque fois que des enfants sont tués, que des jeunes gens meurent, que des familles sont anéanties et des maisons détruites, ils attirent l’attention publique. Cela fait partie de leurs calculs.

Vous disiez qu’il y avait aussi des unités islamistes parmi les groupes rebelles. Les médias européens se concentrent surtout sur les méthodes brutales des troupes gouvernementales. Ce n’est donc que la moitié de la vérité ?
En temps de guerre, la vérité meurt toujours la première. Les deux côtés ont tort. Les deux côtés commettent des crimes. Les deux côtés sont coupables. Les deux côtés ont sacrifié d’innombrables êtres humains. En Syrie, plus d’un million de personnes ont été tués ou blessées au cours des sept dernières années de guerre. Et ces blessures ne concernent pas seulement les corps, mais aussi les âmes. Tant de personnes ont été traumatisées. Il va falloir des décennies pour guérir de ces blessures. Et tous les belligérants sont responsables de cette situation !
Quel est le type d’aide que l’AED prévoit pour Damas ?
En fait, cela fait longtemps que nous sommes actifs dans cette région. Nous avons accordé plus de 21 millions d’euros d’aide d’urgence depuis le début de la guerre. Aujourd’hui, nous aidons des familles chrétiennes avec des dons de nourriture, de vêtements et de médicaments. En outre, nous mettons sur pied un accompagnement pastoral et thérapeutique pour ces personnes traumatisées. C’est très important. Nous encourageons le travail des communautés de vie consacrée – car ces communautés sont essentielles pour l’aide d’urgence. Nous recherchons des possibilités de logement pour les familles de réfugiés.
 « Ces dernières semaines, de nombreux observateurs sont restés perplexes, voire profondément troublés, devant
« Ces dernières semaines, de nombreux observateurs sont restés perplexes, voire profondément troublés, devant