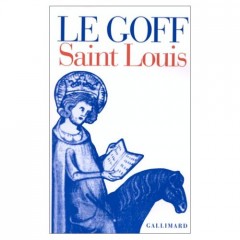De Thierry Boutte et Bosco d'Otreppe sur le site de la Libre :
Pascal Smet a-t-il eu raison de rebaptiser les Journées du patrimoine en Heritage Days ?
Considéré trop genré, le label "les Journées du patrimoine" a été changé en “Heritage Days”. De plus, l’utilisation de l’anglais veut placer la région de Bruxelles sur la scène internationale. Une bonne idée ?
25-08-2021
Contexte
Les 18 et 19 septembre 2021 se dérouleront les Heritage Days, nouvelle appellation pour les journées du Patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale.Pourquoi Pascal Smet, le secrétaire d'État chargé de l'Urbanisme et du Patrimoine, a-t-il changé pour un nouveau vocable anglais ? L'anglais pour offrir une vitrine internationale au patrimoine bruxellois, glisse Marc Debont, son porte-parole. Après Washington, Bruxelles est la 2e ville la plus cosmopolite au monde. Aussi parce que le terme Heritage dépasse ce qui est communément inclus - des visites de bâtiment - dans le mot patrimoine ou openmonumentdag. Enfin, pour sortir de la dichotomie patrimoine-matrimoine avec un terme inclusif et neutre. Trop genré le mot patrimoine. Matrimoine l'est autant et devrait disparaître pour être englobé bientôt dans le Heritage Days.
L'avis d'Apolline Vranken Initiatrice des Journées du matrimoine: "C'est un signe positif"
Les Journées du patrimoine sont rebaptisées "Heritage Days". Qu’en pensez-vous ?
C’est une belle nouvelle. Le choix des mots est important. Notre langue est chargée de concepts et véhicule des idées, notamment et malheureusement inhérentes au patriarcat. Ainsi, quand on utilise le terme de patrimoine, qui signifie "héritage du père", on tend à considérer que le masculin est universel. L’inverse n’est pas toujours vrai. Voir que la Région bruxelloise opte pour un mot plus inclusif, plus englobant, est un signe positif.
Exit les Journées du patrimoine, trop genrées, mais vous organisez depuis les 24, 25 et 26 septembre 2021, les Journées du matrimoine, pourquoi ?
Le terme matrimoine existe depuis le Moyen Âge ! L’une des missions de l’événement est de remettre en lumière tous les héritages laissés par les femmes à travers l’Histoire ayant contribué à façonner une ville et une société plus égalitaires. Les Journées du matrimoine s’inscrivent en réponse à une thématique complexe qui est l’invisibilisation des femmes à travers l’Histoire et l’espace public urbain. Elles célèbrent l’héritage historique dans différents domaines - architectural, sculptural, urbanistique, social - en repartant sur les traces des femmes et personnes minorisées de notre passé. C’est aussi l’occasion de découvrir le matrimoine contemporain - artistique, politique et féministe, des femmes et personnes minorisées qui œuvrent à construire une ville juste.
Les Journées du matrimoine n’ont-elles paradoxalement pas aussi une vision idéologique, genrée, voire sexiste ?
Idéologique, pas dans un sens péjoratif, mais idéologique dans le sens de défendre un idéal et de tendre vers plus d’égalité, oui. J’ai le sentiment que, en tant que société, on y travaille toutes et tous. Et sexiste, sûrement pas. Féministe n’est pas un mot sexiste. Avec les Journées du matrimoine, nous cherchons simplement à identifier de qui et de quoi on parle, à savoir de l’héritage de femmes.
L'avis de Guillaume Dos Santos, coordinateur du Forum Logia: "Un changement linguistique vain et illusoire"
Rien n’est plus étranger à la notion de patrimoine que cette obsession lexicale contemporaine visant à redéfinir le passé à l’aune des prismes de pensée actuels.
Le langage dit certes quelque chose de nous, de qui nous sommes, et du monde dans lequel on le parle. En extirper les éléments dont l’étymologie nous incommode - tel que le mot patrimoine - ne change pourtant rien au passé lui-même : tout au plus ce révisionnisme linguistique nous rend-il sourd à ce que celui-ci a à nous dire.