Du chanoine Laurent Jestin sur le site de la Revue Catholica :
Fin d’une tentative de conciliation
Traditionis custodes, la lettre apostolique en forme de motu proprio du pape François « sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 », a frappé par les restrictions pratiques drastiques qu’elle contient. La lettre aux évêques l’accompagnant énonce le terme visé : l’extinction de la messe célébrée selon l’usus antiquior, ce qui, plus que le ton abrupt que tous ont noté, fait de ces restrictions un changement de cap radical. Mais quel en est le fondement ? Nombre de récipiendaires, souvent pour s’en désoler ou s’en déclarer exempts, se focalisent sur l’accusation d’une collusion entre missel ancien et refus du concile Vatican II et du magistère postérieur. C’est se tromper sur l’importance de ce motif effectivement invoqué. Il est second et, pour le bien comprendre dans la logique du motu proprio, il convient de relever une première opposition, plus fondamentale, à la source du raisonnement de Traditionis custodes. Cela, qui n’apparaît qu’en filigrane dans la lettre d’accompagnement adressée aux évêques, se trouve développé par celui qu’à bon droit on considère comme l’un des inspirateurs du document papal et son interprète le plus autorisé, à savoir Andrea Grillo[1]. C’est ainsi un commentaire sur trois niveaux – le motu proprio lui-même, la lettre qui l’accompagne, l’explicitation d’Andrea Grillo – que nous nous proposons d’entreprendre, avec pour centre l’article 1er du motu proprio, dans le parti pris assumé d’un accord substantiel entre les deux premiers et le troisième niveau.

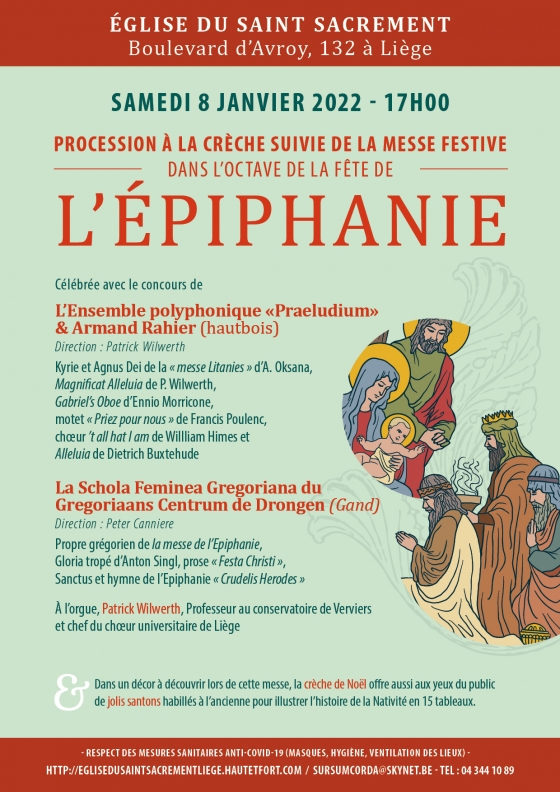
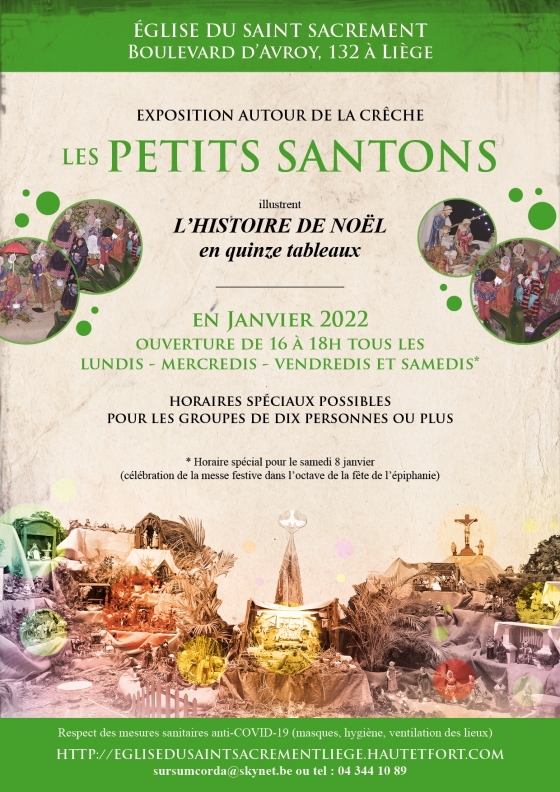

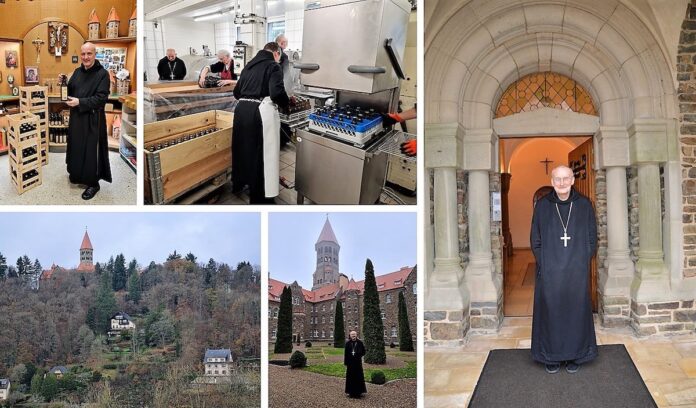
 Publiée dans le journal « La Croix », une tribune libre de l’historien Christophe Dickès animateur, entre autres, des émissions de KTO-TV "au risque de l’histoire":
Publiée dans le journal « La Croix », une tribune libre de l’historien Christophe Dickès animateur, entre autres, des émissions de KTO-TV "au risque de l’histoire": 