La seule issue possible semblerait-il... Mais comment ne pas y voir un nouvel et affligeant épisode de l'extinction progressive de la présence catholique dans nos provinces ? On ne peut que constater l'impuissance et la résignation des autorités ecclésiastiques face à cette évolution désolante. Et les mesures sanitaires imposées par le gouvernement depuis mars 2020, si docilement acceptées par nos évêques, vont avoir un impact inévitable sur ce qui reste de pratique religieuse. Cette dégradation de la situation ne peut que susciter toujours plus de questions à propos du maintien d'édifices de moins en moins fréquentés et dont la maintenance devient insupportable et apparemment injustifiée.
De cathobel.be :
Désaffectation de l’église du Saint-Sépulcre et Saint-Paul à Nivelles
L’état de l’église pose question depuis plusieurs années. Après avoir envisagé de multiples solutions qui n’étaient pas finançables, le Vicariat, les assistants pastoraux et la fabrique d’église ont dû se résoudre à la désaffectation du bâtiment. Une décision avalisée par l’archevêque de Malines-Bruxelles.

Depuis trois ans, de nombreuses réunions se sont tenues avec le doyen, la fabrique d’église, le Vicariat du Brabant wallon, les Amis du SPLUC, etc concernant l’avenir de cette église. En effet, si dès les années 70-80, la stabilité du bâtiment inquiétait, l’état général s’est encore dégradé. En juillet 2019, un rapport des pompiers a pointé de sérieux problèmes de sécurité (stabilité du clocher, chutes de pierre, non-conformité de l’installation électrique, risque de propagation d’incendie). La ville de Nivelles à donc ordonné la fermeture de l’église et sa sécurisation extérieure.
Malheureusement, le chantier de rénovation pour sauver l’édifice est conséquent. L’étude d’un bureau d’architecte a estimé à plus de deux millions d’euros le montant des travaux. Un budget que ni la fabrique d’église, ni la commune de Nivelles, ne peut se permettre. Une réunion en mars avec le Cardinal De Kesel et Mgr Hudsyn a clairement établi l’impasse dans laquelle le projet se trouvait. Avec l’avis favorable du Conseil presbytéral du Brabant wallon et celui du Conseil épiscopal de l’Archevêché, Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles, a donc décidé de procéder à la désaffectation de l’église du Saint-Sépulcre et Saint-Paul.
Un choix compliqué mais qui est loin d’être la norme. En témoigne, le peu de désaffectations d’églises au sein du Brabant wallon lors de ces trente dernières années. « Cette décision sera sûrement ressentie douloureusement par les paroissiens et les habitants de ce quartier. Cependant – même si on peut le regretter – il y a des situations où les arguments d’ordre financier pèsent inexorablement dans le discernement et la décision que les autorités pastorales doivent aussi assumer.« , ont fait savoir les acteurs du dossier.
Suite à cette décision canonique de désaffectation, la fabrique d’église, propriétaire, peut donc entamer un processus de réaffectation de cet édifice à un usage non-cultuel en veillant au maintien de l’architecture global, au maintien ou à la réinsertion d’un maximum de vitraux, d’un usage respectueux de l’histoire du bâtiment et de son intégration dans l’environnement et le paysage local.
Du côté des paroissiens locaux, la continuité des services a été assurée dès la fermeture de l’église en 2019. Ces fidèles sont donc désormais intégrés au sein de la vie chrétienne du centre de Nivelles.
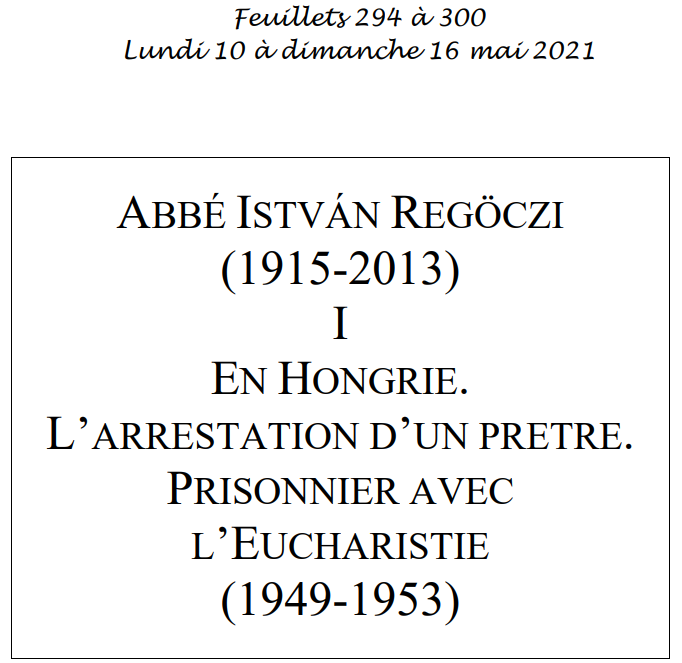




 Introït « vocem iucunditatis : « Que le cri de la joie résonne et que tous l’entendent : Alléluia ! Annoncez-le jusqu’aux extrémités de la terre : le Seigneur a racheté son peuple, Alléluia, Alléluia ». De nouveau, nous chantons le cantique de l’action de grâces pour la délivrance de l’exil. C’est le psaume 65, le canticum resurrectionis.
Introït « vocem iucunditatis : « Que le cri de la joie résonne et que tous l’entendent : Alléluia ! Annoncez-le jusqu’aux extrémités de la terre : le Seigneur a racheté son peuple, Alléluia, Alléluia ». De nouveau, nous chantons le cantique de l’action de grâces pour la délivrance de l’exil. C’est le psaume 65, le canticum resurrectionis.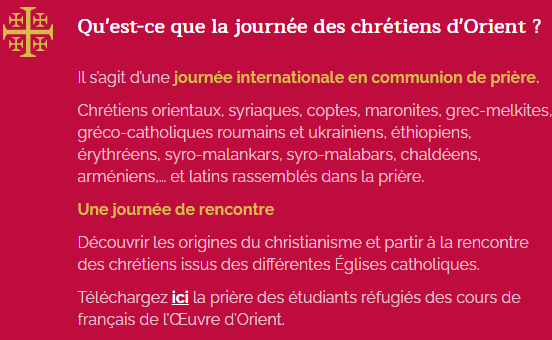
 Mgr Paluku Sikuli Melchisédech, évêque du diocèse de Butembo-Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), dénonce la faillite de son gouvernement face aux défis auxquels il est confronté. Des terroristes chassent de chez elles les populations autochtones, des trafiquants exploitent les ressources minières congolaises, sans être inquiétés. Entretien:
Mgr Paluku Sikuli Melchisédech, évêque du diocèse de Butembo-Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), dénonce la faillite de son gouvernement face aux défis auxquels il est confronté. Des terroristes chassent de chez elles les populations autochtones, des trafiquants exploitent les ressources minières congolaises, sans être inquiétés. Entretien: