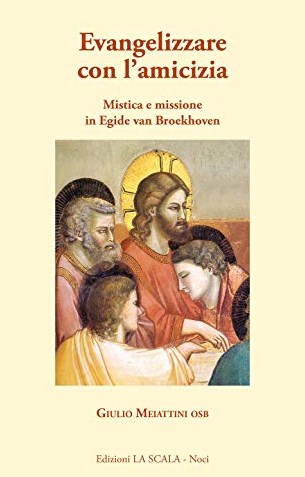De Vatican News :
François: «Le monde est en guerre, il s’autodétruit, arrêtons-nous!»
«Le monde entier est en guerre, s’autodétruit, arrêtons-nous à temps!» Le Pape François, aux côtés de l'archevêque de Canterbury Justin Welby, et du modérateur de l’assemblée générale de l'Église d'Écosse Iain Greenshields, s'entretient avec des journalistes sur le vol de retour du Soudan du Sud. Dans de nombreux cas, ils répondent ensemble aux questions. C'est l'occasion pour François non seulement de rappeler «l'injustice» de la criminalisation des homosexuels, mais aussi de parler de la mort du Pape émérite Benoît XVI, dont le décès le 31 décembre a été accompagné de reconstitutions polémiques l'opposant à son successeur: «sa mort a été instrumentalisée» par des personnes «partisanes et non par l'Église». Le Pape a également expliqué que son prédécesseur, qu'il a consulté à plusieurs reprises au fil des ans, «n'a pas été aigri par ce que j'ai fait». En ouvrant la discussion, aux côtés de Justin Welby et de Iain Greenshields, François a répété qu’il venait d’effectuer «un voyage œcuménique» et c'est pourquoi «j'ai voulu qu'ils soient tous les deux présents à la conférence de presse». En particulier l'archevêque de Canterbury, qui est depuis des années sur ce chemin de la réconciliation au Soudan du Sud.
Justin Welby
En janvier 2014, mon épouse et moi-même avons visité le Soudan du Sud dans le cadre d'un voyage de la Communion anglicane, et en arrivant l'archevêque nous a demandé d'aller dans une ville appelée Bora. La guerre civile durait depuis 5 semaines à l'époque et était très féroce. Lorsque nous sommes arrivés à Bor, à l'aéroport, les premiers cadavres étaient à l’entrée. Il y avait 5 000 cadavres non enterrés à Bor à l'époque. Les Nations unies étaient là. Nous sommes allés à la cathédrale où tous les prêtres avaient été tués et les femmes violées et assassinées. C'était une situation horrible. Sur le chemin du retour, ma femme et moi avons ressenti un profond appel à voir ce que nous pouvions faire pour soutenir le peuple du Soudan du Sud. Depuis lors, à l’occasion de l'une des rencontres régulières que j'ai le privilège d'avoir avec le Pape François, nous avons beaucoup parlé du Soudan du Sud et développé l'idée d'une retraite au Vatican. Mon équipe à Lambeth et le Vatican ont travaillé ensemble, se sont rendus au Soudan du Sud en 2016, ont travaillé sur le terrain et ont travaillé avec les dirigeants pour essayer d'organiser cette visite. Ma femme a travaillé avec des femmes responsables communautaires et des épouses d'évêques. Nous avons rendu visite à des dirigeants en exil en Ouganda. En 2018, il est devenu évident qu'il y avait une possibilité de visite début 2019 et nous avons réussi à la faire. C'est un miracle que cela se soit produit.
L'un des deux vice-présidents était assigné à résidence à Khartoum. Je me souviens que 36 heures plus tôt, sur le parking d'une école à Nottingham, j'avais parlé au secrétaire général des Nations unies pour qu'il lui délivre un visa, ce qu'il a fait brillamment, et il a réussi à partir juste avant que l'espace aérien ne soit fermé par un coup d'État. Le moment charnière de la rencontre de 2019 a été, bien sûr, le geste inoubliable du Pape qui s'est agenouillé et a embrassé les pieds des dirigeants pour plaider en faveur de la paix, et ils ont essayé de le freiner. C'était un moment extrêmement remarquable. Nous avons eu des discussions difficiles, mais en fin de compte, ils se sont engagé à renouveler l'accord de paix et je pense que le geste du Pape a été le moment clé, le tournant. Mais comme le dit un entraîneur, vous êtes bon jusqu'au prochain match. Et la Covid a reporté le match suivant. Je pense que le résultat a été une perte d'élan. Lors de la préparation de cette visite, nos équipes se sont remises au travail mais elles étaient moins confiantes qu'en 2019. Cependant j'ai terminé cette visite avec un profond sentiment d'encouragement, non pas tant parce qu'il y a eu une percée mais parce qu'on a eu le sentiment, comme l'a dit le Pape, d'un cœur qui parle au cœur. Ce n'est pas au niveau intellectuel qu'il y a eu des contacts dans les différentes réunions, le cœur a parlé au cœur. Il y a un élan au niveau intermédiaire et à la base, et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un changement d'avis sérieux de la part des dirigeants. Ils doivent accepter un processus qui mène à une transition pacifique. Nous l'avons dit publiquement, il doit y avoir un effort de lutte contre la corruption et la contrebande pour contrer l'énorme accumulation d'armes. Il faudra continuer à travailler ensemble, avec le Vatican et avec la troïka, pour que cette porte ouverte, qui n'est pas aussi ouverte que je le souhaiterais mais qui l'est, s'ouvre en grand et permette de progresser. Dans deux ans, il y aura des élections, nous avons besoin de progrès sérieux d'ici la fin de 2023.
Iain Greenshields
Mon expérience est très différente, c'était la première fois que je me rendais au Soudan du Sud, mais mon prédécesseur y était allé et l'avait trouvé vulnérable. La réconciliation était au cœur de la rencontre que nous avons eue en 2015. En tant qu'Église presbytérienne, nous avons aidé les réfugiés du Soudan du Sud. Lors de ce voyage, comme mentionné, la vérité a été dite avec le cœur. La situation est maintenant claire, les actions parlent plus fort que les mots. Le gouvernement nous a invités à entrer dans la pièce et nous nous sommes engagés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire la différence dans cette situation, à rencontrer nos partenaires, et maintenant nous demandons à ceux qui peuvent faire la différence d'entamer de toute urgence le processus.
Première question, du père Jean-Baptiste Malenge (RTCE-Radio catolique Elikya ASBL)
Saint-Père, vous avez longtemps désiré visiter la République démocratique du Congo. Maintenant tout le pays rayonne de la joie que vous venez d'y semer. Quelle importance accorderez-vous désormais à l'accord signé en 2016 entre le Saint-Siège et la RDC sur l'éducation et la santé?
 Selon la Libre Afrique le pouvoir qui espérait capitaliser sur ce voyage en vue des prochaines élections a été secoué par les discours de François. C’est du moins le point de vue du politologue Jean-Claude Mputu (issu de l’Université de Liège, nde Belgicatho) :
Selon la Libre Afrique le pouvoir qui espérait capitaliser sur ce voyage en vue des prochaines élections a été secoué par les discours de François. C’est du moins le point de vue du politologue Jean-Claude Mputu (issu de l’Université de Liège, nde Belgicatho) : Ce voyage papal permet aussi au cardinal Ambongo, le successeur de Laurent Monsengwo, de reprendre sa position centrale sur l’échiquier national. L’homme, originaire de l’Équateur, s’est souvent montré très critique face au pouvoir tout en étant moqué par celui-ci et pointé du doigt par les diplomates en poste à Kinshasa pour qui il était mal venu de critiquer le patron de la Ceni. “Pour nombre de diplomates, l’essentiel est d’organiser les élections dans le respect du calendrier. La qualité importe peu”, explique un expert électoral qui avoue “son plaisir d’entendre les mots du pape. Il va obliger tout le monde à se remettre sur de bons rails. On ne peut pas faire n’importe quoi au nom d’un statu quo qui arrangerait tout le monde sur le dos du peuple. C’est insupportable. Oui, il faut avoir un regard critique sur l’organisation de ce scrutin. Oui, il faut oser dire qu’on va droit dans le mur.”
Ce voyage papal permet aussi au cardinal Ambongo, le successeur de Laurent Monsengwo, de reprendre sa position centrale sur l’échiquier national. L’homme, originaire de l’Équateur, s’est souvent montré très critique face au pouvoir tout en étant moqué par celui-ci et pointé du doigt par les diplomates en poste à Kinshasa pour qui il était mal venu de critiquer le patron de la Ceni. “Pour nombre de diplomates, l’essentiel est d’organiser les élections dans le respect du calendrier. La qualité importe peu”, explique un expert électoral qui avoue “son plaisir d’entendre les mots du pape. Il va obliger tout le monde à se remettre sur de bons rails. On ne peut pas faire n’importe quoi au nom d’un statu quo qui arrangerait tout le monde sur le dos du peuple. C’est insupportable. Oui, il faut avoir un regard critique sur l’organisation de ce scrutin. Oui, il faut oser dire qu’on va droit dans le mur.”