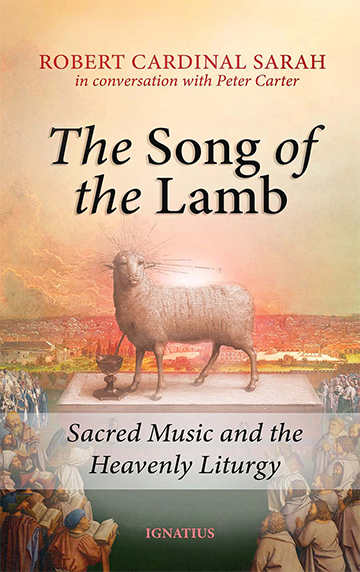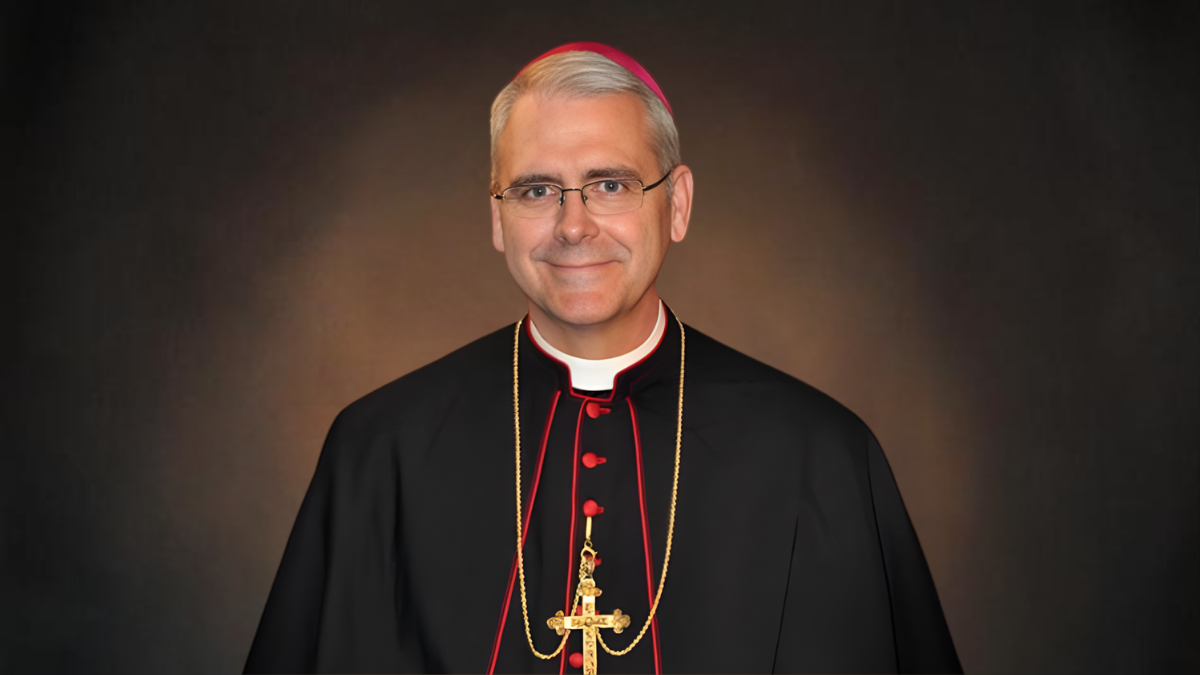D'InfoVaticana :
Le mariologue Salvatore M. Perrella remet en question la validité doctrinale de Mater Populi Fidelis.
Le célèbre mariologue italien Salvatore M. Perrella, l'une des voix les plus influentes dans les études contemporaines sur la Vierge Marie, a proposé une lecture critique de la Note Mater Populi Fidelis , publiée par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi. Dans un long entretien accordé à la RAI, la chaîne de télévision suisse, le théologien souligne que ce document interprète la mariologie selon un cadre « excessivement christologique » et est « trop dépendant » de la perspective du pape François, omettant ainsi des dimensions essentielles à la compréhension de la place de Marie dans l'économie du salut.
Selon Perrella, la Note doctrinale « ouvre des débats nécessaires », mais révèle de graves déséquilibres internes. À son avis, le texte élimine pratiquement les dimensions ecclésiologiques, anthropologiques, trinitaires et symboliques de la mariologie, la traitant uniquement d’un point de vue fonctionnel au Christ. Cette lacune, affirme-t-il, appauvrit la compréhension de la tradition et empêche de proposer une vision globale de la foi.
L'importance de la mémoire doctrinale : un vide qui affaiblit la Note
Perrella souligne que l’explication magistérielle de la coopération de Marie à l’œuvre de rédemption devrait s’appuyer sur les développements doctrinaux survenus après la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception, par lequel théologiens et papes – de Léon XIII à Pie XII – ont reconnu en Marie un fruit de la miséricorde divine et un sujet de mission au sein du plan du salut. Il estime toutefois que le nouveau document ne reflète pas suffisamment cette évolution ni le contexte historique qui la sous-tend.
Le titre « Co-Rédemptrice » : tradition, nuances et réductionnismes
Un des points centraux de l'entretien est la critique de l'emploi du titre de « Co-Rédemptrice ». Perrella critique ce terme, tout en reconnaissant sa présence dans l'enseignement post-conciliaire, notamment sous saint Jean-Paul II, qui a utilisé à la fois ce titre et des expressions équivalentes. « En tant que théologien, je ne peux l'ignorer », affirme-t-il.
Il condamne toutefois la manière dont Mater Populi Fidelis rejette ce titre en se fondant exclusivement sur des déclarations de François, sans tenir compte de la tradition théologique et magistérielle antérieure. Le mariologue rappelle que Lumen Gentium a opté pour une méthode intelligente : embrasser le vocabulaire précédent sans l’absolutiser ni le répudier. À son avis, la Note de la Doctrine de la Foi fait précisément l’inverse : elle stigmatise certaines expressions traditionnelles sans proposer d’alternatives doctrinalement plus solides.
Préoccupation œcuménique disproportionnée et perte de la « sobriété » romaine
Un autre aspect souligné par Perrella est la préoccupation œcuménique, qu'il juge légitime mais disproportionnée. Selon lui, la Note sacrifie la profondeur doctrinale pour éviter les tensions avec d'autres confessions chrétiennes, ce qu'il qualifie d'« erreur ». Il ajoute que le texte souffre d'une longueur excessive et d'un manque de sobrietas , caractéristique du magistère romain traditionnel.
Un argument incohérent : des explications excessives ?
Le théologien critique notamment le raisonnement du paragraphe 22, où le Dicastère soutient qu'un titre exigeant une trop grande explication catéchétique perd de son utilité. Perrella juge cette logique intenable, car, selon ce critère, des titres essentiels tels que « Mère de Dieu », « Immaculée » ou « Mère de l'Église », qui requièrent tous une élaboration théologique approfondie, devraient également être abandonnés. « C'est précisément le rôle de la théologie et de la catéchèse », affirme-t-il.
La crise doctrinale actuelle : Marie comme clé pour retrouver la pleine foi
Le mariologue avertit que le problème de fond n'est pas Marie, mais bien la crise doctrinale contemporaine elle-même. « Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne croient plus ni à la Trinité, ni à la divinité du Christ », souligne-t-il. Dans ce contexte, la figure de Marie « est seconde, mais non secondaire », comme l'a rappelé Benoît XVI, et une juste compréhension de son rôle contribuerait à restaurer la cohérence interne de la foi. Cependant, il reproche au document de proposer une vision « trop monophysite », incapable de soutenir cette entreprise.
Manque de spécialistes pour la préparation du document
Perrella déplore également le manque d'expertise dans la rédaction de la Note. Selon lui, un document de cette nature aurait dû faire appel à des spécialistes en mariologie, en dogmatique et en tradition magistérielle. Le résultat final, affirme-t-il, ne reflète pas la rigueur qui a historiquement caractérisé le Dicastère pour la Doctrine de la Foi.