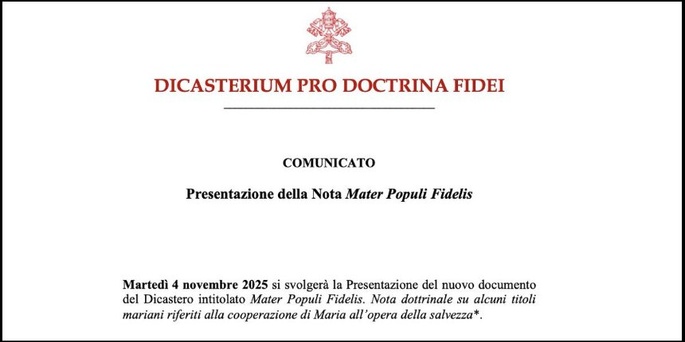De Hermann Geissler sur la NBQ :
Newman, la lumière du dogme n'est pas une cage mais un guide
Le saint anglais converti de l'anglicanisme au catholicisme est un Docteur de l'Église. À la mentalité de son époque et de la nôtre, qui réduit la religion à une simple opinion, il s'est opposé à la « vérité vivante qui ne vieillit jamais ». Extrait du numéro de novembre de La Bussola Mensile .

Saint John Henry Newman est Docteur de l'Église. Ce théologien anglais de renom a pressenti nombre des défis de notre époque et s'est courageusement engagé au service de la Vérité. Lorsqu'il reçut l'investiture pour sa nomination comme cardinal en 1879, il prononça un discours où il résumait l'engagement fondamental de sa vie : « Je me réjouis de dire que, dès le début, je me suis opposé à un grand mal. Pendant 30, 40, 50 ans, j'ai résisté de toutes mes forces à l'esprit du libéralisme. Jamais la Sainte Église n'a eu autant besoin d'être défendue contre lui qu'à notre époque où il est devenu une erreur se propageant comme un piège sur toute la terre. » (...)
Newman naquit le 21 février 1801 à Londres. Dès son plus jeune âge, les Saintes Écritures lui inculquèrent des valeurs morales élevées, mais son potentiel intellectuel exigeait une orientation plus claire. Dès son plus jeune âge, à quatorze ans seulement, il fut tenté par l'autosuffisance, désirant « être vertueux, mais non religieux ; je ne comprenais pas ce que signifiait aimer Dieu ». Tandis qu'il luttait avec ces pensées, Dieu frappa à son cœur. Pendant les vacances de 1816, il lut « La Force de la Vérité » de Thomas Scott et vécut sa « première conversion » : une prise de conscience aiguë de l'existence de Dieu. (...)
Dès cette première conversion, Newman s'efforça de suivre fidèlement la lumière de la Vérité : « À quinze ans, un grand changement d'idées s'opéra en moi. J'étais influencé par un credo précis et j'ai reçu en moi certaines impressions de dogme qui, par la miséricorde de Dieu, ne se sont jamais effacées ni obscurcies depuis. » Il commença alors à saisir l'importance des grandes vérités chrétiennes : l'incarnation du Fils de Dieu, l'œuvre de rédemption, le don du Saint-Esprit qui habite dans l'âme des baptisés, la foi qui ne peut demeurer une simple théorie, mais doit se traduire en un programme de vie.
« Le principe dogmatique ». Après ses études universitaires, Newman fut élu professeur à l'Oriel College en 1822.Originaire d'Oxford, il fut ordonné pasteur anglican et devint vicaire de St. Mary's, l'église universitaire d'Oxford. Il entreprit également la lecture systématique des Pères de l'Église, dans lesquels il découvrit la fraîcheur de l'Église ancienne. Parallèlement, il s'inquiétait de plus en plus de l'influence du libéralisme religieux à Oxford et dans toute l'Angleterre. (...) « Ce que je combattais, c'était le libéralisme, et par libéralisme, j'entends le principe anti-dogmatique avec toutes ses conséquences… Depuis l'âge de quinze ans, le dogme a été le principe fondamental de ma religion : je ne connais aucune autre religion ; je ne peux comprendre aucune autre forme de religion ; une religion réduite à un simple sentiment est pour moi un rêve et une illusion. De même qu'il ne peut y avoir d'amour filial sans l'existence d'un père, il ne peut y avoir de dévotion sans la réalité d'un Être suprême. »