 Il n’est pas trop tard pour 2019: les vœux imprécatoires de Mgr Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, valent le détour: pour les bonnes résolutions, que chacun s’examine. Lu sur le site web « riposte catholique » :
Il n’est pas trop tard pour 2019: les vœux imprécatoires de Mgr Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, valent le détour: pour les bonnes résolutions, que chacun s’examine. Lu sur le site web « riposte catholique » :
« Cette année, je le dis et je le souhaite, ne sera ni bonne ni bénie pour les méchants. La Parole de Dieu est suffisamment limpide sur ce point : le Seigneur garde les pas de ses fidèles, MAIS Il se lève contre l’engeance des méchants (Is 31,2), Il les fait disparaître (1Sam 2,9), les retranche du pays (Pr 2,22 ; 10,3), les extirpe (Ps 37,9), met fin à leur agitation (Jb 3,17) et à leur arrogance (Is 13,11), Il brise leur bâton (Is 14,5), les fait trébucher (So 1,3) chanceler, succomber (Ps 27,2) et les écrase sur place (Jb 40,12). Ces paroles ne sont pas tendres pour un début d’année et pour des vœux. Mais elles ont le mérite d’être claires sur les vœux que le Seigneur lui-même formule pour son peuple depuis la nuit des temps.
Inutile de souhaiter à tout va « bôn’ané bôn’santé, amouréréussite, fwa en JéziKri » car nous savons bien que l’année ne sera bonne ni pour les riches, ni pour les bien-portants, ni pour ceux qui réussiront, ni même pour les amoureux ou les croyants, s’il n’y a pas, dans notre pays, davantage de fraternité, de bonté, de vérité, de pardon, de douceur, de solidarité, de guérison, sans parler du souci du Bien-Commun, de la prière, du silence, de l’écoute, de la générosité, ou encore de la chasteté, de la politesse et de la bienveillance.
Qui peut être heureux, qui peut passer une Bonne Année, quand on se sent menacé partout par la méchanceté, le mépris, l’individualisme, les complots, les propos venimeux, le mensonge, la vanité, l’orgueil, la luxure, les divisions, la violence, le vacarme … ?
Ce disant, je ne parle pas que des païens. C’est à mes frères chrétiens de toutes confessions, et en particulier aux catholiques pratiquants et engagés, que je m’adresse. Certains d’entre nous se laissent aller à des attitudes mauvaises, non seulement dans leur famille ou leur vie sociale, mais aussi au sein de l’Église ou lorsqu’ils la représentent devant d’autres. Des fidèles sont parfois capables de se montrer d’autant plus violents et méchants que leur responsabilité dans la communauté chrétienne et leur fréquentation de leur Église leur donne bonne conscience, se montrant d’autant plus arrogants qu’ils se croient légitimés par une certaine supériorité… Malheur ! Ont-ils oublié que la prière des méchants est une abomination pour le Seigneur (Pr 15,8) !?
Même s’il se trouve de « bonnes » justifications humaines pour manquer à la charité, un chrétien qui se montre violent, méprisant et distant avec ses collègues est un hypocrite : « celui qui n’aime pas son frère qu’il voit ne saurait aimer son Dieu qu’il ne voit pas » (1Jn 4,20). Une personne de l’Église qui se montre violente au cours d’un conflit de voisinage, alors qu’elle proclame la Parole de Dieu, commet un blasphème autant qu’une abomination : « tu ne prononceras pas à tort le nom de ton Dieu » (Ex 20,7). Un croyant qui, pensant être dans son bon droit, critiques sans cesse les autres et colporte des médisances et des calomnies, n’est pas quelqu’un qui craint Dieu : « ne jugez pas pour ne pas être jugés » (Mt 7,1). Un responsable d’Église qui, du haut de sa fonction, traite les autres fidèles avec mépris, est un « sépulcre blanchi » (Mt 23,27) : etc… Tous ceux-là seront jugés plus durement que les habitants de Sodome et Gomorrhe.
On peut duper un évêque, un curé ou un pasteur par une attitude mielleuse, mais on ne trompe pas Dieu ! Les baptisés qui n’imitent pas Jésus Christ ne seront pas excusés parce qu’ils prient et servent l’Église H24 : bien au contraire, cela ne rendra que plus sévère leur condamnation. Comment le Seigneur pourrait-il accorder sa grâce à ceux qui ajoutent le scandale au péché, contristent l’Esprit-Saint et empoisonnent le Corps du venin de la méchanceté ?! Je le répète : « le jugement sera sans Miséricorde pour qui n’a pas fait Miséricorde » (Jc 2,13). Travailler à faire passer aux autres une très mauvaise année 2019, c’est se préparer pour soi-même une très mauvaise éternité.
Que 2019 soit donc une année de guérison de nos méchancetés. « La cognée est à la racine » (Mt 3,10), mais il est encore temps : convertissons-nous !
Ref .Mauvaise Année aux méchants !
JPSC




 Découvrez une liturgie grégorienne paisible, chaque jour de la semaine, au cœur de la ville de Liège: à église du Saint-Sacrement, Bd d’Avroy, 132, les lundi, mercredi et vendredi, à 18h00 ; mardi, jeudi et samedi, à 8h30. Plus d’information, voir ici :
Découvrez une liturgie grégorienne paisible, chaque jour de la semaine, au cœur de la ville de Liège: à église du Saint-Sacrement, Bd d’Avroy, 132, les lundi, mercredi et vendredi, à 18h00 ; mardi, jeudi et samedi, à 8h30. Plus d’information, voir ici :  Il n’est pas trop tard pour 2019: les vœux imprécatoires de Mgr
Il n’est pas trop tard pour 2019: les vœux imprécatoires de Mgr 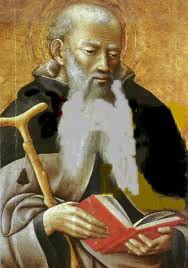
 Il y a certes eu bien des modifications dans les liturgies catholiques, au cours des siècles, telle, pour la liturgie romaine, la synthèse romano-franque commencée au VIIIe siècle et achevée au XIe siècle, qui a vu une hybridation entre le rite vieux-romain et les rites des pays francs et germaniques. Quant au terme de réforme, qui désigne traditionnellement dans l’Eglise, un phénomène de rénovation disciplinaire, doctrinale et spirituelle (réforme grégorienne, réforme tridentine, par exemple), il a pu s’accompagner d’un versant liturgique (pour la réforme tridentine, l’édition des livres romains comme livres « canoniques » pour l’ensemble de l’aire latine). On peut parler à ce titre de réforme liturgique, mais cela n’a rien à voir avec la réforme liturgique de Vatican II. Celle-ci relève plutôt d’une réforme sous un mode d’inculturation, d’adaptation des formes cultuelles à une civilisation qui reçoit la mission catholique, comme cela s’est produit pour permettre l’accès des Slaves à la liturgie byzantine via le slavon ancien, lors de l’évangélisation des saints Cyrille et Méthode, au IXe siècle.
Il y a certes eu bien des modifications dans les liturgies catholiques, au cours des siècles, telle, pour la liturgie romaine, la synthèse romano-franque commencée au VIIIe siècle et achevée au XIe siècle, qui a vu une hybridation entre le rite vieux-romain et les rites des pays francs et germaniques. Quant au terme de réforme, qui désigne traditionnellement dans l’Eglise, un phénomène de rénovation disciplinaire, doctrinale et spirituelle (réforme grégorienne, réforme tridentine, par exemple), il a pu s’accompagner d’un versant liturgique (pour la réforme tridentine, l’édition des livres romains comme livres « canoniques » pour l’ensemble de l’aire latine). On peut parler à ce titre de réforme liturgique, mais cela n’a rien à voir avec la réforme liturgique de Vatican II. Celle-ci relève plutôt d’une réforme sous un mode d’inculturation, d’adaptation des formes cultuelles à une civilisation qui reçoit la mission catholique, comme cela s’est produit pour permettre l’accès des Slaves à la liturgie byzantine via le slavon ancien, lors de l’évangélisation des saints Cyrille et Méthode, au IXe siècle.