De Nicolas Boutin sur le site Aleteia.org :
Eric Célérier : « Billy Graham voulait annoncer l’Évangile par tous les moyens ! »
Éric Célérier, pasteur et fondateur de Topchrétien.com, a travaillé avec l'influent prédicateur Billy Graham décédé le 21 février à l'âge de 99 ans. Il décrit pour Aleteia son oeuvre et confie également des souvenirs plus personnels.
C’était le le télévangéliste le plus connu au monde. L’américain Billy Graham est décédé mercredi 21 février à l’âge de 99 ans. Ordonné pasteur en 1939, il multiplie les prêches aux quatre coins de la planète grâce à une fois chevillée au corps et un authentique charisme. Il attire très vite les foules.
De la reine Elizabeth au pape Jean-Paul II, en passant par Mère Teresa, cette véritable pop-star de la Bible avait rencontré tous les grands de ce monde et jouissait d’une certaine influence auprès de quelques un des présidents américains qui se sont succédés depuis les années 1950. A cette époque, ce pasteur baptiste avait a su habilement utiliser la radio et la télévision. Éric Célérier, proche du pasteur nous livre ses sentiments.
Aleteia : Quel rôle a joué Billy Graham dans votre cheminement spirituel ?
Éric Célérier : Mon parcours de foi s’est fait en deux étapes. J’ai grandi dans une famille catholique, j’ai suivi des cours de catéchisme, fait ma communion… Adolescent plutôt rebelle, j’ai redécouvert la foi à l’âge de 18 ans, dans une église évangélique. C’est là que j’ai commencé à servir Dieu avec ce que je pouvais : la guitare, l’animation de groupes de jeunes, la prêche… Quand j’ai été embauché par Billy Graham, j’étais en fait un jeune converti à la « foi vivante ». Il a été mon premier patron, j’avais 20 ans. J’ai travaillé onze mois pour préparer sa campagne d’évangélisation à Paris en 1986. Je timbrais les lettres ! Lorsqu’il prêchait, j’étais derrière lui sur l’estrade : ses mots m’ont touché et j’ai alors prié pour devenir comme cet homme. En l’écoutant, j’ai compris que l’on pouvait investir de sa vie et de son temps dans un projet chrétien et en voir les fruits. Des milliers de personnes étaient présentes à cet événement, ça a marqué ma vie pour toujours. Je me suis dit qu’il était possible de faire des choses pour servir Dieu et changer la vie des gens. À cette époque, la France considérait les évangélistes comme une secte et après son arrivée tout a changé : il a même été reçu par François Mitterrand. Billy Graham a inspiré beaucoup de monde, il a rassemblé plus de 200 millions d’auditeurs dans 185 pays ! Il voulait annoncer l’Évangile par tous les moyens !
Lire la suite sur aleteia.org
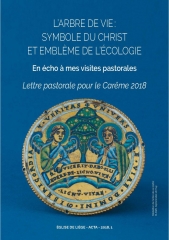 Dans cette Lettre
Dans cette Lettre

