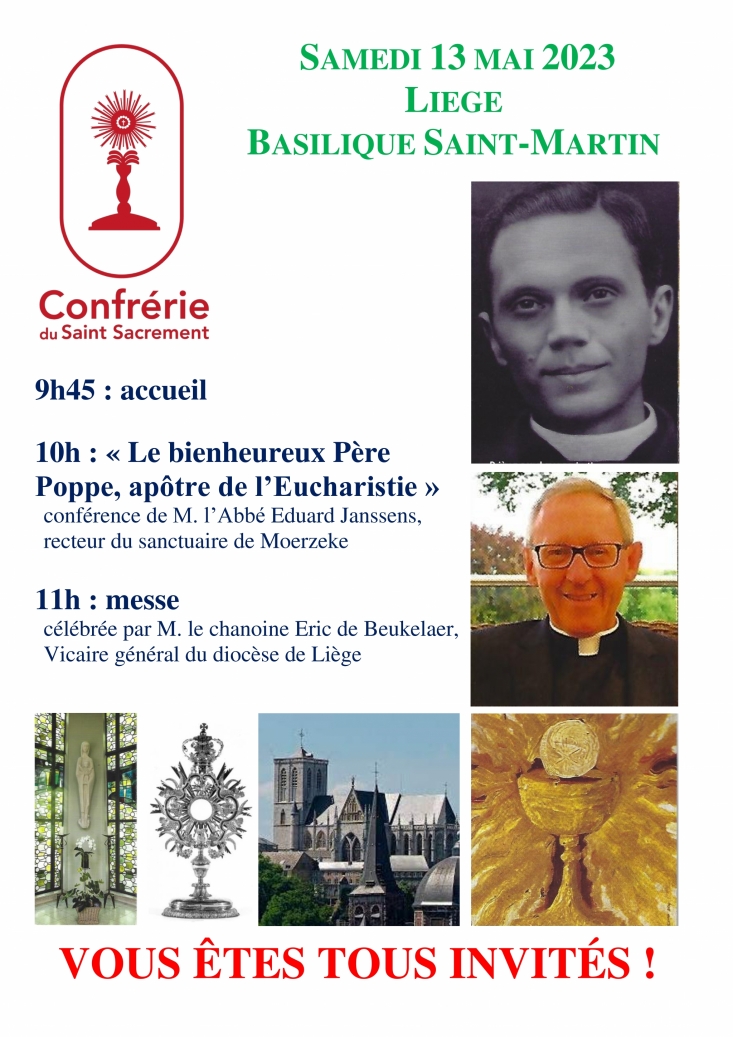D'Edward Pentin sur son site :
Le nombre record de pèlerins à Chartres est un "témoignage étonnant de la popularité du rite traditionnel parmi les jeunes catholiques".
25 mai 2023

Pèlerins marchant sur la dernière ligne droite vers Chartres (Edward Pentin)
Plus de pèlerins que jamais participeront au traditionnel pèlerinage de Chartres cette année - si nombreux que, malgré Traditionis Custodes et les restrictions du pape François sur la messe traditionnelle en latin, les organisateurs ont dû, pour la première fois, clôturer les inscriptions dix jours à l'avance.
Plus de 16 000 pèlerins marcheront de l'église Saint-Sulpice à Paris à la cathédrale Notre-Dame de Chartres pendant le week-end de la Pentecôte, du 27 au 29 mai, soit une distance d'environ 60 miles.
Ce pèlerinage traditionnel et profondément historique, qui remonte au XIIe siècle, a été relancé en 1983 par l'association Notre-Dame de Chrétienté et, ces dernières années, à l'exception de l'époque de Covid, sa popularité n'a cessé de croître.
"Ayant participé au pèlerinage de Chartres chaque année depuis 30 ans, je peux dire qu'il n'y a jamais eu d'attente que le pèlerinage soit complet, étant donné que le centre ville de Chartres est si grand", a déclaré Michael J. Matt, rédacteur en chef du Remnant Newspaper, qui dirige le chapitre américain, c'est-à-dire le groupe de pèlerins. "Le fait que le pèlerinage ait atteint sa capacité maximale cette année n'est rien de moins qu'un témoignage étonnant de la popularité de la messe en latin parmi les jeunes catholiques".
L'année dernière, j'ai eu la chance de participer au pèlerinage pour la première fois (une foule record de 15 000 personnes y a également assisté cette année-là) et j'ai trouvé que c'était une célébration de la foi extrêmement édifiante, une occasion de rencontrer un groupe extrêmement diversifié de jeunes catholiques pour la plupart (l'âge moyen est de 20,5 ans cette année), et de marcher à travers les rues de Paris et la belle campagne française jusqu'à la pittoresque ville médiévale de Chartres.
Comme tous les pèlerinages, celui de Chartres est une métaphore de la vie : le temps est changeant, le soleil chaud de la fin du printemps se mêle aux nuages et aux averses occasionnelles, et le terrain est tantôt plat et facile, tantôt rocailleux et exigeant. L'année dernière, le ciel s'est déchaîné lors de la première journée complète du pèlerinage, transformant une grande partie du chemin en un marécage boueux, mais cela n'a pas entamé les esprits.
Tout au long du parcours, on est accompagné par un esprit de camaraderie vibrant et vivant, et l'aspect pénitentiel du pèlerinage est toujours présent. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un long pèlerinage, le rythme est rapide et la distance à parcourir est relativement courte, ce qui en fait parfois une expérience exténuante, du moins pour les plus âgés d'entre nous.
Cette année, des pèlerins de 28 pays, mais surtout de France, prieront tout au long du chemin, récitant le Rosaire et chantant des chansons. L'année dernière, derrière notre chapitre, nous avions un groupe particulièrement exubérant de Saint-Tropez, en France, dont les chants chaleureux pouvaient presque être entendus sur la Côte d'Azur, tandis que devant nous, des pèlerins portugais se promenaient paisiblement le long du chemin, comme s'ils profitaient d'un dimanche après-midi dans l'Algarve. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que tous les pèlerins ne sont pas catholiques : un petit nombre d'entre eux sont d'autres confessions ou n'en ont aucune.
Environ 300 prêtres et religieux parcourront le chemin cette année et les prêtres seront toujours présents pour entendre les confessions. La messe traditionnelle en latin est, bien entendu, largement disponible. Cette année, le lundi de Pentecôte, l'ancien nonce apostolique en Ukraine et en Suisse, Mgr Thomas Gullickson, offrira la messe pontificale solennelle à Notre-Dame de Chartres en présence de l'évêque de Chartres.
"Nous espérons sincèrement que le Vatican verra dans cet événement une expression non polémique et joyeuse de la jeunesse, de la vitalité et du pouvoir unitif de la messe en latin", a déclaré Michael Matt.
Voir l'excellent documentaire récent de Michael qui explore l'histoire, le présent et l'avenir du pèlerinage :
Pour plus d'informations :
Le pèlerinage traditionnel de Chartres en France est victime de son propre succès
Un nombre record d'inscriptions pour le pèlerinage de Chartres 2023 (français)