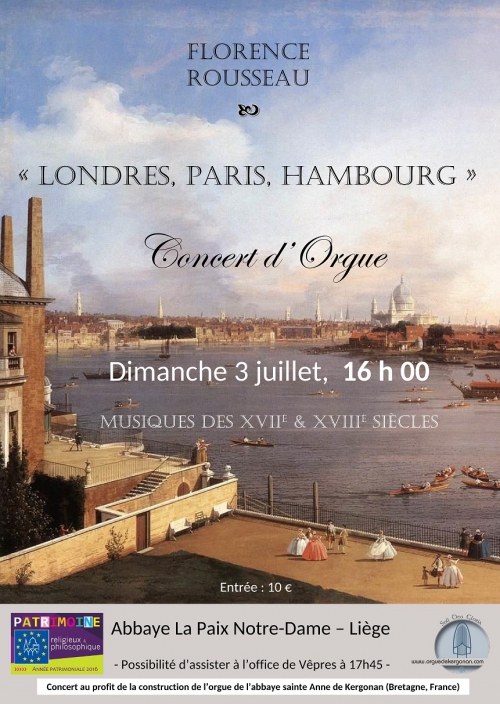Lu sur le site de Radio Vatican :
Une commission historique chargée d'étudier la figure du cardinal Stepinac

Le cardinal croate Alojzije Stepinac. - RV
(RV) La Commission mixte composée d’experts croates et serbes chargée de procéder à une relecture de la vie du bienheureux Alojzije Stepinac s’est réunie pour la première fois ces mardi et mercredi. Cette commission avait été instituée à l’initiative du pape François afin d’ « éclaircir quelques questions de l’histoire ». Dans un communiqué la salle de presse du Saint-Siège précise que les experts catholiques et orthodoxes, seront chargés d’étudier la vie de l’ancien archevêque de Zagreb « avant durant et après la seconde guerre mondiale ».
Selon un communiqué diffusé par ce mercredi par le Vatican, cette commission mixte patronnée par le religieux Mgr Bernard Ardura, président du Conseil pontifical des sciences historiques, a été chargée par le pape de procéder à une relecture commune de la vie du cardinal Stepinac de répondre à l’exigence d’éclaircir certaines questions historiques.Les travaux de la commission, qui se réunira une prochaine fois mi-octobre à Zagreb, devraient durer une douzaine de mois. Au Vatican, on précise d’ores-et-déjà que le résultat de ce travail scientifique basé sur la documentation disponible et sa contextualisation, n’interfèrera pas sur le processus de canonisation qui est de la seule compétence du Saint-Siège.
Une figure controversée
A la tête du diocèse de Zagreb de 1937 à 1960, Mgr Alojzije Stepinac lutta durant la Seconde Guerre mondiale en faveur des droits des personnes persécutées et discriminées. En 1946, il est arrêté sur ordre des autorités communistes, qui ont pris le pouvoir en Yougoslavie, car il rejette l’ordre de Tito de créer une “Eglise nationale serbo-croate“ indépendante de Rome.
Au terme d’un procès très discuté, il est condamné à 16 ans de travaux forcés et emprisonné par les autorités yougoslaves pour collaboration avec le régime pro-nazi Oustachi, et complicité dans la conversion forcée de serbes-orthodoxes au catholicisme. Sa figure restera dès lors très controversée. Mgr Stepinac est créé cardinal en 1952 par Pie XII et fut béatifié en octobre 1998, par Jean Paul II. Il reste à ce jour le premier martyr du régime communiste à avoir été déclaré bienheureux. Lors de son voyage en Croatie en juin 2011, le Pape Benoît XVI avait défendu la figure de l'ancien archevêque de Zagreb, qui "avait su s'élever "contre l'esprit du temps".
C’est « à cause de sa solide conscience chrétienne qu’il a su résister à tout totalitarisme, devenant au temps de la dictature nazie et fasciste le défenseur des juifs, des orthodoxes et de tous les persécutés, et puis, dans la période du communisme, ‘avocat’ de ses fidèles, spécialement de tant de prêtres persécutés et tués» avait rappelé le pape allemand dans un messages aux évêques, prêtres et religieux croates. La prochaine réunion de cette commission se tiendra à Zagreb les 17 et 18 octobre (OB, avec I-media)


 « Le Brexit pourrait poser une question en interne à la Commission des Episcopats de la Communauté européenne (COMECE) puisqu’elle est composée d’évêques délégués des 28 Etats membres de l’Union européenne. Pour le Royaume Uni, elle compte un évêque délégué de la Conférence épiscopale d’Angleterre et du Pays de Galles, et un évêque délégué de la Conférence épiscopale écossaise. Cette question devrait être à l’ordre du jour de de la prochaine assemblée plénière de la COMECE au mois d’octobre 2016 à Bruxelles.
« Le Brexit pourrait poser une question en interne à la Commission des Episcopats de la Communauté européenne (COMECE) puisqu’elle est composée d’évêques délégués des 28 Etats membres de l’Union européenne. Pour le Royaume Uni, elle compte un évêque délégué de la Conférence épiscopale d’Angleterre et du Pays de Galles, et un évêque délégué de la Conférence épiscopale écossaise. Cette question devrait être à l’ordre du jour de de la prochaine assemblée plénière de la COMECE au mois d’octobre 2016 à Bruxelles.