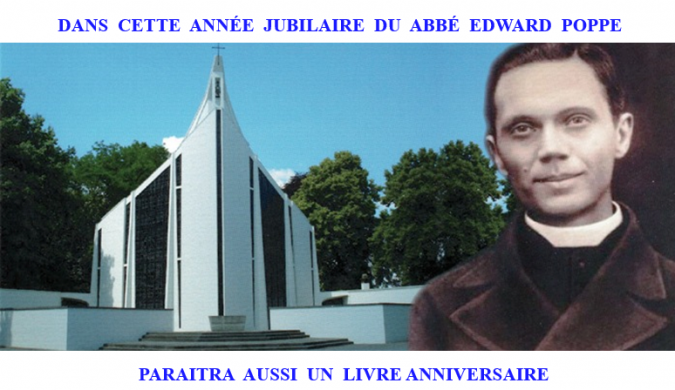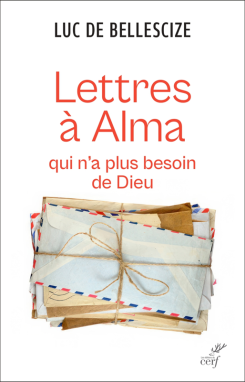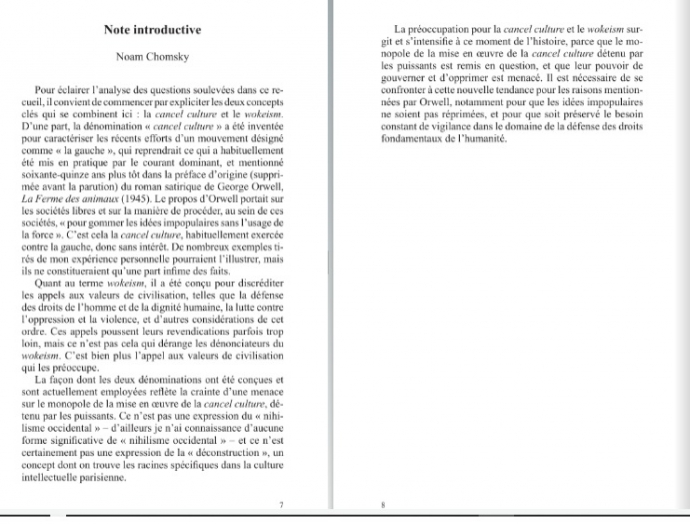De Vatican News :
Autobiographie du Pape François: «Je ne serai jamais appelé pape émérite»
Intitulée Life. Mon histoire dans l'Histoire, l’autobiographie tant attendue du Pape sera publiée en Amérique et en Europe aux éditions HarperCollins. François l'a écrite avec Fabio Marchese Ragona, vaticaniste de groupe italien Mediaset et également ami du Souverain pontife. Elle retrace les quatre-vingt-sept années de la vie de Jorge Mario Bergoglio, entrelacées avec les grands événements de l'histoire, allant d'Hiroshima à la pandémie du COVID-19. Le journal italien Le Corriere della Sera est le premier quotidien au monde à révéler les passages marquants.
Échapper au naufrage
Le Pape François raconte en premier lieu le rôle fondamental joué dans son éducation par sa grand-mère paternelle, Nonna Rosa. «Les grands-parents parlaient le (dialecte, ndlr) piémontais, c'est pourquoi le piémontais a été ma première langue maternelle». Le grand-père Giovanni avait servi pendant la Première Guerre mondiale. Dans les lettres des parents restés à Portacomaro, dans la région d'Asti, les nouvelles de la Seconde Guerre mondiale parviennent à la maison Bergoglio à Buenos Aires: les hommes ne sont pas allés au front, ils sont restés dans les champs pour travailler, et les femmes guettent l'arrivée des inspections militaires: «Si elles avaient porté du rouge, les hommes auraient dû s'enfuir pour se cacher. Les vêtements blancs, en revanche, indiquaient qu'il n'y avait pas de patrouilles et qu'elles pouvaient donc continuer à travailler».
En octobre 1927, la grand-mère Rosa et le grand-père Giovanni, avec leur fils Mario -le père du Pape- devaient partir pour l'Argentine depuis le port de Gênes, sur le bateau Principessa Mafalda. Mais le grand-père n'a pas pu réunir à temps l'argent nécessaire à l'achat des billets et a dû reporter le voyage. Le Principessa Mafalda a coulé au large des côtes brésiliennes et trois cents émigrants se sont noyés. Les Bergoglio partent alors en février 1929, avec le Giulio Cesare. «Deux semaines plus tard, ils arrivent en Argentine et sont accueillis à l'Hotel de Inmigrantes, un centre d'accueil pour migrants qui n'est pas très différent de ceux dont nous entendons parler aujourd'hui».
Hiroshima et Nagasaki
Lors des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945, Jorge Mario Bergoglio est âgé de 8 ans. «Les gens du bar ou de l'oratoire des Salésiens disaient que les Américains -ils les appelaient los gringos- avaient lancé ces engins de mort... L'utilisation de l'énergie atomique à des fins de guerre est un crime contre l'homme, contre sa dignité et contre toute possibilité d'avenir dans notre maison commune. C'est quelque chose d'immoral! Comment pouvons-nous nous ériger en champions de la paix et de la justice si, entre-temps, nous construisons de nouvelles armes de guerre?» Et Jorge Mario Bergoglio de révéler, en réponse à la Curie: «Une fois adulte, en tant que jésuite, j'aurais voulu être missionnaire au Japon, mais on ne m'a pas donné la permission d'y aller à cause de ma santé, qui était un peu précaire à l'époque. Qui sait? Si j'avais été envoyé sur cette terre de mission, ma vie aurait pris un autre chemin; et peut-être que quelqu'un au Vatican aurait été mieux loti qu'aujourd'hui».
La professeure communiste
Esther a marqué le parcours estudiantin du jeune Bergoglio, qui se souvient aujourd’hui de l’enseignante comme «une femme formidable, à qui je dois beaucoup. C'était une vraie communiste, athée mais respectueuse: même si elle avait ses propres idées, elle n'a jamais attaqué la foi. Et elle m'a beaucoup appris sur la politique: elle me donnait des publications à lire, dont celle du parti communiste, Nuestra Palabra... Quelqu'un, après mon élection comme pape, a dit que je parlais souvent des pauvres parce que je serais moi aussi un communiste ou un marxiste. Même un ami cardinal m'a raconté qu'une dame, une bonne catholique, lui a dit qu'elle était convaincue que le Pape François était l'antipape. Pour quelle raison? Parce que je ne porte pas de chaussures rouges! Mais parler des pauvres ne signifie pas automatiquement être communiste: les pauvres sont la bannière de l'Évangile et sont dans le cœur de Jésus! Dans les communautés chrétiennes, les gens partageaient les biens: ce n'est pas du communisme, c'est du pur christianisme!».