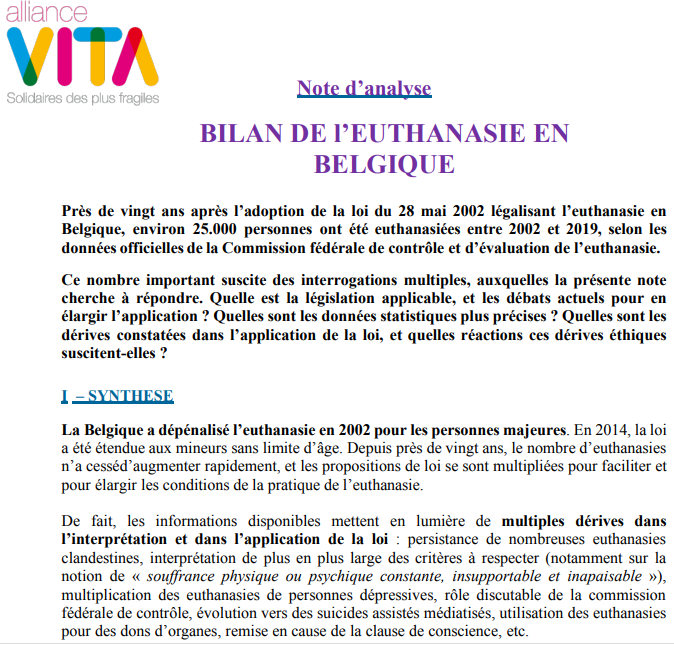De Patricia Gooding-Williams sur le site "Daily Compass" (version anglaise de la Nuova Bussola Quotidiana) :
Le prince qui voulait devenir un virus mortel
17-04-2021
Il a fondé le WWF et, pour sauver l'environnement, aurait volontiers sacrifié une partie de l'humanité, déclarant même qu'il voulait se réincarner en virus mortel. Imprégné de l'idéologie néo-malthusienne, il a hérité et promu la culture eugénique. C'est la facette moins connue du mari de la reine Elizabeth, le prince Philip d'Édimbourg, dont les funérailles ont lieu aujourd'hui.
"Dans l'éventualité où je me réincarnerais, j'aimerais revenir sous la forme d'un virus mortel, afin de contribuer à la résolution de la surpopulation." Cette phrase du prince Philip, dont les funérailles sont célébrées aujourd'hui au château de Windsor, dans le sud de l'Angleterre, met en lumière un aspect important de sa vie qui a été largement négligé par ceux qui commémorent son long héritage après sa mort, le 9 avril 2021.
Contrairement à certaines de ses gaffes, il ne s'agissait pas d'un de ces commentaires improvisés qui ont assailli sa réputation. Au contraire, elle exprimait une conviction profonde qui a déterminé ses engagements durant sa vie active. La citation tirée d'une interview de 1988 confiée à la Deutsche Press-Agentur se retrouve dans de nombreuses autres interviews et conférences qu'il a données sur le thème de la conservation. La sauvegarde de l'environnement était un rôle qu'il assumait avec dévouement et qu'il appelait toutes les personnes en position de pouvoir à assumer également, car par défaut, elles ont un impact direct sur le comportement de ceux qui leur sont inférieurs.
Mais dans le cas hypothétique de sa réincarnation, le fait que le duc d'Édimbourg veuille revenir sous la forme d'un virus mortel pour "guérir" le monde de sa maladie présumée, la surpopulation, en tuant des millions de personnes, a laissé tout le monde pantois. Qui plus est, il a omis de dire si les immenses souffrances qu'il infligerait à ceux qu'il infecterait le préoccupaient un tant soit peu.
Pourtant, le contrôle de la population, comme le suggère son commentaire, n'était pas l'objectif principal du prince Philip, il était le moyen d'atteindre une fin. La préservation d'un environnement durable est sa préoccupation et, à son avis, la croissance démographique incontrôlée est le cancer qui, s'il n'est pas traité, conduira à sa disparition. Il voyait la question de la croissance démographique incontrôlée de la même manière non sentimentale qu'il voyait la nécessité d'abattre les animaux afin de maintenir l'équilibre délicat de la durabilité naturelle. Le Prince Philip a très bien expliqué son point de vue en utilisant l'exemple du succès d'un projet des Nations Unies dans les années 1940 qui a éradiqué la malaria au Sri Lanka. "Ce que les gens ne réalisaient pas, c'est que la malaria contrôlait en fait la croissance de la population. La conséquence a été que la population a doublé en 20 ans environ. Maintenant, il faut trouver quelque chose à faire pour tous ces gens et un moyen de les nourrir."