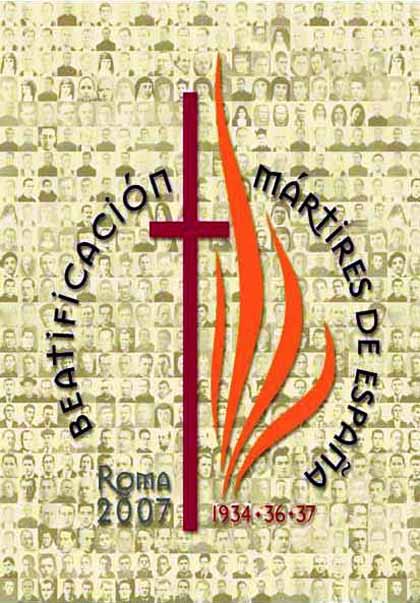En 2015, lors d'un vol retour des Philippines vers le Vatican, le pape François déclara aux journalistes : « Il y a un livre… il s'intitule Le Maître de la Terre. L'auteur est Benson… Je vous suggère de le lire. Sa lecture vous permettra de bien comprendre ce que j'entends par colonisation idéologique. » Il poursuivit en qualifiant le roman de prophétique, notamment au regard des évolutions modernes telles que la laïcité, le relativisme et la notion de « progrès » déconnectée de tout ancrage spirituel ou moral.
Le livre en question, Le Maître de la Terre (1907), est un roman dystopique et apocalyptique écrit par le père Robert Hugh Benson, un Anglais converti. Il imagine un monde du XXIe siècle où le christianisme a largement décliné tandis que l'humanisme séculier – ou « humanitarisme » – a pris le pouvoir, les élites politiques et culturelles s'unissant autour d'un leader charismatique mondial. L'Église – et la papauté – survivent, de justesse, et c'est là le nœud du conflit au cœur de l'intrigue.
C’était pour le moins un choix inhabituel de la part d’un pape. Mais le pape François a réitéré sa suggestion lors d’un discours prononcé à Budapest en 2023, mettant en garde son auditoire issu du monde universitaire et culturel contre un avenir dominé par la technologie – et la menace que cela représente pour la culture et, en fin de compte, pour ce que signifie être humain.
Le prédécesseur du pape François, alors cardinal Joseph Ratzinger, avait également cité « Le Maître de la Terre » lors d'une conférence à Milan en février 1992, le qualifiant d'ouvrage qui « donne matière à réflexion ». Son successeur, le pape Léon XIV, s'exprimant en septembre 2023 en tant que cardinal Robert Prevost, a lui aussi recommandé le roman de Benson, affirmant qu'il met en garde contre ce qui pourrait arriver à un monde sans foi.
Il n'est peut-être pas surprenant que ce roman ait suscité autant d'attention, puisque son intrigue est centrée sur un pontife assiégé à une époque où la religion est attaquée par des élites laïques technologiquement supérieures.
Fils d'un ancien archevêque anglican de Canterbury, Benson se convertit au catholicisme le 11 septembre 1903, à l'âge de 31 ans. Il avait publié plusieurs œuvres de fiction avant Le Seigneur du monde , principalement des romans historiques. Son roman de 1907 marquait donc une rupture à bien des égards et soulève la question : d'où lui venait cette inspiration ?
« À la fin du XIXe siècle, la littérature apocalyptique connaissait une sorte de renaissance, à l'image de l'essor de la science-fiction », explique l'auteure et critique Kristen Van Uden Theriault. Dans un entretien accordé au Register, elle précise que cette période a vu naître une littérature dystopique largement imprégnée d'une perspective laïque positive, tout en distillant des avertissements prophétiques sur les dangers d'un progrès technologique effréné, du collectivisme et du totalitarisme. Elle cite deux œuvres marquantes qui intègrent une dimension religieuse à la littérature dystopique : le Conte allégorique de l'Antéchrist de Vladimir Soloviev (1900) et Le Maître de la Terre de Benson .
Elle perçoit également un lien fascinant entre ce genre et saint John Henry Newman. Newman, contemporain de Benson et lui aussi un converti de renom de l'anglicanisme, avait beaucoup écrit sur l'Antéchrist, s'intéressant principalement à la montée des idéologies erronées qui ont préparé le monde à son avènement.
« Benson et Newman reconnaissaient tous deux les dangers des idéologies modernes — à savoir le communisme, le socialisme et le modernisme, mais aussi le libéralisme, que l’on peut caractériser comme la version tempérée et lente de ces homologues plus radicaux », a poursuivi Thériault.
Au cœur de la mise en garde de Newman, suggérait-elle, se trouve « la tyrannie du subjectivisme » : le désir de réduire la religion à une affaire de conscience personnelle plutôt que de la percevoir comme une vérité objective. Elle affirme que le système fictif de l’humanitarisme de Benson — un substitut athée à la religion — « incarne les forces sociales contre lesquelles Newman nous avait mis en garde. L’ordre social, qui ressemblait jadis à la hiérarchie céleste, est désormais façonné à l’image de l’homme déchu. »
Alors, étant donné que le roman se déroule au XXIe siècle, dans quelle mesure le juge-t-elle prophétique aujourd'hui ? Thériault le considère comme « prémonitoire à bien des égards ». Elle cite les prédictions de Benson concernant un organisme de gouvernance international – semblable à la Société des Nations, puis aux Nations Unies – et l'euthanasie institutionnalisée, notamment au regard de la loi canadienne sur l'aide médicale à mourir.
« Plus profondément, sa description d'une société sans Dieu, guidée par le plaisir, le scientisme et le rejet de Dieu, résonne comme une description de notre siècle. La vie ne vaut rien dans le paysage apocalyptique infernal de Benson, tout comme dans notre culture de mort contemporaine », ajoute-t-elle.
À la fin du roman de Benson, l'Église n'est plus qu'un vestige et l'Antéchrist semble triompher. Pourtant, Thériault estime que le message du livre demeure « celui de tous les écrits véritablement catholiques sur l'Antéchrist : un message d'espoir. Malgré les machinations perfides de l'Antéchrist, nous savons qui l'emporte à la fin. »
En tant que roman suscitant un débat théologique, il fonctionne – mais en tant qu'œuvre de fiction, comment résiste-t-il à l'épreuve du temps aujourd'hui ?
« Au début du XXe siècle, les romans dystopiques et futuristes pullulaient : un amas sombre, déprimant et mal écrit », observait la romancière et universitaire Eleanor Bourg Nicholson . Pourtant, elle trouve le roman de Benson différent.
« À la fois spéculatif et mystique, [cet ouvrage] se distingue pour deux raisons : premièrement, il présente des personnages réels et vivants — des hommes et des femmes crédibles et auxquels on peut s’identifier — et non pas une simple allégorie prosélyte ; et deuxièmement, parce qu’il aborde avec audace la réalité sombre et oppressante que le monde doit et va finir, et qu’il perçoit cette réalité à travers le prisme de la foi. »
L'un des grands atouts du genre spéculatif, expliquait-elle, réside dans la possibilité qu'il offre aux lecteurs de se confronter à des questions morales profondes. « Quelle est la relation de l'homme avec Dieu ? Quel est le but de la religion ? Quel est le sens même de l'existence humaine ? La vie et la mort, le salut et la damnation – ces thèmes se retrouvent au cœur de nombreuses œuvres de ce genre, et ils sont assurément au cœur même du Maître de la Terre. » C'est peut-être là, à elle seule, ce qui explique son attrait auprès des papes et des prélats.
Nicholson perçoit également une dimension prophétique dans le livre, dont elle constate que nombre d'éléments se retrouvent dans la vie moderne. « Benson conçoit l'Antéchrist comme un homme politique affable et inoffensif, une figure charismatique promouvant la "paix" — quelqu'un que l'on peut facilement imaginer séduire le public de nos jours », a-t-elle observé.
S'adressant au Register, l'auteur et éditeur Joseph Pearce considère lui aussi Benson comme « un visionnaire », soulignant que son roman inattendu a ouvert la voie à des œuvres ultérieures telles que Le Meilleur des mondes d'Huxley et 1984 d'Orwell.
« Benson était en avance sur son temps, un pionnier, un avant-gardiste au sens le plus profond du terme », a déclaré Pearce, ajoutant : « Ce livre a manifestement exercé une influence considérable sur le XXe siècle et semble résonner de façon tout aussi inquiétante à notre époque. La pérennité de la pertinence est l'une des marques d'un grand livre, et celui-ci en est assurément un. »
Benson a bien écrit, sinon une suite à proprement parler, du moins un livre avec un thème similaire mais une perspective totalement différente, a noté Pearce.
Il semble qu'il ait écrit son roman futuriste suivant, L'Aube de toutes choses, pour donner une tournure plus optimiste à l'atmosphère sombre du Maître de la Terre. Mais je ne pense pas que l'Apocalypse soit sombre d'un point de vue chrétien. Dans la mesure où le roman se termine sur une note apocalyptique, il annonce le Second Avènement promis par les Écritures.
« Comment cela pourrait-il être autre chose que la plus heureuse des fins ? »