 Belle journée festive le samedi 12 mai dernier pour la clôture du cycle des cours 2011-2012 de l’Académie de Chant grégorien à Liège, une académie qui a vu le jour en 2003 -sans aucun appui officiel, clérical ou autre- et accueilli depuis lors plus de 250 élèves dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement.
Belle journée festive le samedi 12 mai dernier pour la clôture du cycle des cours 2011-2012 de l’Académie de Chant grégorien à Liège, une académie qui a vu le jour en 2003 -sans aucun appui officiel, clérical ou autre- et accueilli depuis lors plus de 250 élèves dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement.
Pour la circonstance, l’Ensemble Vocal « Caliomène » (dir. Ximena Gonzáles) issu du Chœur Grégorien de Paris et l’organiste Patrick Wilwerth s’étaient joints aux 27 élèves de la « cuvée 2012 » dirigés par Stéphan Junker, professeur au conservatoire de Verviers (sans oublier les juniors accompagnés par Patricia Moulan, issue du même conservatoire).
Au programme : un concert et une messe qui ont réuni ensemble un vaste public (près de 300 personnes).
À 16 heures au Boulevard d'Avroy, dans une église (XVIIe siècle) des Bénédictines trop petite pour accueillir tous les auditeurs, un programme éclectique a illustré « les quatre saisons du plain-chant » : grégorien, diaphonie, déchant, plain-chant tardif du XVIIe siècle ont alterné avec le jeu des sonorités baroques du bel orgue « Le Picard »(1737) qui surplombe le chœur des moniales. Une prestation remarquable rehaussée par les voix féminines du chœur parisien, à la fois juvéniles et admirablement posées.
Lors de la messe chantée à 18 heures dans l’église (XVIIIe siècle) du Saint-Sacrement, sur le même Boulevard, le public nombreux et attentif a pu découvrir un Kyriale (ordinaire de la messe) du XIe siècle, très chantant, dont la simplicité et la pureté psalmodiques contrastaient avec de somptueux motets du siècle de Louis XIV et les mélismes ornés du propre grégorien de la messe du cinquième dimanche après Pâques. À l’autel majeur du Saint-Sacrement, tout illuminé d’or et de marbre blanc, le célébrant, revêtu d’une chasuble moirée de même teinte, était secondé par un cérémoniaire et un groupe de jeunes d’une vingtaine d’années, impeccables en soutanes noires et surplis blancs.
sur le même Boulevard, le public nombreux et attentif a pu découvrir un Kyriale (ordinaire de la messe) du XIe siècle, très chantant, dont la simplicité et la pureté psalmodiques contrastaient avec de somptueux motets du siècle de Louis XIV et les mélismes ornés du propre grégorien de la messe du cinquième dimanche après Pâques. À l’autel majeur du Saint-Sacrement, tout illuminé d’or et de marbre blanc, le célébrant, revêtu d’une chasuble moirée de même teinte, était secondé par un cérémoniaire et un groupe de jeunes d’une vingtaine d’années, impeccables en soutanes noires et surplis blancs.
La journée s’est conclue par une rencontre conviviale dans les locaux de réception de l’église et la vente de superbes disques enregistrés par le chœur des moines bénédictins de Triors (dans la Drôme) illustrant l’année liturgique grégorienne au profit de la réhabilitation de l’hôtellerie de leur abbaye.
Pour paraphraser Bernard Slade, à l’an prochain, mêmes lieux, mêmes heures : pour la dixième année consécutive !
Voir à ce sujet: http://eglisedusaintsacrementliege.hautetfort.com .Sur le même sujet, consultez aussi la première page du site du diocèse de Liège ici (cliquez) :300 personnes à Liège pour le chant grégorien
 Belle journée festive le samedi 12 mai dernier pour la clôture du cycle des cours 2011-2012 de l’Académie de Chant grégorien à Liège, une académie qui a vu le jour en 2003 -sans aucun appui officiel, clérical ou autre- et accueilli depuis lors plus de 250 élèves dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement.
Belle journée festive le samedi 12 mai dernier pour la clôture du cycle des cours 2011-2012 de l’Académie de Chant grégorien à Liège, une académie qui a vu le jour en 2003 -sans aucun appui officiel, clérical ou autre- et accueilli depuis lors plus de 250 élèves dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement. sur le même Boulevard, le public nombreux et attentif a pu découvrir un Kyriale (ordinaire de la messe) du XIe siècle, très chantant, dont la simplicité et la pureté psalmodiques contrastaient avec de somptueux motets du siècle de Louis XIV et les mélismes ornés du propre grégorien de la messe du cinquième dimanche après Pâques. À l’autel majeur du Saint-Sacrement, tout illuminé d’or et de marbre blanc, le célébrant, revêtu d’une chasuble moirée de même teinte, était secondé par un cérémoniaire et un groupe de jeunes d’une vingtaine d’années, impeccables en soutanes noires et surplis blancs.
sur le même Boulevard, le public nombreux et attentif a pu découvrir un Kyriale (ordinaire de la messe) du XIe siècle, très chantant, dont la simplicité et la pureté psalmodiques contrastaient avec de somptueux motets du siècle de Louis XIV et les mélismes ornés du propre grégorien de la messe du cinquième dimanche après Pâques. À l’autel majeur du Saint-Sacrement, tout illuminé d’or et de marbre blanc, le célébrant, revêtu d’une chasuble moirée de même teinte, était secondé par un cérémoniaire et un groupe de jeunes d’une vingtaine d’années, impeccables en soutanes noires et surplis blancs. 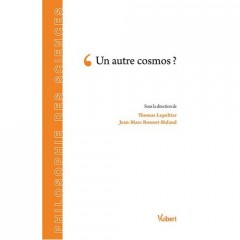 Feu le professeur Marcel De Corte, un esprit peu conventionnel qui nous enseigna jadis les rudiments de la philosophie à l’Université de Liège, avait coutume de se moquer notamment des certitudes aussi péremptoires que successives des théories cosmogoniques et cosmologiques. Un livre récent s’inscrit dans la même veine iconoclaste. Sur son M blog, le journaliste Pierre Barthélémy s’en fait l’écho. Extraits de son entrevue avec l’astrophysicien Jean-Marc Bonnet-Bidaut :
Feu le professeur Marcel De Corte, un esprit peu conventionnel qui nous enseigna jadis les rudiments de la philosophie à l’Université de Liège, avait coutume de se moquer notamment des certitudes aussi péremptoires que successives des théories cosmogoniques et cosmologiques. Un livre récent s’inscrit dans la même veine iconoclaste. Sur son M blog, le journaliste Pierre Barthélémy s’en fait l’écho. Extraits de son entrevue avec l’astrophysicien Jean-Marc Bonnet-Bidaut :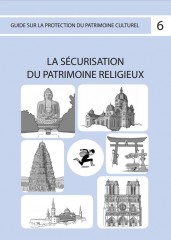 Le Salon Beige relaie cette information :
Le Salon Beige relaie cette information :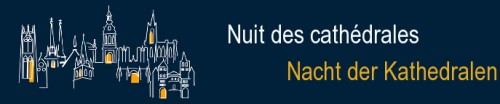
 Le projet « Capella in Collegiale », inspiré du concept « artistes en résidence », est porté par les associations Ensemble Vocal Marignan et Espace Saint-Denis. « Capella in Collegiale » a pour ambition d’organiser chaque année quelques événements essentiellement musicaux mais accordant aussi une part importante au texte et à l’image.
Le projet « Capella in Collegiale », inspiré du concept « artistes en résidence », est porté par les associations Ensemble Vocal Marignan et Espace Saint-Denis. « Capella in Collegiale » a pour ambition d’organiser chaque année quelques événements essentiellement musicaux mais accordant aussi une part importante au texte et à l’image.