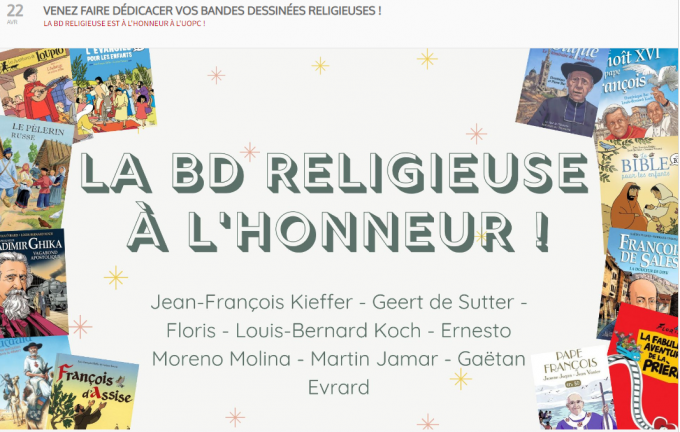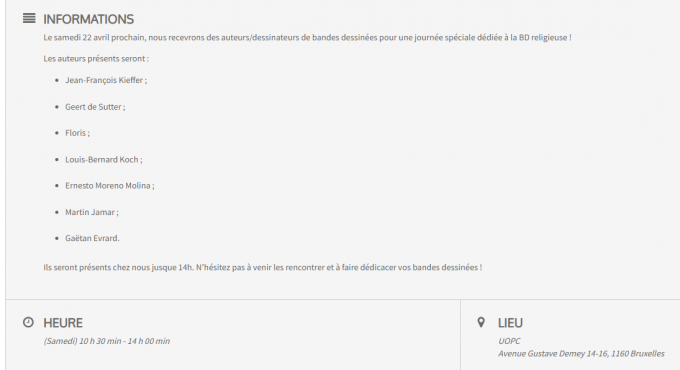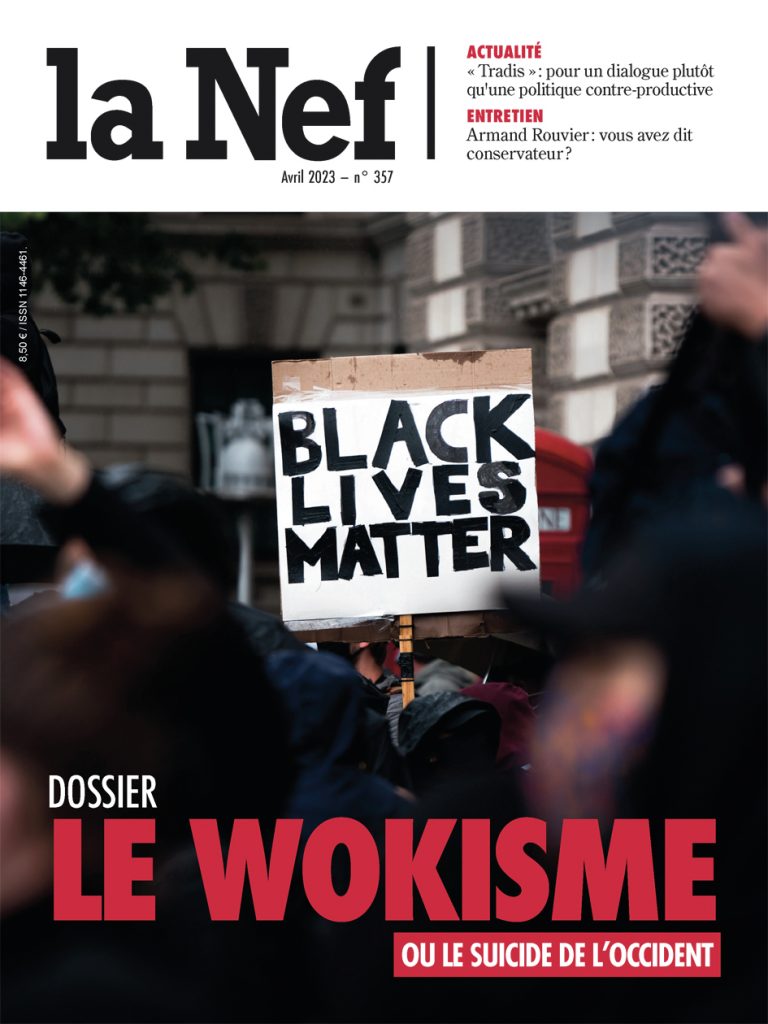De Jean-Marie Guénois sur le site du Figaro :
Comment les jeunes prêtres veulent sortir l’Église de la crise
Avec la baisse des vocations, leur charge de travail s’alourdit toujours plus et ils souffrent parfois d’un manque de soutien. Malgré tout, leur zèle reste intact.
Il s’est passé à Paris un événement de faible impact médiatique mais de haute intensité spirituelle: le décès d’un jeune prêtre. Le 14 mars dernier, l’abbé Cyril Gordien mourait d’un cancer fulgurant. Il avait 48 ans. Il était curé de l’église Saint-Dominique, dans le 14e arrondissement. À ses obsèques, dans l’église Saint-Pierre de Montrouge, dont le haut clocher de pierres blanches marque l’entrée de Paris après la porte d’Orléans, étaient présents 6 évêques, 250 prêtres et près de 2000 fidèles. Sans parler des témoignages venus de toute la France puisque ce prêtre avait été aumônier national du mouvement des Scouts d’Europe.
Cette messe d’adieu a, selon les témoins, marqué par sa densité ceux qui étaient présents. Plus large encore, son «testament spirituel», texte d’une quarantaine de pages écrit par cette âme de feu et intitulé «Prêtre au cœur de la souffrance», continue de rayonner sur internet et ne laisse personne indifférent. Il dénonce sans ambages «des prêtres et même parfois des évêques qui ne cherchent pas le bien et le salut des âmes, mais qui désirent d’abord la réalisation de leurs propres intérêts, comme la réussite d’une “pseudo- carrière”». Et énumère: «Ils sont prêts à tout: céder à la pensée dominante, pactiser avec certains lobbies, comme les LGBT, renoncer à la doctrine de la vraie foi pour s’adapter à l’air du temps, mentir pour parvenir à leurs fins. Le père Gordien confesse alors: «J’ai souffert par l’Église. Dans les différentes crises que j’ai traversées, je me suis rendu compte que les autorités ne prenaient pas soin des prêtres et les défendaient rarement.» Amer, il constate: «Comme prêtre, pasteur et guide de brebis qui vous sont confiées, si vous décidez de soigner la liturgie pour honorer notre Seigneur et lui rendre un culte véritable, il est peu probable que vous soyez soutenu en haut lieu face aux laïcs qui se plaignent».
«Entièrement livré à son ministère»
La charge est lourde. Ses propos ont ravi les uns et mis en colère les autres. Il n’est pas étonnant que ce «testament spirituel», dans lequel il dit également, à longueur de pages, sa joie d’être prêtre, mais sans éluder ses détresses, ait été très vite retiré du site de la Conférence des évêques, où il avait été publié par erreur… Cyril Gordien n’était pourtant pas un prêtre traditionaliste. Il célébrait la messe selon le rituel adopté par le concile Vatican II. Il avait, par exemple, institué une «adoration permanente de l’eucharistie» dans sa paroisse, ce qui avait provoqué l’ire d’un groupe de paroissiens qui ne cessèrent de le dénoncer, dans son dos, à l’archevêché.
Un des amis proches du père Gordien, le père Luc de Bellescize, curé à Paris, a rédigé une lettre ouverte dans laquelle il écrit que son confrère était «excessif», qu’il ne prenait «jamais de repos» parce qu’il était «entièrement livré à son ministère». Il confirme aussi l’existence de «lettres de délation anonymes» reçues contre les prêtres à l’évêché où il a travaillé. «Un désaccord liturgique ou doctrinal, un souci de gouvernement ne constituent pas un crime», souligne le père Luc de Bellescize, avant de conclure: «Ces mots d’un prêtre au cœur de la souffrance doivent être pris au sérieux et invitent l’Église à examiner la manière dont elle prend soin de ses prêtres», car «la manière dont il a été traité parfois serait inadmissible dans une entreprise.»
Un malaise chez les prêtres?
Il y a quelque chose de ce genre dans l’Église de France. Beaucoup de ces hommes, qui ont donné toute leur vie à Dieu, sont troublés. Et ils n’ont pas toujours un évêque à l’oreille attentive. Un prêtre résume: «Il peut y avoir un gros malaise avec l’évêque: est-il un père? un patron? un délateur?» Les prêtres vivent en effet une surcharge structurelle avec la diminution des vocations. Les mêmes prêtres catholiques viennent d’essuyer, injustement, depuis le rapport Sauvé, l’opprobre de l’accusation d’être des pédocriminels en puissance alors qu’elle concernait, au plus fort de cette crise il y a quarante ans, 3 % à 4 % des prêtres et moins de 1 % d’entre eux aujourd’hui. Les évêques, tétanisés, n’ont pas su défendre leur honneur.
Des chiffres calamiteux
Depuis une dizaine d’années, ces hommes de terrain constatent une baisse des entrées dans les séminaires. Certains de ces établissements, comme à Lille ou à Bordeaux, ont dû fermer. La Conférence des évêques préfère ne pas donner les chiffres de la rentrée de septembre 2022 tant ils sont calamiteux. Le diocèse de Paris enregistrait seulement trois jeunes entrés en première année. L’Église connaît aussi des tensions liturgiques: un quart, au moins, des jeunes ordonnés au sacerdoce sont plutôt de sensibilité classique, voire traditionaliste. Les fidèles de la génération 1968, plutôt progressistes, ne le comprennent pas.
Des diocèses connaissent également des difficultés avec leur évêque. Depuis vendredi dernier, une pétition circule dans le diocèse de Strasbourg pour demander le départ de l’archevêque, Mgr Luc Ravel. Il y a, enfin, l’abandon du sacerdoce. Effectué dans la discrétion il y a encore trois décennies, chaque départ de prêtre est aujourd’hui médiatisé. «C’est dur de voir un frère prêtre partir», reconnaît l’un d’eux. Même si, en réalité, le nombre de ceux qui quittent le sacerdoce en France est relativement stable: 15 en moyenne par an depuis le début des années 2000, selon les chiffres officiels du Vatican, soit un pour mille. En France, le nombre de prêtres s’est réduit de moitié en vingt ans. Ils étaient 10.188 prêtres diocésains en 2020, pour 10.326 paroisses qui regroupent 45.000 églises. L’âge médian du prêtre est de 75 ans.
Pour y voir clair, Le Figaro a sollicité douze prêtres. Douze apôtres. Douze pasteurs de moins de 50 ans, de tous lieux, ruraux et urbains. Ils disent être «très heureux» du choix de cette voie. Ils ne regrettent rien. Mais ils sont lucides. Au prix, pour certains, de parler sous anonymat strict.
L’un d’eux nous raconte une anecdote terrible pour un homme de Dieu. Il exerce dans le sud de la France et totalise une dizaine d’années de sacerdoce. Prêtre diocésain, il n’a rien d’un ultra qui voudrait imposer sa foi. Lors du jeudi saint, fête du sacerdoce, il a reçu une «douche glacée». Alors qu’il évoquait «la mort et de la résurrection du Christ», thème pascal s’il en est, dans un lycée catholique, il s’est vu reproché de ne pas avoir parlé des «valeurs du christianisme, de la solidarité». Ce qu’il ne manque pourtant pas de faire à d’autres occasions. Il en déduit: «C’est à l’image de ce que vivent beaucoup de prêtres aujourd’hui. S’ils souffrent dans leur cœur de pasteur et dans leur vie, ce n’est pas pour leur ego, mais parce que la mission confiée par l’Église, celle d’annoncer clairement le Christ, n’est pas toujours partagée par l’Église elle- même!» «La mission, l’annonce du Christ, nous avons donné notre vie pour elle. Nous savons que notre choix de vie est incompris. Mais le malaise des prêtres vient de ce que l’on ne sait plus comment annoncer l’Évangile, constate-t-il. Nos communautés paroissiales vieillissent. Lors des funérailles, les gens n’attendent qu’une prestation de “service”. La majorité des couples que nous préparons au mariage n’ont pas la foi. En fait, les gens n’attendent pas ce que l’on souhaiterait leur donner…» D’où un risque de découragement: «Des prêtres ne voient plus le fruit de leur travail. Certains n’en peuvent plus. D’autant que les évêques nous laissent souvent seuls sur le terrain. Et, si nous sommes un peu incisifs, ils s’inquiètent. Ils préfèrent le consensus.»
Un prêtre ose, lui, sortir de l’anonymat. Paul Benezit a 37 ans et totalisera bientôt une dizaine d’années d’ordination. Il confesse son tempérament «positif» qui cherche «toujours à voir le bon côté des choses». Prêtre en zone rurale, il a 28 clochers sous sa responsabilité et affirme: «Je suis tellement heureux dans mon ministère!» Il évoque, pêle-mêle, le contexte récent de son diocèse: l’épreuve du suicide d’un prêtre de 38 ans, il y a cinq ans, qu’il remplace, le procès d’un prêtre qui va bientôt avoir lieu et, en janvier dernier, l’annonce tonitruante du départ du curé de la cathédrale, parti avec une femme. «Nous avons une grosse charge de travail, tout est dans la façon de la vivre. Le malaise vient du manque d’effectifs, estime-t-il. On place des prêtres sans expérience à des postes trop difficiles. Si l’on répond que l’on ne peut pas assumer le travail de deux prêtres, voire de trois prêtres, on nous regarde avec bienveillance, mais il faut y aller quand même. Si on ne fixe pas une limite pour se reposer, lire, faire du sport, s’intéresser à autre chose, on tombe vite dans un surinvestissement lié à la spiritualité du sacerdoce, qui est un don total de soi. On accepte une mission toujours plus lourde, impossible à réussir entièrement, et c’est le début des problèmes. On tire sur la corde et on peut dégringoler: fuite, abandon du ministère, suicide.»
Ce nageur de bon niveau, passionné de forêts, interroge: «On connaît la courbe des âges des prêtres, le nombre de postes à pourvoir, le peu d’entrées au séminaire. Au lieu de naviguer à vue, de gérer le quotidien, il serait bon de se poser sur une table et de conduire nos ressources humaines sur dix ans. Mais cela, je ne l’ai pas encore vu. Quand allons-nous penser une autre organisation que ce maillage intenable du territoire?» «Perte de confiance dans le pape François»
Confronté à la même problématique dans le Lot, en zone encore plus rurale, le père Florent Millet, recteur du sanctuaire de Rocamadour, a longtemps été vicaire général du diocèse, numéro deux de l’évêque: «Quand j’étais vicaire général, j’ai vu des prêtres actifs, toujours prêts à aller partout, d’autres plus casaniers, d’autres toujours disponibles, d’autres toujours submergés. Les tempéraments et les caractères jouent, mais j’ai observé qu’un curé qui aime ses paroissiens est un prêtre heureux. Cela paraît simple, mais cela se vérifie. En revanche, si je ressentais un malaise aujourd’hui, il viendrait de la question liturgique. Nous étions arrivés à une situation paisible avec les prêtres traditionalistes et tout se passait bien. On peut comprendre que Rome veille à ne pas voir des chapelles particulières, mais les nouvelles restrictions nous compliquent les choses.»
Il y a peu encore, les prêtres ne critiquaient jamais le pape. Il apparaît dans ce tour d’horizon que plusieurs d’entre eux – requérant l’anonymat – ne tiennent plus cette réserve. À l’évocation d’un possible «malaise», les prêtres parlaient uniquement de «regards noirs»,de «changements de trottoir» et d’«invectives désobligeantes» dans la rue. C’était il y a deux ans, au paroxysme de la crise de la pédophilie. Aujourd’hui, certains d’entre eux, qui ne sont pas des extrémistes, mettent en lumière «une immense perte de confiance dans le pape François». «Beaucoup de prêtres de moins de 50 ans sont décontenancés parce qu’ils ont l’impression que François sème le trouble, la division et qu’il est toujours dans la dénonciation du cléricalisme, confie l’un d’entre eux. J’ai tout abandonné pour suivre le Christ, pas pour exercer un pouvoir! Or, enseigner clairement l’Évangile serait devenu du cléricalisme? Certains fidèles nous reprochent d’être vieux jeu quand nous enseignons ce que l’Église professe. Le pape, objectivement, ne représente plus un signe de communion. Il y a un trouble chez les prêtres parce que nous vivons une crise de confiance.»
Un autre, dans le même registre, ajoute: «Quand nous regardons vers Rome, qui a toujours été un cap, un phare, une terre ferme, on nous dit: “On ne veut plus de prêtre comme vous.” Il faut se justifier de porter un col romain. Le pape nous donne l’impression qu’il ne nous comprend pas et qu’il ne nous aime pas. Nous restons fidèles, comblés par les joies de notre ministère, mais nous sommes désemparés et beaucoup de catholiques le sont avec nous. Si nous tenons c’est grâce aux jeunes, très motivés, qui montrent l’arrivée d’une nouvelle génération bien dans son temps et qui n’a pas honte de se dire catholique. Pas identitaires, ils attendent qu’on leur parle de la foi chrétienne. Ce sont eux l’avenir.»