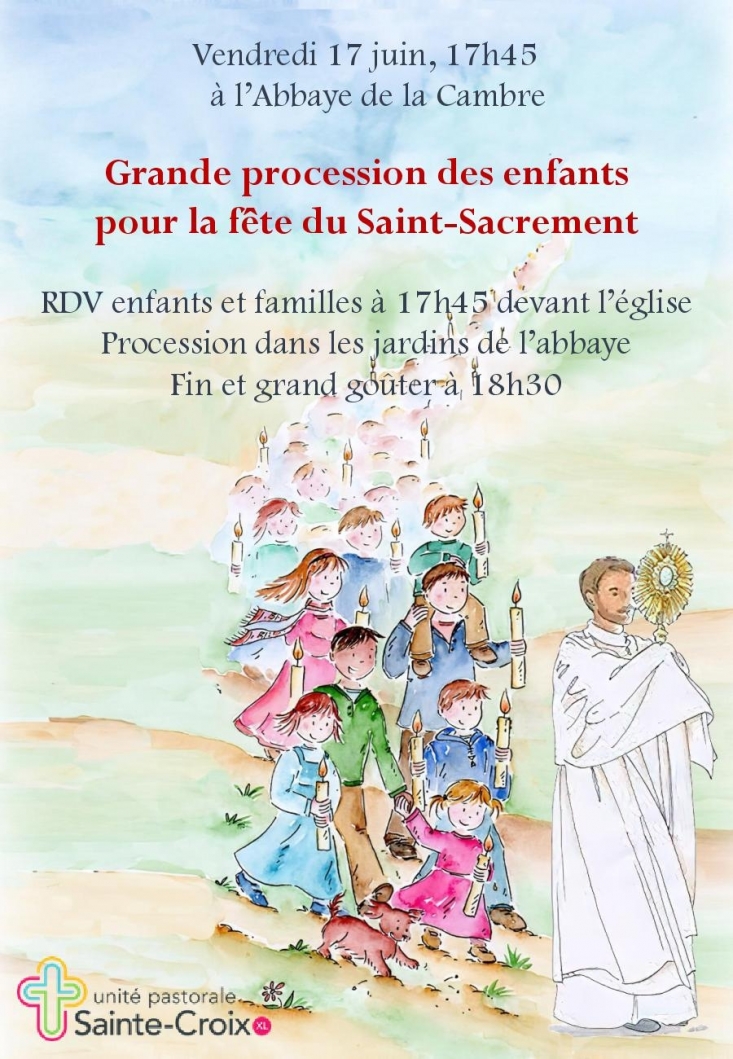Lu sur le site « Riposte Catholique », cette Tribune de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, parue dans Le Figaro à propos du travail suscité par le pape au sujet de la « synodalité » :
Lu sur le site « Riposte Catholique », cette Tribune de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, parue dans Le Figaro à propos du travail suscité par le pape au sujet de la « synodalité » :
" Le mois de juin est chaque année celui des ordinations sacerdotales, traditionnellement célébrées dans l’Église catholique à proximité de la grande fête des saints Pierre et Paul, le 29 juin. Bien que trop peu nombreuses dans notre pays, des ordinations continuent d’y avoir lieu : après au moins sept années de formation spécifique, faisant souvent suite à une qualification et une expérience professionnelle de haut niveau, de jeunes hommes, ayant perçu un appel intérieur à tout quitter pour suivre Jésus, à la manière des premiers apôtres, acceptent d’offrir leur vie pour l’annonce de l’Évangile et le service de tous.
Il n’est certes pas facile d’être prêtre en France aujourd’hui, dans un contexte de profonde sécularisation.
Le rapport, en lui-même à l’évidence salutaire et à terme certainement bienfaisant, de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église a pu susciter une sorte de suspicion généralisée à l’égard des prêtres, pourtant en grande majorité irréprochables et fidèles. Le travail suscité par le pape François sur la « synodalité », c’est-à-dire la coopération de tous les baptisés à la mission de l’Église, a pu, à côté de réflexions stimulantes et prometteuses, conduire à des critiques injustes voire violentes et blessantes à l’égard des prêtres comme tels.
Mais tout cela est peu de chose à côté de la joie de méditer, de vivre, d’annoncer cette parole étonnamment libératrice que constitue l’Évangile, à côté du bonheur de manifester la proximité aimante de Dieu au milieu des joies et des peines de tous et de chacun. Peu d’expériences humaines sont aussi intenses que la célébration du baptême ou de la confession ou de l’eucharistie : le Christ offrant sa vie, qui se rend présent au milieu de ses disciples rassemblés par le pain et le vin consacrés. Pour ceux qui y sont appelés et qui s’y sont préparés en profondeur, le sacerdoce recèle des trésors inépuisables de joie.
Saint Charles de Foucauld, tout récemment canonisé par le pape François, pour le bonheur de l’Église et la légitime fierté des Français, a témoigné d’une fraternité proprement universelle fondée sur un amour hors du commun de l’eucharistie, célébrée et adorée. Cet homme, ce prêtre, si contemporain par son enfance et sa jeunesse blessées, par sa recherche spirituelle laborieuse et tumultueuse, a découvert dans le Christ la lumière qu’il désirait intensément et compris qu’il valait la peine de tout sacrifier à l’accueil et au service de cette lumière.
L’avenir du sacerdoce catholique ne relève pas d’abord de questions d’organisation ou de pouvoir. Il est, dans des conditions d’exercice qui peuvent évoluer évidemment, le signe sacramentel que l’Église n’est pas une organisation centrée sur elle-même mais qu’elle se reçoit du Christ pour pouvoir témoigner de lui. C’est l’oubli de cet enracinement spirituel et de cette perspective missionnaire qui conduit aux abus ou au déclin. Les périodes de grand renouveau de la foi en revanche sont toujours des époques d’approfondissement du mystère du Christ, vrai Dieu et vrai homme, sauveur d’une humanité menacée par la mort mais faite pour la vie éternelle.
L’Église en elle-même n’est pas très intéressante, même pour les chrétiens, ou plutôt elle n’est intéressante que dans la mesure où elle se perçoit et se vit comme accueil rayonnant de la lumière du Christ. En dehors de cette perspective d’espérance et de foi, les débats ecclésiastiques internes sont condamnés à la médiocrité, voire à la violence et à la stérilité. La mission des prêtres est précisément de lutter contre cette asphyxie des âmes et des communautés, par un service et un témoignage humbles, profonds, joyeux, courageux, persévérants.
Il y a quelques semaines, le jour de la Pentecôte, il m’a été donné de célébrer la messe pour plus de 30 000 jeunes, scouts unitaires de France, dans une atmosphère inoubliable de ferveur, de paix et de joie. Malgré les intempéries, au soir tombant, à l’heure où dans l’Évangile Jésus ressuscité se fait reconnaître aux disciples d’Emmaüs par la fraction du pain, ces jeunes et ceux qui les encadraient, avec l’énergie de fidèles laïcs pleinement responsabilisés, s’ouvraient avec enthousiasme à la nourriture précieuse entre toutes de l’eucharistie. Ils constituaient une vivante image du meilleur de la « synodalité » .
La tentation est grande en notre temps de céder aux sirènes de la déconstruction et de la culture de l’annulation, parfois même dans l’Église. Celle-ci n’est pas d’abord une structure hiérarchique corsetée mais bel et bien une fraternité libératrice, à condition que l’Église se reçoive constamment du Christ rendu présent notamment par le ministère sacramentel des prêtres. Renoncer à cette source, c’est en fait renoncer à la fraternité non seulement ecclésiale mais encore universelle, que l’humanité, prisonnière de ses démons, l’actualité nous le montre assez, n’est pas capable de faire advenir par ses seules forces. La joie du sacerdoce, c’est la joie de contribuer au salut du monde en témoignant de ce qui le dépasse et le fonde.
L’auteur de ces lignes a eu le bonheur d’ordonner deux prêtres à la cathédrale de Nanterre, tout près du mont Valérien, ce 18 juin, quatre-vingt-deuxième anniversaire de l’appel du général de Gaulle. Le père François de Gaulle, son neveu missionnaire, raconte que, rendant visite à son oncle illustre quelques jours après son ordination sacerdotale, il eut l’émotion de le voir, conformément à la tradition, tomber à genoux devant lui pour recevoir sa bénédiction de jeune prêtre aux mains fraîchement consacrées. Le héros de la France libre, l’homme du courage et de l’audace, le chef intraitable et apparemment sûr de lui, savait en fait que la force, la liberté et la paix ont une source et que les prêtres en sont les indispensables serviteurs."
Ref : La mission des prêtres : lutter contre l’asphyxie des âmes et des communautés
 « Le pape François vient de publier une lettre apostolique sur la formation liturgique, intitulée Desiderio Desideravi. Le pape commence par rappeler les restrictions concernant la messe traditionnelle :
« Le pape François vient de publier une lettre apostolique sur la formation liturgique, intitulée Desiderio Desideravi. Le pape commence par rappeler les restrictions concernant la messe traditionnelle :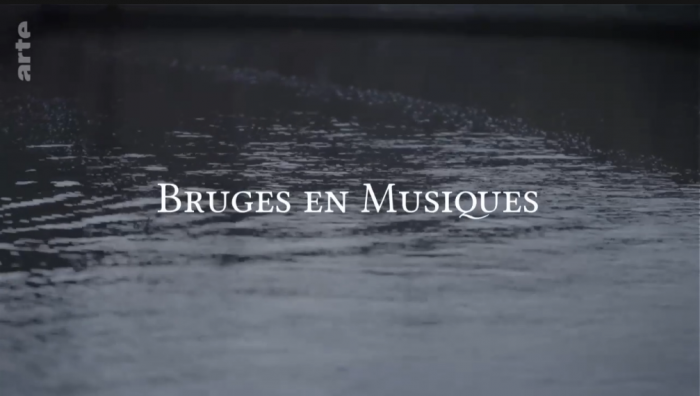
 Lu sur le site « Riposte Catholique », cette Tribune de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, parue dans
Lu sur le site « Riposte Catholique », cette Tribune de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, parue dans