De Maryam Nenayad sur le site web de la Libre Belgique ce 31 mars 2021 :
« La décision fait suite à une action en référé introduite par la Ligue des Droits Humains.
Le tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné à l’État belge de lever toutes les mesures anti-Covid-19 actuellement en vigueur dans notre pays d’ici 30 jours, d’après l’ordonnance obtenue par La Libre.
Les autorités ont désormais 30 jours pour couler leurs décisions dans des textes de loi réglementaires. L’État belge, s’il ne respecte pas l’échéance actée par le tribunal de première instance de Bruxelles, devra payer une astreinte de 5 000 euros par jour.
“Un double discours de l’État belge”
Tout a commencé lorsque, le 12 mars dernier, les avocates de la Ligue des droits humains (LDH) et son équivalent flamand, la Liga voor Mensenrechten, plaidaient devant le tribunal de première instance de Bruxelles après un recours introduit contre l’État belge le 22 février.
La LDH voulait savoir si les mesures instaurées pour lutter contre la propagation du coronavirus – et donc les arrêtés ministériels adoptés pendant cette crise – respectent les prescrits légaux. Ce mercredi, le tribunal a donc donné gain de cause aux organisations de lutte pour la défense des droits humains en condamnant l’État belge.
Le jugement précise que l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, doit “prendre toutes les mesures appropriées pour mettre un terme à la situation d’illégalité apparente découlant des mesures restrictives des libertés et droits fondamentaux reconnus par la Constitution”.
Le jugement pointe du doigt l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ainsi que les arrêtés qui ont suivi. Les manquements seraient liés à la base légale invoquée par l’État belge, en l’occurrence la loi du 15 juillet 2007. À ce propos, le jugement rendu pointe un “double discours” tenu par les autorités puisque la ministre de l’Intérieur aurait indiqué, le 25 février 2021, que la loi de 2007 n’a pas été créée pour gérer une situation comme celle que nous vivons actuellement. C’est pourtant une des bases légales invoquées par le gouvernement. Le jugement y voit donc “un double discours”.
Le jugement stipule donc que toutes les mesures instaurées par ces arrêtés ministériels doivent être levées dans les 30 jours, sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Contacté par nos soins, le cabinet de la ministre de l'Intérieur n'a pas souhaité réagir pour le moment.
“Une victoire pour la démocratie”
Pour Audrey Lackner et Audrey Despontin, les avocates qui représentent les deux ligues, ce jugement est une victoire historique. “Nous sommes ravies par cette décision, c’est une journée importante pour l’État de droit et pour la démocratie, ravies aussi de voir que le tribunal a constaté l’illégalité des mesures compte tenu du fait que la loi de 2007 (NdlR : une des bases légales des arrêtés ministériels) n’est pas faite pour gérer une pandémie et encore moins pendant un an. Il est donc nécessaire qu’une loi soit créée et qu’un débat parlementaire soit organisé. Cette décision reconnaît la nécessité d’un débat parlementaire.”
“Le Conseil d’Etat s’est replié dans sa carapace”
Le débat parlementaire, justement, démarre ce mercredi lors d’une séance plénière exclusivement consacrée à l’avant-projet de loi Pandémie.
En attendant, le jugement rendu ce mercredi va-t-il influencer les mesures actuellement d’application ? Non, rappelle Anne-Emmanuelle Bourgeaux, constitutionnaliste à l’UMons. “L’État belge a 30 jours pour se retourner, mais en attendant, nous sommes dans une période d’incertitude. Ce qui est certain, c’est que le jugement rendu aujourd’hui démontre qu’il était opportun de dénoncer la faiblesse de la base juridique usitée”.
La constitutionnaliste estime aussi que, faute d’avoir eu une réponse du côté du Conseil d’État, les plaideurs se sont tournés vers d’autres juridictions pour avoir gain de cause. “Et les plaideurs ont eu raison. Le Conseil d’État a été très clément avec les arrêtés ministériels pris, alors qu’il a un rôle de protecteur des gardiens des libertés des droits des citoyens. Le Conseil d’État s’est refermé dans sa carapace au lieu de dresser un bouclier à l’égard des menaces et des intrusions pour les droits des citoyens. C’est dommage, mais le jugement rendu ce mercredi remet les choses au clair. Et rappelle que les droits humains et les libertés sont au-dessus de tout”.
Ref. L’Etat belge condamné par le tribunal de première instance de Bruxelles à lever toutes les mesures covid d’ici 30 jours
"Il est donc nécessaire qu’une loi soit créée et qu’un débat parlementaire soit organisé. Cette décision reconnaît la nécessité d’un débat parlementaire”: allez, Messieurs les supporters de la culture et des cultes, ne ratez pas l’aubaine qui, peut-être, s’offre enfin à vous pour pour toiletter la prose issue du bon plaisir ministériel: en toute hypothèse, la bombe lancée par le tribunal bruxellois tombe à point nommé pour infléchir l’avant-projet de loi « pandémie » actuellement en discussion à la Chambre fédérale des députés. A suivre…
Post-scriptum:
 Comme il fallait s’y attendre, pour le ministre de la Justice Van Quickenborne, rien ne va changer : « A part aller en appel, on va mettre en place la Loi Pandémie et voter cette loi après les vacances de Pâques. Hier (mercredi), on a pris connaissance de cette décision (du tribunal), il y a déjà eu des déclarations au Parlement. Aujourd’hui, on a le débat avec le Premier ministre au Parlement. » La particratie n’est pas un vain mot.
Comme il fallait s’y attendre, pour le ministre de la Justice Van Quickenborne, rien ne va changer : « A part aller en appel, on va mettre en place la Loi Pandémie et voter cette loi après les vacances de Pâques. Hier (mercredi), on a pris connaissance de cette décision (du tribunal), il y a déjà eu des déclarations au Parlement. Aujourd’hui, on a le débat avec le Premier ministre au Parlement. » La particratie n’est pas un vain mot.
JPSC
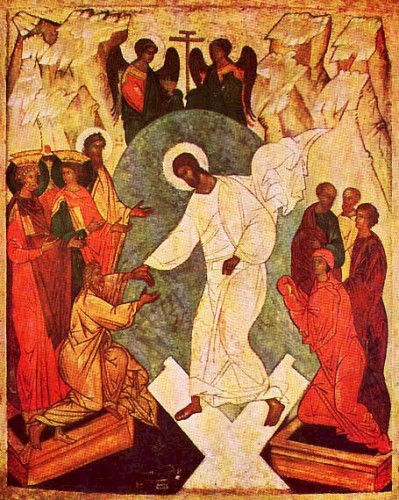


 Comme il fallait s’y attendre, pour le ministre de la Justice Van Quickenborne, rien ne va changer : « A part aller en appel, on va mettre en place la Loi Pandémie et voter cette loi après les vacances de Pâques. Hier (mercredi), on a pris connaissance de cette décision (du tribunal), il y a déjà eu des déclarations au Parlement. Aujourd’hui, on a le débat avec le Premier ministre au Parlement. » La particratie n’est pas un vain mot.
Comme il fallait s’y attendre, pour le ministre de la Justice Van Quickenborne, rien ne va changer : « A part aller en appel, on va mettre en place la Loi Pandémie et voter cette loi après les vacances de Pâques. Hier (mercredi), on a pris connaissance de cette décision (du tribunal), il y a déjà eu des déclarations au Parlement. Aujourd’hui, on a le débat avec le Premier ministre au Parlement. » La particratie n’est pas un vain mot.