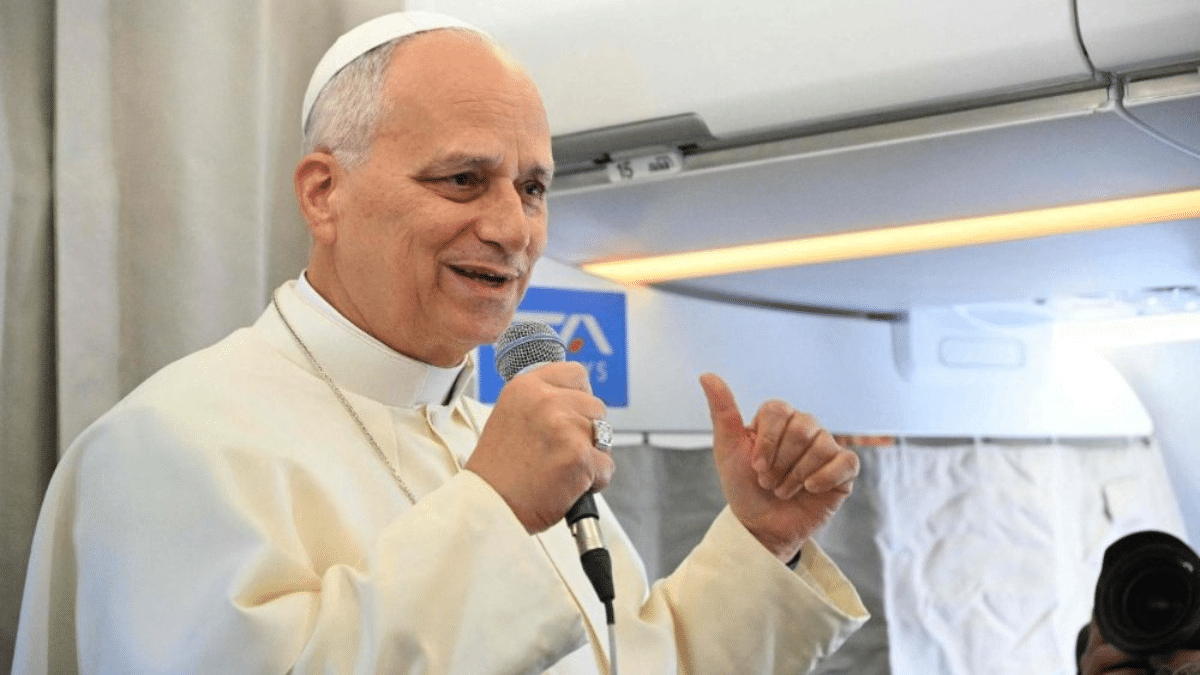La semaine où Léon XIV partit pour son premier voyage international fut également celle où le pape prit plusieurs décisions et commença véritablement à donner une direction à son pontificat.
Les décisions qu'il a prises ont révélé certains aspects de la personnalité de Léon XIV : il est capable de renverser les décisions du pape François, notamment en matière administrative ; en matière doctrinale, il absorbe les problèmes plutôt que d'alimenter les débats ; il n'est assurément pas un pape qui met en œuvre un système de partage des dépouilles féroce, et par conséquent, on ne peut s'attendre à aucun écart significatif et exemplaire.
Mais avant d'analyser ces caractéristiques, il convient d'examiner les faits.
Cette semaine, le nouveau Règlement général de la Curie romaine a été promulgué ; le Dicastère pour la doctrine de la foi a publié sa note sur la monogamie ; le budget du Saint-Siège a été publié ; l'évêque Marco Mellino a été nommé secrétaire adjoint du Conseil pontifical pour les textes législatifs ; et Léon XIV a rétabli le secteur central pour le diocèse de Rome.
Chacun de ces cinq événements a son propre poids spécifique.
La publication du nouveau règlement général de la Curie romaine conclut l'œuvre entreprise par le pape François avec la réforme de la Curie. Ce nouveau règlement apparaît avant tout comme une adaptation des structures définies dans la constitution apostolique Praedicate Evangelium. Par exemple, le Secrétariat pour l'Économie est chargé de la rédaction des contrats et de la vérification de leur validité. Le Secrétariat d'État ne propose plus la nomination des chefs des dicastères, qui sont désormais nommés par le pape. Les responsabilités des dicastères ont évolué.
Il a été souligné que le nouveau règlement stipule clairement que chaque dicastère doit enregistrer les demandes qu'il reçoit et y apporter des réponses adéquates et motivées. Cette bureaucratisation vise à prévenir les abus, mais il est vrai aussi que toutes les demandes reçues par les dicastères sont, de fait, enregistrées, ne serait-ce que pour des raisons d'archivage. Il a également été souligné que le latin demeure la langue officielle de l'Église, mais qu'objectivement, il ne saurait en être autrement. Cela est resté vrai même sous le pape François, qui rédigeait ses textes en espagnol ou acceptait une édition typique italienne.
Ce qui est frappant, cependant, c'est que le Secrétariat d'État conserve son rôle de coordination de tous les dicastères, un fait significatif compte tenu du fait que le pape François avait progressivement démantelé les prérogatives du Secrétariat d'État, le privant même de son autonomie financière. Mais la réforme de François, il s'avère, n'est pas inviolable. Léon XIV l'a démontré en rétablissant la capacité de chaque dicastère à investir et à lever des fonds en dehors de l'Institut pour les Œuvres de Religion, la soi-disant « banque du Vatican ». Le pape François, en revanche, avait imposé à tous d'investir uniquement par l'intermédiaire de l'IOR. Le changement de perspective est évident.
Il y a ensuite le revirement de Léon XIV concernant la décision du pape François d'abolir le secteur central du diocèse de Rome, historiquement divisé en cinq secteurs pastoraux et administratifs géographiques : Nord, Sud, Est, Ouest et Centre historique. Le secteur central disposait toujours d'une unité auxiliaire dédiée et d'un profil particulier, en raison de son riche patrimoine historique et culturel et de sa spécificité pastorale, accueillant un grand nombre de pèlerins, de touristes et de personnes de passage.
Le pape François a aboli le secteur central, estimant qu'il ne devait pas y avoir de zones « privilégiées » et souhaitant placer les faubourgs au cœur du village. Léon XIV a rétabli ce secteur par un motu proprio qui ne remet pas en cause les raisons de la décision de François et n'invoque aucune nécessité administrative.
Léon XIV a donc agi sans pour autant afficher ouvertement sa rupture avec le pape François, mais en prenant néanmoins une direction très opposée. Il en ressort un double enseignement important : d’une part, nous savons que Léon ne considérera pas la réforme de François comme une œuvre inachevée ; d’autre part, nous savons qu’il n’hésitera pas à changer de cap .
Un autre signe de l'attitude de Léon est évident dans la manière dont le budget du Saint-Siège a été présenté .
Les différents organes du Saint-Siège ont affiché un léger excédent budgétaire de 1,6 million d'euros, tandis que le déficit d'exploitation structurel du Saint-Siège, considéré dans son ensemble, a été réduit de moitié en 2024, passant de 83,5 millions d'euros en 2023 à 44,4 millions d'euros . Les résultats de 2024 ont cependant été fortement influencés par la gestion des hôpitaux, intégrés aux comptes débiteurs et créditeurs du Vatican depuis 2022. Ce qui a changé, c'est le discours.
Ces dernières années, on a beaucoup parlé de déficit. Pour la première fois depuis longtemps, il semble plausible d'évoquer une voie vertueuse vers la consolidation . Qu'on ne s'y trompe pas : le Saint-Siège est loin d'être tiré d'affaire. Le système financier a subi de profonds bouleversements ces dernières années et a toujours un besoin urgent de consolidation. Sous le pontificat de Léon XIV, pape très attaché aux institutions, celles-ci seront préservées.
La nomination de l'évêque Marco Mellino comme secrétaire adjoint du Dicastère pour les textes législatifs en est un autre signe.
Mellino était secrétaire du Conseil des cardinaux et est actuellement secrétaire du Comité pour la révision du Règlement général de la Curie . Il occupe désormais un poste au Vatican, celui de « numéro 2 », dans un dicastère actuellement sans préfet – Léon XIV ayant promu Iannone au poste de préfet du Dicastère pour les évêques. Mellino n'a pas été nommé préfet, mais secrétaire adjoint, et sa nomination indique non seulement que le Conseil des cardinaux a rempli ses fonctions, mais aussi que la révision du Règlement de la Curie ne lui sera plus confiée. Mellino n'est cependant pas promu ; il est simplement affecté comme secrétaire adjoint dans un dicastère.
Autrement dit, Mellino ne quitta pas Rome, mais accepta un autre poste au Vatican.
Ilson de Jesus Montanari, secrétaire du Dicastère pour les évêques pendant de nombreuses années, était également un homme d'une influence et d'un réseau exceptionnels sous le pontificat de François. On s'attendait à ce qu'il quitte ses fonctions s'il n'obtenait pas le poste le plus élevé du dicastère (précédemment dirigé par celui que nous appelons aujourd'hui Léon XIV). Or, Montanari est resté en poste.
Le seul à avoir été destitué fut Andrés Gabriel Ferrada Moreira, un fonctionnaire du Dicastère pour le Clergé, envoyé à San Bartolomé de Chillán, au Chili, pour y exercer les fonctions d'évêque. Léon XIV n'a donc ni puni ni exilé, et contrairement au pape François, il n'a pas non plus créé de postes ad hoc ni laissé sans affectation ceux qu'il jugeait dissidents .
Avec ces décisions, certaines expériences du pontificat de François semblent toucher à leur fin, à commencer par le concile des cardinaux, sorte de « cabinet de conseillers » caractéristique de l'ère François. Léon XIV privilégie les consistoires pour les débats – celui des 7 et 8 janvier sera le premier, mais probablement pas le dernier – et les réunions interdépartementales, plutôt que la multiplication des institutions. Léon XIV n'entreprendra donc pas de nouvelles réformes. Il procédera à des ajustements et supprimera ce qu'il jugera superflu.
On pourrait presque dire que la réforme de Léon XIV sera une réforme par absorption.
Les documents laissés inachevés par le pape François sont également en cours d'intégration. La semaine dernière a vu la publication d'un document sur la monogamie : quarante pages de citations, avec une invitation, en préambule, à passer directement à la conclusion pour ceux qui ne souhaitent pas s'attarder sur chaque point. Il ne s'agit pas d'un document hétérodoxe ou controversé, malgré les efforts de quelques commentateurs pour y déceler une ouverture progressive aux relations sexuelles non procréatives au sein du mariage ; mais, fondamentalement, cette question n'est pas abordée. C'est en réalité un document qui s'inscrit dans une tradition théologique solide, même s'il ne traite pas du problème spécifique de la polygamie africaine qui, en apparence, lui a donné naissance.
Il s'agit néanmoins d'un document hérité du pontificat précédent. Deux autres sont en cours de publication, après quoi le mandat confié par le pape François au Dicastère pour la Doctrine de la Foi aura expiré. La décision de Léon XIV de poursuivre son mandat témoigne du respect qu'il porte à son prédécesseur et d'une volonté d'assurer la continuité.
Léon XIV n'est pas un pape révolutionnaire.
Léon XIV ne souhaite pas rompre brutalement avec le pontificat de François. Il a poursuivi la voie tracée par son prédécesseur, avec peu d'interventions. Pourtant, une nouvelle orientation, un nouveau mode de vie, se dessine, qui a presque conduit à l'oubli de François.
Presque.
Une analyse lucide de la situation montre que beaucoup, dans l'entourage de Léon, souhaitent que les décisions du pape François restent au cœur des préoccupations. Ce qui est en construction sera vraisemblablement achevé.
L'approche léonine, cependant, sera différente.