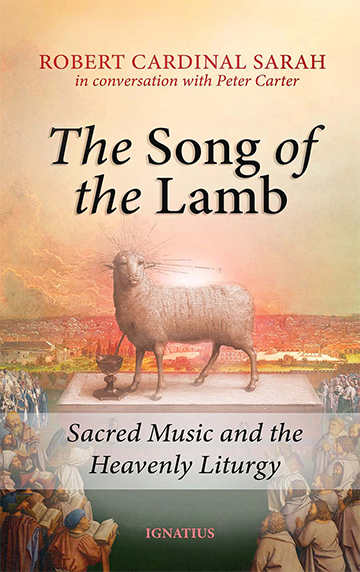Le pape Léon fera ses débuts internationaux avec un numéro de funambule
26 novembre 2025
ROME – Chaque visite d'un pape au Moyen-Orient est toujours un exercice d'équilibriste, car il doit composer avec les sensibilités de communautés ethniques et religieuses extrêmement diverses dans une région historiquement et actuellement en proie aux conflits.
C’est précisément dans ce contexte que le pape Léon XIV fera ses débuts sur la scène internationale cette semaine, lors de sa visite en Turquie et au Liban du 27 novembre au 2 décembre, pour commémorer le 1700e anniversaire du premier concile de Nicée et encourager les populations épuisées par la guerre.
Tenu dans ce qui est aujourd'hui İznik, le concile de Nicée eut lieu en 325 et démantela l'hérésie arienne, qui niait la divinité de Jésus – une chose aujourd'hui largement reconnue par les chrétiens.
Ce voyage avait initialement été organisé sous le pontificat du pape François, mais il a été reporté suite à son décès en début d'année et à l'élection du pape Léon XIV.
Parmi les temps forts du voyage figurent une visite à İznik pour commémorer le concile de Nicée, ainsi qu'une rencontre avec le patriarche œcuménique Bartholomée Ier avec la signature d'une déclaration commune, et une visite au port de Beyrouth, où une explosion massive a tué près de 220 personnes et en a blessé des milliers d'autres en 2020.
Premier voyage international du pape Léon XIV, sa visite en Turquie et au Liban revêt une grande importance et suscite de grandes attentes quant à la manière dont il se comportera en tant que nouveau dirigeant mondial entrant dans ce qui est sans doute l'un des contextes géopolitiques les plus complexes de la carte.
Les yeux du monde entier seront rivés sur Léon, qui a déjà la réputation d'être un bâtisseur de ponts, observant comment il choisira d'interagir avec ses homologues chrétiens et comment il gérera les tensions politiques locales pour formuler un message de paix dans une région en guerre.
Un moment de dialogue
Le but principal de la visite du pape Léon est, en substance, de faire progresser le dialogue œcuménique dans l'esprit de Nicée avec les dirigeants des différentes Églises chrétiennes de la région, notamment le patriarche œcuménique Bartholomée Ier de Constantinople, avec lequel il signera une déclaration commune.
Dans une lettre apostolique publiée dimanche et intitulée In Unitate Fidei (« Sur l’unité de la foi »), Léon XIV a soutenu que le Concile reste pertinent aujourd’hui « en raison de sa grande valeur œcuménique », à un moment où l’unité des chrétiens est devenue une priorité absolue pour l’Église catholique.
L’œcuménisme, qui sera un élément important du premier voyage apostolique de Léon, n’a cessé de gagner en importance depuis le concile Vatican II (1962-1965) et figurait parmi les points clés à l’ordre du jour du pape François.
Après avoir rencontré les autorités politiques et civiles nationales de la Turquie à majorité musulmane, où la minorité chrétienne est confrontée quotidiennement à la discrimination, ainsi que les pasteurs locaux de la petite communauté catholique locale, Léon se rendra vendredi à İznik pour une commémoration œcuménique du concile de Nicée.