Lu sur le site web du National Catholic Register, cet article du Père Raymond de Souza, fondateur du magazine « Convivium » :

« Ce samedi, le Vatican commémore le 400e anniversaire de la reconnaissance de la sainteté des saints. Thérèse d'Avila, François Xavier, Ignace de Loyola, Philippe Neri et Isidore de Madrid.
Les canonisations font partie de la routine de la vie de l'Église, mais certaines canonisations sont plus égales que d'autres. Pensez à Maria Goretti en 1950, où Assunta Goretti a été la première mère à assister à la canonisation de son propre enfant. Encore plus remarquable, Alessandro Serenelli, l'homme qui a assassiné Maria, était également présent, ayant eu une conversion complète de la vie en prison. Ou considérez, 50 ans plus tard, la canonisation de sœur Faustine Kowalska, la première sainte du nouveau millénaire, « l'apôtre de la miséricorde divine ».
Il n'y a cependant jamais eu de canonisation comme celle du 12 mars 1622, dont le 400e anniversaire sera célébré ce samedi. Le pape Grégoire XV a mené la plus grande cérémonie de canonisation de l'histoire, reconnaissant en même temps la sainteté d'Isidore le Laboureur (ca. 1070-1130), François Xavier (1506-1552), Ignace de Loyola (1491-1556), Thérèse d'Avila ( 1515-1582) et Philippe Neri (1515-1595).
Étant donné les deux saints jésuites, le pape François devrait assister à la principale célébration jésuite dans leur église principale à Rome, Il Gesu , Le Saint Nom de Jésus.
Assister à une canonisation pourrait être un événement unique dans une vie pour un catholique ordinaire. Il y a très peu d'événements uniques pour l'Église dans son ensemble, car sa vie est de deux millénaires et compte. Pourtant, ce mardi romain de 1622 était un événement unique pour la Sainte Mère l'Église. Hormis Saint-Isidore, les quatre autres étaient des géants du XVIe siècle, champions de la Réforme catholique.
Le pape Grégoire XV a servi dans une période post-conciliaire importante, celle du Concile de Trente. En janvier 1622, il institua l'une des réformes tridentines les plus importantes, créant Propaganda Fide , l'office romain clé pour promouvoir l'évangélisation des vastes territoires de mission qui étaient explorés. Ce qu'il a fait en janvier n'a peut-être pas été aussi important que ce qu'il a fait le 12 mars. Reconnaître de nouveaux saints peut être plus important que de créer de nouvelles structures. Les saints sont l'œuvre de Dieu, et les canonisations sont la reconnaissance de l'endroit où le doigt de Dieu a écrit ses desseins dans l'histoire. Les saints sont la réponse de Dieu aux crises de l'Église. Le XVIe siècle est une période de grande crise. L'Église en Europe occidentale a été déchirée. La réponse de Dieu fut, en partie, les saints de 1622 :
Sainte Thérèse d'Avila
Thérèse d'Avila était une maîtresse de la vie intérieure et une redoutable réformatrice. Elle a transformé la vie religieuse douce et réconfortante de son époque, sachant que les corruptions externes de l'Église du début du XVIe siècle étaient la manifestation d'une profonde dissolution interne. Les ordres religieux sont l'âme de l'Église, l'Église en prière et en adoration, contemplant les choses divines et recherchant la communion avec elles.
La vie religieuse dans certaines parties de l'Église aujourd'hui est florissante, mais il y a aussi beaucoup de dissolution, voire de décadence. Ce qui se passe maintenant s'est déjà produit auparavant ; nous avons encore besoin du même esprit réformateur de Thérèse. Sa sainte homonyme, Teresa de Calcutta, en est un exemple, ayant fondé l'ordre religieux féminin à la croissance la plus rapide de notre temps, consacré avec une égale rigueur à la prière et à la charité, au culte du Corps du Christ sur l'autel et au service de la Corps du Christ sous l'affreux déguisement du pauvre.
Nous appelons l'Église notre Mère, et tandis que les prélats de l'Église sont des hommes, l'Église elle-même est féminine. C'est théologiquement vrai, mais nous devons aussi en faire l'expérience. Là où les religieuses ont disparu, il est difficile de vivre la maternité de l'Église. Thérèse a dirigé la grande réforme de la vie religieuse des femmes à son époque ; il faut qu'elle intercède pour une autre réforme dans la nôtre.
Saint François Xavier et Saint Ignace de Loyola
François et Ignace nous rappellent que les disciples doivent rechercher l'excellence pour la plus grande gloire de Dieu - ad maiorem Dei gloriam, comme le dit la devise jésuite - au moins aussi ardemment qu'ils le font pour l'approbation humaine. La médiocrité n'est généralement pas un péché, mais elle peut saper l'énergie évangélique de l'Église. La léthargie et la paresse peuvent être plus meurtrières pour la vie de l'Église que la vie licencieuse, car la première se glisse plus subtilement.
Les premiers jésuites étaient un groupe de frères engagés dans la mission ; Ignatius, Francis Xavier et Peter Faber étaient tous colocataires universitaires à Paris. Frères en mission est une description appropriée de ce que signifie être chrétien. C'est ainsi que le pape François, le premier pape jésuite, a défini l'Église dans Evangelii Gaudium — une communion de disciples unis dans la mission.
Pour Ignace et François, cette mission était d'aller jusqu'aux extrémités de la Terre. François, le plus grand missionnaire depuis l'apôtre Paul, est mort au large de la Chine, après avoir évangélisé en Inde et au Japon.
Ignace a apporté son expérience militaire - combattant pour la gloire terrestre - au combat pour les âmes. De Rome, non seulement il envoya François Xavier en Extrême-Orient, mais les fils de saint Ignace furent les premiers missionnaires en Nouvelle-France et dans toute l'Amérique du Sud, en plus de devenir des martyrs en Europe protestante.
L'intérêt pour saint Ignace a connu un renouveau récemment, car de nombreux catholiques ont appris sa méthode de discernement à travers les Exercices Spirituels . Cette année, les jésuites célèbrent une « année ignatienne », commençant en mai dernier avec le 500e anniversaire de sa conversion et incluant cette année le 400e anniversaire de sa canonisation.
Saint Philippe Neri
Dans Redemptoris Missio , sa grande charte pour l'activité missionnaire, saint Jean-Paul II a enseigné que chaque chrétien doit être missionnaire et que chaque lieu est un territoire de mission.
Philip Neri a vécu cette réalité. Il voulait à l'origine partir à l'étranger comme Francis Xavier, mais son directeur spirituel lui a dit : « Rome sera tes Indes ». Rome était un territoire de mission !
Rome aux XVe et XVIe siècles était un gâchis spirituel. Pire que cela, c'était un scandale qui réclamait une réforme. Cette réforme produirait elle-même la douleur de la division dans la Réforme.
Saint Philippe a apporté cette réforme nécessaire à Rome même d'une manière tout à fait catholique. Il l'a fait en prêchant l'Evangile, de manière créative et séduisante, et en se consacrant au pardon des péchés dans le sacrement de pénitence.
Philippe était un génie pour se faire des amis et des pénitents, convertir ses amis et se lier d'amitié avec ses convertis. Il attirait plutôt qu'intimidait; il a proposé plutôt qu'imposé. De tous les saints de 1622, il était celui avec qui nous serions probablement le plus heureux de passer du temps, car sa joie était contagieuse - une contagion qui s'avérerait nécessaire pour soulager la lourdeur spirituelle de Rome.
Saint Isidore de Madrid
Contrairement aux quatre autres canonisés en 1622, il n'était pas un saint de la Réforme catholique. Il vécut quelques siècles plus tôt et mourut en 1130. Il ne doit pas être confondu avec le plus célèbre saint Isidore de Séville, bien qu'il porte le nom de ce saint.
Il est le saint patron de Madrid et était un agriculteur qui a vécu une vie conjugale sainte. En effet, sa femme, Maria, est également une sainte canonisée.
Saint Isidore nous enseigne le chemin ordinaire de la sainteté, même si le sien a été marqué par des événements miraculeux. Il a travaillé dur comme agriculteur et s'est également consacré à la prière, réalisant qu'une vie de prière n'était pas réservée aux prêtres et aux ordres religieux. Lui et Maria ont ouvert leur maison aux autres - en effet, certains des miracles de sa vie sont liés à sa capacité à nourrir plus d'invités qu'ils n'en avaient !
Saint Isidore a passé sa vie à faire des choses ordinaires d'une manière extraordinaire. Dépouillé des miracles, sa vie était faite de vie domestique quotidienne, version familiale du « Petit Chemin » de la Petite Fleur. Les autres saints de 1622 vécurent sur la grande scène de l'histoire ; Isidore a apporté le grand drame de l'histoire à sa famille, à sa maison et à ses travaux agricoles.
Saints de la Réforme
Les saints sont les réformateurs nécessaires à l' Ecclesia semper reformanda , l'Église étant toujours réformée. La réponse de l'Église à la Réforme protestante — doctrinalement et en termes de gouvernance et de pratique ecclésiale — est venue au Concile de Trente (1545-1563). C'était nécessaire et l'œuvre du Saint-Esprit.
Mais on peut dire qu'une réponse définitive fut donnée le 12 mars 1622, avec la plus grande canonisation de l'histoire. »
Ref. Les saints de 1622 : la réponse de Dieu aux crises dans l'Église

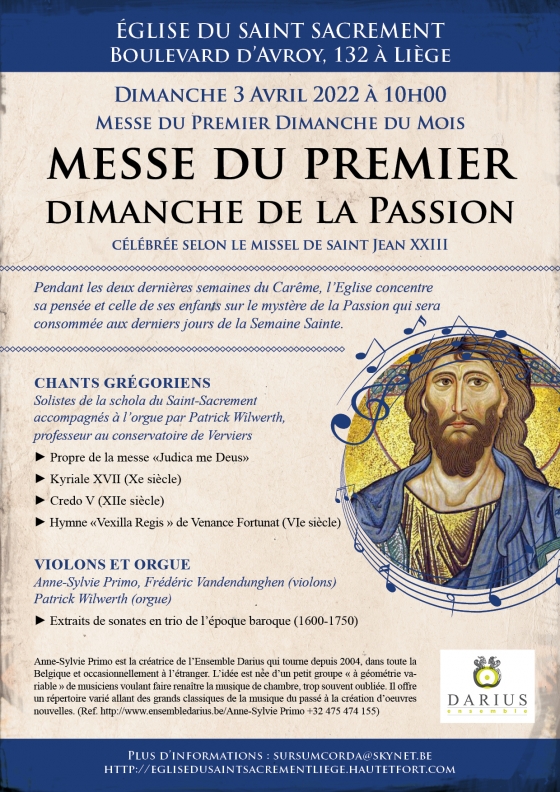



 « Elles ont pris leur bâton de pèlerin, direction le Vatican. Dimanche 6 mars, des mères de prêtres sont parties à pied de Paris afin de demander au pape François le plein rétablissement du rite tridentin dont il a récemment restreint l’usage par le motu proprio Traditionis custodes. Une démarche filiale effectuée à la fois pour leurs fils prêtres et pour tous les catholiques attachés à ce rite, fidèles habituels ou épisodiques de la messe dite de Saint Pie V, dont elles acheminent plus de 1500 suppliques adressées au Saint Père. Une marche « porteuse d’unité et de foi » dont l’étendard rappelle que « tous les chemins mènent à Rome ».
« Elles ont pris leur bâton de pèlerin, direction le Vatican. Dimanche 6 mars, des mères de prêtres sont parties à pied de Paris afin de demander au pape François le plein rétablissement du rite tridentin dont il a récemment restreint l’usage par le motu proprio Traditionis custodes. Une démarche filiale effectuée à la fois pour leurs fils prêtres et pour tous les catholiques attachés à ce rite, fidèles habituels ou épisodiques de la messe dite de Saint Pie V, dont elles acheminent plus de 1500 suppliques adressées au Saint Père. Une marche « porteuse d’unité et de foi » dont l’étendard rappelle que « tous les chemins mènent à Rome ».