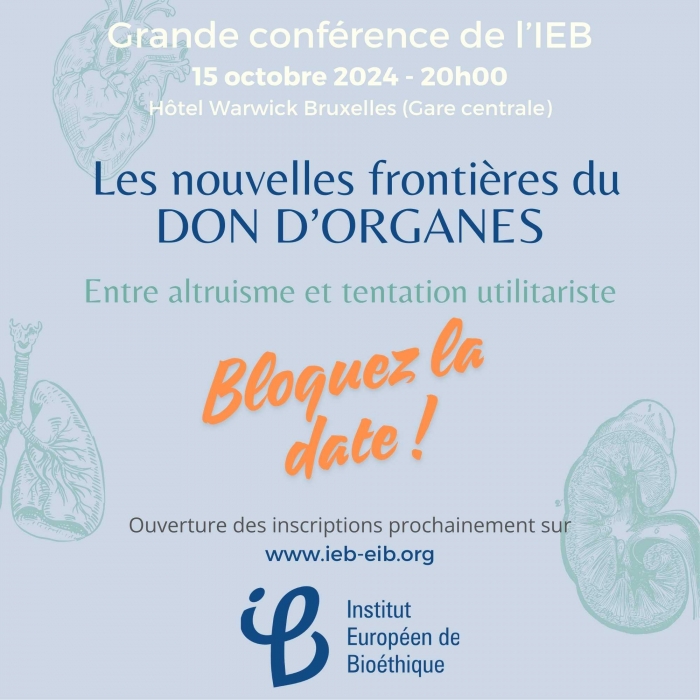De kath.net/news :

L’Association fédérale pour le droit à la vie à la Marche pour la vie : « Les gens ont un sentiment d’injustice »
22 septembre 2024
Malgré les diffamations, les tentatives de blocus antidémocratiques, malgré les réticences effrayantes de certaines commissions et les menaces de violence : le nombre de participants à Berlin et Cologne a légèrement augmenté, pour atteindre plus de 8 000 personnes - VIDEO
Berlin-Cologne (kath.net/Bundesverband Lebensrecht) « Malgré les diffamations, les tentatives de blocus antidémocratiques, malgré les réticences effrayantes de certains comités et les menaces de violence : cette année, comme c'est le cas depuis 2002, des milliers de personnes ont défilé pour la rue du droit à la vie pour tous - à Cologne comme à Berlin, le nombre de participants a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière, pour atteindre un total de plus de 8 000 personnes. C'est ce qu'explique Alexandra Linder, présidente de l'Association fédérale pour les droits de la vie, à propos de la marche pour la vie qui a eu lieu hier samedi à Berlin et à Cologne.
"La 20e Marche pour la vie à Berlin et la deuxième Marche pour la vie à Cologne ont montré une fois de plus ce qu'est le droit à la vie : une question d'inclusion, une protection des personnes au début et à la fin de leur vie, une aide à ceux qui sont harcelés et menacés. Des personnes en situation de vie difficile. Les invités du panel national et international l'ont illustré par diverses contributions : à Berlin, des membres de la communauté brésilienne Comunidade de Jesus Menino ont montré comment l'inclusion peut être vécue sur un pied d'égalité. La perspective éthique et universelle du droit à l'égalité. La vie a été illustrée par l'éthicien canadien Pablo Muñoz Iturrieta. L'apparition des deux fondateurs de la Marche pour la vie en 2002, Walter Schrader et Hartmut Steeb, était historiquement intéressante pour le BVL. Alicia Düren, présidente de l'organisation Sundaysforlife, a présenté l'avenir de la BVL. mouvement pour le droit à la vie : ils sont passionnés, jeunes, affirment et osent vivre et s'engagent dans la vie. Les Églises et communautés de foi étaient représentées, entre autres, par cinq évêques et évêques auxiliaires de l'Église catholique et des représentants de l'Alliance évangélique d'Allemagne. A Cologne, le directeur général du SPUC, John Deighan, a décrit son travail et le mouvement grandissant en Grande-Bretagne. Fabian, un jeune homme atteint du syndrome de Down, a fait une déclaration impressionnante en faveur de la vie et du droit à la vie. Le député du Bundestag Hubert Hüppe a souligné la sélection croissante d'enfants présentant des particularités génétiques. Le NIPT, le test sanguin prénatal qui recherche les particularités génétiques chez les enfants à naître, est utilisé beaucoup plus fréquemment que prévu, seulement dans des cas exceptionnels.
Les gens ont un sentiment d'injustice. C'est pourquoi ils accordent une attention particulière à la manière dont les politiciens traitent les personnes se trouvant dans des situations menaçantes au début et à la fin de leur vie. Et avec deux grandes manifestations vivifiantes, ils ont montré ce qu’ils attendaient de la politique. L'Association fédérale pour les droits de la vie et ses 15 associations membres abordent l'année électorale fédérale avec cinq exigences concrètes adressées aux hommes politiques."
Photo (c) Association fédérale pour le droit de la vie