Les chefs religieux en Belgique dénoncent l’euthanasie des enfants
(source : info.catho.be)
Ce mercredi 6 novembre 2013, les responsables des principales religions en Belgique ont exprimé leur très grande crainte de voir la mort banalisée par le législateur. Alors que le Sénat discute actuellement de l’euthanasie des enfants, les chefs religieux regrettent que ce débat tourne autour de la condamnation des personnes qui souffrent et non pas autour de leur accompagnement.
Communiqué des chefs religieux en Belgique au sujet de l’euthanasie
Alors qu’au Parlement on se penche à nouveau sur un élargissement possible de la loi de 2002 dépénalisant l’euthanasie, nous voulons une fois encore faire entendre notre voix dans ce débat qui concerne toute la société, en tant que citoyens en nous appuyant sur des arguments philosophiques, et en tant que croyants héritiers de nos traditions religieuses respectives.
Nous marquons notre opposition à ces extensions et exprimons notre vive inquiétude face au risque de banalisation croissante d’une réalité aussi grave.
Nous aussi, nous sommes contre la souffrance, tant physique que morale, en particulier celle des enfants, car toute souffrance révolte. Mais proposer que des mineurs puissent décider de leur propre euthanasie est une manière de fausser leur faculté de jugement et dès lors leur liberté.
Proposer que des personnes démentes puissent être euthanasiées est un déni de leur dignité et les livre au jugement, voire à l’arbitraire, des personnes qui prennent cette décision.
Quant au corps médical et au personnel soignant, on fait pression sur eux à pratiquer un acte soi-disant médical.
Au lieu de soutenir la personne souffrante en rassemblant autour d’elle toutes les personnes et les forces qui l’entourent, on risque précisément de diviser ces forces et dès lors d’isoler cette personne souffrante, de la culpabiliser et de la condamner à la mort.
Le consentement prévu par la loi tend à devenir de plus en plus une réalité sans consistance. La liberté de conscience des personnes concernées risque de ne pas être sauvegardée.
L’euthanasie des personnes fragiles, enfants ou personnes démentes, est une contradiction radicale de leur condition d’êtres humains.
Nous ne pouvons dès lors entrer dans une logique qui conduit à détruire les fondements de la société.
Pasteur Steven Fuite, président de l’Église Protestante Unie de Belgique
Rabbin Albert Guigui, Grand Rabbin de Bruxelles
Chanoine Robert Innes, président du Comité Central de l’Église Anglicane en Belgique
Monseigneur André-Joseph Léonard, président de la Conférence Épiscopale de Belgique
Monsieur Geert Lorein, président du Synode Fédéral des Églises Protestantes et Évangéliques de Belgique
Métropolite Panteleimon Kontogiannis, Exarque du Patriarcat Œcuménique de Constantinople (Église Orthodoxe)
Monsieur Semsettin Ugurlu, président de l’Exécutif des Musulmans de Belgique
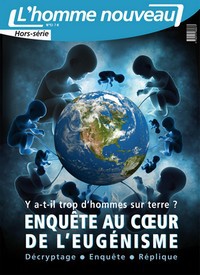



 Dans un article publié par le mensuel « La Nef » de ce mois de novembre (n° 253), Grégor Puppinck, directeur de l'European Centre for law and Justice, observe que la discrimination antichrétienne qui sévit en Europe n’est autre que la violence par laquelle une nouvelle vision de l’homme prétend remplacer l’anthropologie traditionnelle héritée de la civilisation judéo-chrétienne. Extraits :
Dans un article publié par le mensuel « La Nef » de ce mois de novembre (n° 253), Grégor Puppinck, directeur de l'European Centre for law and Justice, observe que la discrimination antichrétienne qui sévit en Europe n’est autre que la violence par laquelle une nouvelle vision de l’homme prétend remplacer l’anthropologie traditionnelle héritée de la civilisation judéo-chrétienne. Extraits : Dans la lignée du Manuel Bioéthique des Jeunes, et suite à l’introduction des notions de genre dans les ouvrages scolaires de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) de 1ère, la Fondation Jérôme Lejeune met à disposition Théorie du genre et SVT : décryptage des manuels de 1ère.
Dans la lignée du Manuel Bioéthique des Jeunes, et suite à l’introduction des notions de genre dans les ouvrages scolaires de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) de 1ère, la Fondation Jérôme Lejeune met à disposition Théorie du genre et SVT : décryptage des manuels de 1ère.