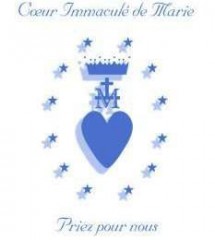« On ne sait pas encore vraiment qui est le pape Léon », a fait remarquer mon ami. « Pour l'instant, on est dans l'ère post-François », a-t-il poursuivi, « et je ne pense pas qu'on verra l'ère Léon avant l'année prochaine. »
Mon ami – qui se trouve être également le rédacteur en chef de Crux, Charles Collins – a fait ces remarques à la BBC le jour de Noël, avant la toute première bénédiction urbi et orbi de Noël du pape Léon XIV.
Cela m'a semblé être une déclaration succincte d'une perspicacité et d'une profondeur remarquables, qu'aucun autre observateur du Vatican n'a aussi bien formulée que Collins au cours des neuf mois qui ont suivi l'élection de Léon, à l'exception d'Andrea Gagliarducci (notamment dans ses chroniques du lundi sur le Vatican), un autre vieil ami cher et observateur chevronné des affaires romaines.
« Le pontificat de Léon XIV n'a pas encore véritablement commencé », a déclaré Gagliarducci dans sa chronique de la semaine dernière – ce n'est pas la première fois qu'il tient de tels propos – mais il a également souligné que nous pouvons entrevoir ce que sera, selon lui, le pontificat de Léon XIV, lorsque ce dernier aura pleinement affirmé son pouvoir.
« Un pontificat non pas de rupture, mais d’ajustement », écrivait Gagliarducci. « Non pas un pontificat de restauration », mais « un pontificat de renouveau », tout en s’inscrivant dans les traditions de la charge et de l’Église pour lesquelles elle est conférée.
Ceux qui espéraient un abandon et un renversement rapides de certaines des mesures les moins populaires de François allaient forcément être déçus – et ils l'ont été, en grande partie – mais il y a un sens significatif dans lequel ceux qui espéraient une continuité parfaite avec François – un François II en tout sauf le nom – allaient de toute façon avoir la tâche plus difficile.
« Les prières des deux n’ont pu être exaucées », pour reprendre les mots du président américain Abraham Lincoln, « et celles d’aucun des deux n’ont été pleinement exaucées. »
« Le Tout-Puissant », a déclaré Lincoln, « a ses propres desseins. »
François était une anomalie, une force perturbatrice et une présence cyclonique au sein de la papauté, qui a libéré des énergies considérables sans les maîtriser ni les canaliser. Selon ses propres termes (ou ceux de ses plus proches conseillers), François décrivait sa méthode comme consistant à « initier des processus » plutôt qu’à « dominer les espaces », car « le temps est plus grand que l’espace ».
« Une réforme en cours », c’est ainsi que Gagliarducci a décrit l’approche de François pour remodeler le Vatican et l’Église, tandis que le père jésuite Antonio Spadaro a qualifié le leadership de François d’« ouvert et incomplet ».
Le grand paradoxe de l'ère François était que François ait rejeté les attributs du règne papal tout en exerçant ouvertement le pouvoir brut de la fonction, et donc, au nom d'une « saine décentralisation », ce qui concentrait le pouvoir dans la personne du pontife, qui l'exerçait ensuite.
François a certainement bouleversé les choses au Vatican et dans l'Église – le fait qu'il était grand temps de procéder à un bouleversement était l'un des rares points sur lesquels les membres de l'Église, de tous bords politiques, s'accordaient lors de son élection – mais après douze années de son leadership fulgurant, les problèmes structurels et culturels à l'origine du dysfonctionnement dont il avait hérité étaient – et sont toujours – présents.
Le travail de son successeur – quel qu’il soit – consisterait de toute façon à consolider, à organiser. Il s’agirait toujours d’un travail d’« absorption », pour reprendre le terme de Gagliarducci, et cela exige un institutionnaliste.
En la personne de Léon XIV, nous avons un homme institutionnaliste par nature et par tempérament, dont la biographie suggère qu'il est particulièrement et peut-être même uniquement apte à relever les défis du moment présent.
Le meilleur ouvrage jamais écrit sur le pape Léon XIV est sans doute * El Papa León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI* , par Elise Ann Allen, collaboratrice de Crux, et bientôt disponible en anglais sous le titre * Pope Leo XIV: Global Citizen, Missionary of the 21st Century *. Allen a également obtenu pour Crux la première interview du pape Léon XIV, que vous pouvez lire ici (liens vers les parties 2 à 6 en bas de l'article).
Pour éviter d'être accusé de me sous-estimer, il convient de mentionner que les lectures de Collins et de Gagliarducci du pontificat léonin in fieri peuvent être considérées comme prolongeant une observation que cet observateur du Vatican a faite le jour de son élection.
« Il est – si je puis dire – un théologien modéré, d'après ce que je peux en juger », ai-je déclaré à Ryan Piers de LNL, quelques minutes après la première apparition de Léon sur la loggia. « Je pense que nous ne savons pas vraiment qui il est tant qu'il ne nous l'a pas montré, et qui il est dans la fonction de Pierre sera forcément très différent de qui il était en tant que "citoyen privé", pour ainsi dire. »
« Donc, » ai-je dit, « il s'agit vraiment d'un moment où il faut attendre et voir. »
« Ceci dit », ai-je conclu, « le choix de « Léon » – celui qui fut le père de la doctrine sociale catholique à l’époque moderne – est très révélateur, mais encore une fois, nous allons attendre et voir. »
Avec la fermeture de la Porte Sainte à Saint-Pierre pour la solennité de l'Épiphanie, le 6 janvier – marquant la fin de l'Année jubilaire ordinaire de l'Espérance (inaugurée par le pape François lors de ce qui s'est avéré être la dernière année de son pontificat) – et l'ouverture du premier consistoire extraordinaire convoqué par le pape Léon XIV le 7 janvier, l'attente touche peut-être à sa fin et la nouvelle ère léonine est sur le point de s'établir pleinement.
Si l'on en croit la lettre – obtenue par Crux – que Léon a envoyée aux cardinaux avant Noël, les premiers pas seront à la fois prudents et décisifs.
Une relecture de l'Evangelii gaudium de François – le premier document majeur du pontificat de François à avoir été entièrement l'œuvre de François lui-même – et une « plongée en profondeur » (It. approfondimento ) dans la constitution apostolique de François, Praedicate Evangelium, sont toutes deux à l'ordre du jour.
Il en va de même pour le « synode et la synodalité », notamment dans l’optique d’une « collaboration efficace avec le pontife romain, sur les questions d’importance majeure, pour le bien de toute l’Église ».
Le dernier point sur la liste des choses que Léon doit considérer avant le consistoire est « la liturgie : une réflexion théologique, historique et pastorale profondément éclairée "pour conserver la saine (Lt. sana) tradition et ouvrir néanmoins la voie à un progrès légitime" », comme l'ont formulé les Pères du Concile Vatican II dans leur constitution sur la liturgie sacrée, Sacrosanctum Concilium .
C'est beaucoup.
Ce n'est là qu'une infime partie de ce qui se trouvait dans le corbillard papal lorsque Léon est entré en fonction, mais le sage dirigeant sait qu'il ne faut pas tout tenter en même temps.


 C’est le mardi 6 janvier que tombe la fête de l’Épiphanie. Dans les églises, elle est pourtant célébrée ce dimanche 4 janvier. Trois questions pour mieux pour comprendre.
C’est le mardi 6 janvier que tombe la fête de l’Épiphanie. Dans les églises, elle est pourtant célébrée ce dimanche 4 janvier. Trois questions pour mieux pour comprendre.