 L’instabilité dramatique de la Région des Grands Lacs Africains fait suite à l’effondrement de la présence belge au Congo, au Rwanda et au Burundi face aux luttes tribales dont les prémices sanglantes remontent (les coloniaux belges en conservent aujourd’hui encore une vive mémoire) à la Toussaint 1959 : trois ans avant la disparition totale de la puissance tutélaire de la Belgique dans cette zone aujourd’hui transfrontalière.
L’instabilité dramatique de la Région des Grands Lacs Africains fait suite à l’effondrement de la présence belge au Congo, au Rwanda et au Burundi face aux luttes tribales dont les prémices sanglantes remontent (les coloniaux belges en conservent aujourd’hui encore une vive mémoire) à la Toussaint 1959 : trois ans avant la disparition totale de la puissance tutélaire de la Belgique dans cette zone aujourd’hui transfrontalière.
Né à Bukavu en 1955, le Docteur Denis Mukwege était alors trop jeune pour avoir été marqué par le souvenir de ces jours funestes sonnant la fin de la « Pax Belgica ». Mais, plus tard, ses fonctions médicales, puis son engagement humanitaire et son prix Nobel de la Paix en 2018, l’ont mêlé de près à cette triste histoire sans fin. Comme le fut, en son temps, celle de Mgr Christophe Munzihirwa, archevêque jésuite de Bukavu assassiné en 1998 (son procès de béatification est en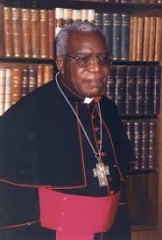 cours) c'est la vie du Dr Mukwege qui est, une nouvelle fois, aujourd’hui menacée.
cours) c'est la vie du Dr Mukwege qui est, une nouvelle fois, aujourd’hui menacée.
La notice qui suit, rédigée par Colette Braeckmann, a le mérite utile de décrire l’imbroglio funeste dans lequel les indépendances, octroyées sans transitions sérieuses, ont jeté le monde postcolonial. Plutôt que celui de la colonisation c’est le procès de la décolonisation qui mériterait d’être intenté, en Belgique ou ailleurs. JPSC
" La sécurité du Docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, est- elle menacée au départ du Rwanda ? Les propos tenus par James Kabarebe, conseiller du président Kagame et qui dirigea les guerres menées au Congo au lendemain du génocide, ont semé l’inquiétude et le président Tshisekedi a demandé que des mesures de sécurité soient prises.
S’exprimant à l’occasion d’une interview télévisée pour laquelle il est apparu en uniforme, le général Kabarebe, qui dirigea la guerre menée au Congo par les Forces armées rwandaises en soutien à l’AFDL (Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo) dirigée par Laurent Désiré Kabila nie fortement le fait que les RDF (Rwanda defense forces) aient massacré des réfugiés rwandais lors de l’ offensive menée au Kivu en 1996-97. Rappelons qu’à la fin du génocide en 1994, à la faveur de l’opération française Turquoise, près de deux millions de civils hutus, poussés par la peur des représailles et entraînés par les auteurs du génocide, avaient fui en direction des pays voisins, dont le Zaïre de Mobutu.
L’officier rwandais a rappelé que dans les immenses camps qui s’égrenaient alors sur la frontière entre le Rwanda, le Nord et le Sud Kivu, les civils soutenus par l’aide humanitaire avaient été pris en otages par les hommes en armes. Ces derniers les utilisaient comme « boucliers humains » et se protégeaient derrière eux. Rappelant la version donnée par Kigali depuis 1996/1997, le général Kabarebe insiste sur le fait que l’objectif des RDF était de forcer le retour au Rwanda des Hutus réfugiés au Zaïre afin qu’ils puissent se réintégrer dans la société et il rappelle que par la suite l’état rwandais paya même les études des enfants de nombre d’entre eux.
D’après lui, ce retour des réfugiés fut mal perçu par les ONG qui se trouvaient alors au Kivu car nombre d’entre elles auraient souhaité garder sous leur emprise ces civils dépendant de l’aide internationale. Selon Kabarebe, le dépit ressenti par les humanitaires, bien plus que l’indignation, serait l’une des motivations du « rapport Mapping », une cartographie des crimes commis au Congo entre 1993 et 2003. Ce document onusien, sorte de catalogue d’une décennie d’horreurs, a toujours été récusé par Kigali et à l’époque, le Rwanda menaça même, en cas de publication, de retirer ses troupes présentes au Darfour sous l’ uniforme de l’ONU.
Depuis une décennie, ce rapport explosif se trouve dans les tiroirs de l’ONU, tandis que le Docteur Mukwege, au nom de la justice, réclame précisément la publication du document, la divulgation du nom des principaux accusés, et la mise sur pied d’un tribunal international sur le Congo.
Récusant les arguments du médecin congolais, James Kabarebe ne se contente pas de nier la réalité des massacres, comme le fait aussi l’ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. Il déclare aussi, textuellement, que « le Docteur Mukwege, originaire du Sud Kivu, de la tribu des Bashi, est comme tant d’autres qui avaient intérêt à ce que les réfugiés rwandais ne puissent rentrer chez eux car ils en tiraient des bénéfices… » Si ces propos, tels qu’ils ont été communiqués à la presse, ne représentent pas une menace de mort explicite, ils sont cependant inquiétants compte tenu de la personnalité de leur auteur et de la qualité de leur cible. Rappelons en effet que l’un des premiers massacres de la première guerre du Congo fut commis à l’hôpital de Lemera, où travaillait le docteur Mukwege. Les combattants de l’AFDL, considérant peut-être que des réfugiés hutus étaient soignés ou accueillis dans cet hôpital protestant, ne firent pas de quartier : les malades furent achevés sur leur lit et le personnel soignant, 35 personnes, fut tué par les assaillants. Si le futur prix Nobel échappa à cette tuerie, c’est parce qu’il venait de prendre la route de Bukavu pour y convoyer un de ses collègues médecins mais il fut durablement marqué par cette tragédie.
Les propos de James Kabarebe, interprétés comme des menaces à peine dissimulées, ont suscité une tempête de protestations sur les réseaux sociaux congolais et étrangers. Qu’il s’agisse de l’ambassadeur des Etats Unis à Kinshasa Mike Hammer et d’autres diplomates occidentaux ou de nombreuses ONG défendant les droits de l’homme, comme Physician for Human rights, la pression est montée pour exiger un renforcement du dispositif de sécurité autour du médecin-chef de Panzi et depuis Kinshasa le président Tshisekedi a lui aussi demandé une enquête.
L’enchaînement des faits actuels remonte à juillet dernier lorsque la localité de Kipupu, au Sud Kivu, fut endeuillée par le massacre de plus de 220 villageois (un chiffre contesté depuis Kigali, où il n‘est question que de douze morts mais qui nous fut confirmé par plusieurs sources locales). Depuis des mois, dans cette région montagneuse voisine du Burundi et du Rwanda, les groupes armés se croisent, traversent les frontières et font régner une insécurité généralisée : certaines milices sont hostiles au pouvoir de Bujumbura, d’autres sont composées d’opposants à Kigali, qu’il s’agisse de troupes du RNC (Rwanda national congres, dirigé par le général Kayumba) ou de groupes de Hutus membres des FDLR. Sans oublier les Mai Mai congolais Yakutumba, plusieurs groupes d’autodéfense locaux, ( d’ethnie Bembe, Bavira, Fuliro) et aussi les Tutsis congolais Banyamulenge. Installés dans les haut plateaux au dessus de la ville d’Uvira, la nationalité de ces derniers est contestée. Ils sont accusés d’être les avant postes de Kigali, tandis que leurs troupeaux sont régulièrement décimés par des groupes armés de diverses obédiences installés dans la plaine de la Ruzizi. Dans ce contexte explosif, marqué par l’insécurité et la haine ethnique, tout indique que Kipupu a été le théâtre d’une sanglante vengeance, comme à Mutarule voici une dizaine d’années, où des militaires tutsis intégrés dans l’armée congolaise avaient fait payer chaque tête de bétail abattu par trente vies humaines…
Indigné par les évènements de Kipupu, le Docteur Mukwege avait dénoncé l’absence de protection des civils mais surtout, en termes très durs, il avait affirmé que cette tuerie se situait dans la droite ligne des massacres commis depuis 1996 en RDC, « ce sont les mêmes… ». Autrement dit, il avait attribué ces tueries à des hommes armés dépendant du régime de Kigali, sans rappeler le fait qu’à l’époque, parmi les réfugiés hutus se trouvaient aussi de nombreux auteurs du génocide qui commirent bien des atrocités à l’encontre des populations congolaises.
Le plaidoyer développé par le docteur Mukwege, qui plaide aussi en faveur d’un futur Tribunal international pour le Congo, irrite Kigali pour plusieurs raisons : tout d’abord parce que le rapport met en cause la responsabilité d’officiers rwandais –dirigés par James Kabarebe- ayant mené les deux guerres du Congo et que l’évocation des massacres ternit l’image du régime. Dans la violence et la confusion qui régnaient à l’époque, le décompte des morts n’a jamais été fait et des chiffres invérifiables sinon invraisemblables, se chiffrant en millions, furent avancés. L’agacement de Kigali est aussi politique : depuis sa parution voici dix ans, le rapport Mapping – d’autant plus redoutable qu’il est gardé sous le boisseau- est utilisé dans la guerre de propagande qui se mène depuis un quart de siècle entre Kigali et les milieux français qui, après avoir soutenu les extrémistes hutus et les avoir exfiltrés, les protégèrent durant leur exil au Congo et ailleurs.
C’est dans ce contexte tendu qu’il faut lire et interpréter les propos de James Kabarebe : même s’ils ne recèlent pas de menaces explicites, ils sont inquiétants au vu de la personnalité de leur auteur, par ailleurs soutenu par des articles de fond publiés dans la presse rwandaise . Il est évident aussi que Kigali n’a pas apprécié le patronage accordé par le Docteur Mukwege à un colloque qui s’est tenu l’an dernier dans l’enceinte du Sénat français et intitulé « Afrique des Grands Lacs, soixante ans d’instabilité ». Plusieurs auteurs ouvertement hostiles au Rwanda, comme Charles Onana et Judi Rever, avaient été invités et c’est en dernière minute que le Prix Nobel, obligé de regagner le Kivu pour raisons de famille, avait renoncé à assister à la rencontre…"
Ref. Les propos tenus à Kigali par James Kabarebe visent le Docteur Mukwege
JPSC


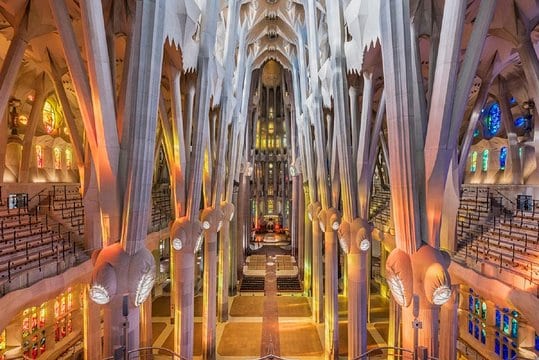
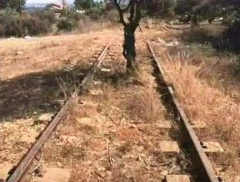 « Deux paons paressent avec nonchalance sur l’émeraude rase d’un gazon qui ferait pâlir d’envie le jardinier de St. Andrews. Des pièces d’eau à jet central chuintent dans l’air brûlant. La maison, établie sur près de cinq cents mètres carrés, en impose. L’intérieur, tout de marbre, de porphyre et d’or, surprend dans ce pays, l’un des plus pauvres de la planète. Dans le garage, quatre Mercedes. Il y a dix ans, modeste directeur de banque africaine, j’avais rendez-vous avec le ministre des Finances de l’un de ces pays d’
« Deux paons paressent avec nonchalance sur l’émeraude rase d’un gazon qui ferait pâlir d’envie le jardinier de St. Andrews. Des pièces d’eau à jet central chuintent dans l’air brûlant. La maison, établie sur près de cinq cents mètres carrés, en impose. L’intérieur, tout de marbre, de porphyre et d’or, surprend dans ce pays, l’un des plus pauvres de la planète. Dans le garage, quatre Mercedes. Il y a dix ans, modeste directeur de banque africaine, j’avais rendez-vous avec le ministre des Finances de l’un de ces pays d’

