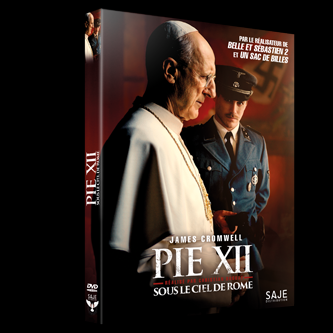Le site « didoc » reprend cet article du professeur Miguel Pastorino publié dans « aleteia »
« En 1969, Joseph Ratzinger, à l’époque théologien, écrivait dans son œuvre « Introduction au christianisme » un bref chapitre sur l’Église qui commençait d’une manière qui peut nous paraître quelque peu familière actuellement.
 « Parlons également de ce qui nous accable de nos jours. N’essayons pas de le cacher ; aujourd’hui nous sommes tentés de dire que l’Église n’est ni sainte, ni catholique… L’histoire de l’Église est remplie d’humains corrompus. Nous pouvons comprendre l’horrible vision de Dante qui voyait monter dans la voiture de l’Église les prostituées de Babylone, et nous comprenons les terribles mots de Guillaume d’Auvergne (XIIIe siècle), qui affirmait que nous devrions trembler face à la perversion de l’Église : « L’Église n’est plus une épouse, mais un monstre effrayant, difforme et sauvage… »
« Parlons également de ce qui nous accable de nos jours. N’essayons pas de le cacher ; aujourd’hui nous sommes tentés de dire que l’Église n’est ni sainte, ni catholique… L’histoire de l’Église est remplie d’humains corrompus. Nous pouvons comprendre l’horrible vision de Dante qui voyait monter dans la voiture de l’Église les prostituées de Babylone, et nous comprenons les terribles mots de Guillaume d’Auvergne (XIIIe siècle), qui affirmait que nous devrions trembler face à la perversion de l’Église : « L’Église n’est plus une épouse, mais un monstre effrayant, difforme et sauvage… »
La catholicité de l’Église nous semble tout aussi problématique que la sainteté. Les partis et les batailles ont divisé la tunique du Seigneur, ont divisé l’Église en de nombreuses Églises qui prétendent être, de manière plus ou moins vive, la seule vraie et unique Église. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui l’Église est devenue pour de nombreuses personnes l’obstacle principal à la foi. On ne peut voir en elle que la lutte pour le pouvoir humain, le misérable théâtre de ceux qui, avec leurs affirmations, veulent absolutiser le christianisme officiel et paralyser le réel esprit du christianisme ».
Il l’affirme de la manière la plus claire et dure qu’il soit, convaincu qu’on ne peut réfuter ces arguments et que cette perception se base non seulement sur des raisons fondées, mais aussi sur des cœurs déçus et blessés qui ont vu leurs attentes s’effondrer. Et c’est à partir de là, de ce contraste entre l’opinion que l’on a de la foi et ce que l’on perçoit dans la réalité, qu’on se demande : « Pourquoi, en dépit de tout, aimons-nous l’Église ? »
Église sainte ?
« Église sainte » ne sous-entend pas que chacun de ses membres est saint, immaculé. Joseph Ratzinger soutient que le rêve d’une église immaculée renaît à toutes les époques mais n’a pas sa place dans le Credo, et qu’en réalité les critiques les plus vives envers l’Église viennent de ce rêve irréaliste d’une église immaculée.
« La sainteté de l’Église réside dans ce pouvoir de sanctification que Dieu exerce malgré le caractère pécheur de l’homme. Elle est donnée par Dieu comme une grâce, qui subsiste en dépit de l’infidélité de l’homme. C’est l’expression de l’amour de Dieu qui ne se laisse pas vaincre par l’incapacité de l’homme, mais qui continue, malgré tout, à être bon avec celui-ci, il ne cesse de l’accueillir justement en tant que pécheur, il se tourne vers lui, il le sanctifie et l’aime. »
Tout comme ce qui est gratuit ne dépend pas du mérite des croyants, la sainteté de l’Église est celle du Christ, pas la nôtre. « Mais c’est toujours vraiment la sainteté du Seigneur qui se fait présente ici, et il choisit aussi et justement les mains sales des hommes comme réceptacle de sa présence. »
Pour Joseph Ratzinger, la déconcertante association de la sainteté de Dieu et de l’infidélité de l’homme est l’aspect dramatique de la grâce de ce monde, car elle rend visible l’amour gratuit et inconditionnel de Dieu, qui hier comme aujourd’hui s’assied à la table des pécheurs.
Le rêve d’un monde pur
L’idée selon laquelle l’Église ne se mêle pas au péché est une pensée simpliste et dualiste, qui présente une image idéale et noble, mais pas réelle. Joseph Ratzinger rappelle que ce qui était déjà perçu comme scandaleux dans la sainteté du Christ, aux yeux de ses contemporains, était qu’il ne faisait pas descendre le feu sur ceux qui étaient indignes et ne cherchait pas la pureté en séparant le blé de l’ivraie.
« La sainteté de Jésus se manifestait précisément dans ses rencontres avec les pécheurs, qu’il attirait à lui, en complète communauté de destin avec les égarés, révélant ainsi ce qu’est la véritable sainteté : non pas une séparation mais une unification ; non pas un jugement mais un amour rédempteur. »
Les questions qui surviennent de cette manière de voir les choses sont effroyables, mais pleines d’espoir : « L’Église n’est-elle pas simplement la poursuite de cet abandon de Dieu à la misère humaine ? N’est-elle pas la continuation des repas pris par Jésus avec les pécheurs ? N’est-elle pas la continuation de ses contacts avec la pauvreté du péché, au point d’avoir l’air d’y sombrer ? Dans la sainteté de l’Église, bien peu sainte par rapport à l’attente humaine d’une pureté absolue, n’y a-t-il pas la révélation de la véritable sainteté de Dieu qui est amour, un amour qui toutefois ne se réfugie pas dans le noble détachement de l’intangible pureté, mais qui se mêle à la saleté du monde de façon à la nettoyer ? La sainteté de l’Église peut-elle être autre chose que le fait que les uns portent les charges des autres, ce qui vient évidemment, pour tous, du fait que tous sont soutenus par le Christ ? »
S’aider les uns les autres, car Il a porté le fardeau avec nous
Il confesse, de sa plume toujours lucide et transparente, que la sainteté presque imperceptible de l’Église a quelque chose de consolateur. Parce que nous serions découragés face à une sainteté immaculée, dévastatrice et qui nous juge ; une sainteté qui ne comprendrait pas la fragilité humaine et qui n’offrirait pas toujours le pardon à celui qui se repent de tout son cœur. En réalité, nous devrions tous être radiés de l’Église si elle était une communauté de personnes qui méritent un prix pour leur perfection.
Ceux qui vivent en étant conscients d’avoir besoin du soutien des autres ne pourront pas refuser de porter le poids de leurs frères. La seule consolation que la communauté chrétienne peut offrir est de porter les autres comme on est nous-mêmes portés.
Ce qui importe réellement aux croyants
L’idée réductrice que l’on se fait de l’Église ne tient pas compte de l’opinion qu’a l’Église d’elle-même, ni de son centre, Jésus-Christ. La particularité de l’Église se situe au-delà de son organisation, « dans la consolation de la Parole de Dieu et des sacrements qu’elle apporte dans les jours de joie ou de tristesse. »
« Les vrais croyants ne donnent jamais une importance excessive à la lutte pour la réorganisation des formes ecclésiales. Ils vivent de ce que l’Église est toujours. Si l’on veut savoir ce qu’est vraiment l’Église, c’est eux qu’il faut aller voir. L’Église n’est pas là où l’on organise, où l’on réforme, où l’on dirige ; elle est présente en ceux qui croient avec simplicité et qui reçoivent en elle le don de la foi, qui devient pour eux source de vie. »
Pour Joseph Ratzinger, l’Église vit de la lutte de ceux qui ne sont pas saints pour parvenir à la sainteté, mais c’est une lutte qui n’est constructive que si elle est portée par un authentique et véritable amour. Une Église aux portes fermées détruit ceux qui sont à l’intérieur, et Joseph Ratzinger considère qu’il est une illusion de croire qu’en nous isolant du monde, on peut le rendre meilleur, car c’est aussi une illusion de croire en une « Église des Saints », car ce qui existe réellement est une « Église sainte », car « le Seigneur lui prodigue le don de la sainteté, sans aucun mérite de notre part. »
Miguel Pastorino est professeur de philosophie et écrit régulièrement sur Aleteia. Ce texte a été publié sur ce site le 30 août sous le titre : Comment garder la foi quand l’Église est frappée par de graves scandales ? Source : https://fr.aleteia.org/2018/08/30/comment-garder-la-foi-quand-leglise-est-frappee-par-de-graves-scandales/. Lire aussi "Pourquoi suis-je encore dans l'Eglise ?".
Ref. Peut-on croire en la sainteté de l’Eglise ?
Sans autre commentaire, le petit catéchisme de notre enfance disait, dans une formule lapidaire mais juste : l’Eglise est sainte parce que son chef Jésus-Christ est saint. Point à la ligne. L’idée selon laquelle l’Église ne se mêle pas au péché du monde est -peut-être- une image idéale et noble, mais pas réelle. Ignorer ou, pire, vouloir taire ou masquer le drame du monde déchu dans lequel nous vivons est une vue simpliste et dualiste. Et c’est une illusion de croire qu’en nous isolant de lui on peut le rendre meilleur, car c’est aussi une illusion de croire en une « Église des Saints » : ce qui existe réellement est une « Église sainte », car « le Seigneur lui prodigue le don de la sainteté, sans aucun mérite de notre part. ».
Une fois de plus, la pensée limpide du pape Benoît XVI remet chaque chose à sa juste place et le professeur Pastorino nous le rappelle opportunément.
JPSC
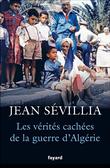
 « Parlons également de ce qui nous accable de nos jours. N’essayons pas de le cacher ; aujourd’hui nous sommes tentés de dire que l’Église n’est ni sainte, ni catholique… L’histoire de l’Église est remplie d’humains corrompus. Nous pouvons comprendre l’horrible vision de Dante qui voyait monter dans la voiture de l’Église les prostituées de Babylone, et nous comprenons les terribles mots de Guillaume d’Auvergne (XIIIe siècle), qui affirmait que nous devrions trembler face à la perversion de l’Église : « L’Église n’est plus une épouse, mais un monstre effrayant, difforme et sauvage… »
« Parlons également de ce qui nous accable de nos jours. N’essayons pas de le cacher ; aujourd’hui nous sommes tentés de dire que l’Église n’est ni sainte, ni catholique… L’histoire de l’Église est remplie d’humains corrompus. Nous pouvons comprendre l’horrible vision de Dante qui voyait monter dans la voiture de l’Église les prostituées de Babylone, et nous comprenons les terribles mots de Guillaume d’Auvergne (XIIIe siècle), qui affirmait que nous devrions trembler face à la perversion de l’Église : « L’Église n’est plus une épouse, mais un monstre effrayant, difforme et sauvage… »
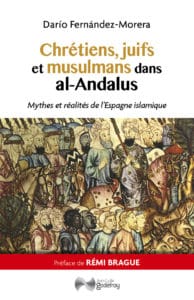
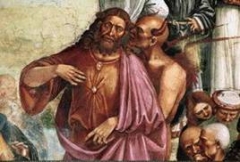
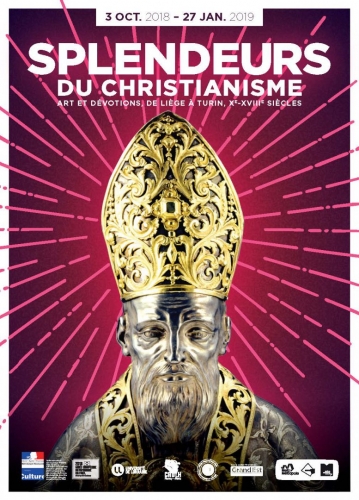 De Sophie Delhalle
De Sophie Delhalle