« Crois ou meurs ! », la Révolution française (source)
« Crois ou meurs ! Voilà l’anathème que prononcent les esprits ardents au nom de la liberté ! »
Historien, ancien Directeur de recherche au C.N.R.S., Claude Quétel est spécialiste de l’histoire de l’enfermement et de la psychiatrie. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont une Histoire de la folie (2012), une Histoire véritable de la Bastille (2013), ou encore le Larousse de la Seconde Guerre mondiale(2007) et Les femmes dans la guerre 1939-1945 (2006).
Et si la Révolution tout entière avait été un immense, un désolant gâchis, et ce dès les premiers jours ? Et si ce qui a été longtemps présenté comme le soulèvement de tout un peuple n’avait été qu’une folie meurtrière et inutile, une guerre civile dont l’enjeu mémoriel divise toujours les Français ?
Chaque grande nation, quel que soit son régime, déroule les hauts faits de son roman national. La Révolution française, tournant majeur de notre histoire, en est l’exemple le plus criant. « Crois ou meurs ! Voilà l’anathème que prononcent les esprits ardents au nom de la liberté ! » Ainsi s’indigne le journaliste Jacques Mallet du Pan dans le Mercure de France du 16 octobre 1789, tout au début de la Révolution.
Longtemps, celle-ci a été présentée et enseignée comme une histoire édifiante de bout en bout, retentissant de ses grandes dates, de ses grands hommes. Et puis le temps est venu de distinguer une bonne révolution, celle des droits de l’Homme, qui aurait « dérapé » pour aboutir à une mauvaise, celle de la Terreur. On en est encore là aujourd’hui, et l’on voit même des historiens de la Révolution relativiser la Terreur.
Eh bien voici l’heure de reprendre l’enquête en se demandant si ce ne fut pas la Révolution tout entière qui fut un immense, un désolant dérapage, et ce dès les premiers jours, dès les élections aux États généraux confisquées par l’intelligentsia, dès l’Assemblée Constituante, toujours considérée comme exemplaire, en proie à l’intimidation du public dans les tribunes ? Que fut-elle en réalité cette Révolution exemplaire, insoupçonnable ?
Ce livre n’a qu’une ambition, mais elle est grande : en faire le récit circonstancié, presque au jour le jour, en revisitant les événements, en décryptant le dessous des cartes, en se libérant de l’historiquement correct. Il s’adresse à tous ceux qui souhaitent qu’on leur raconte une autre histoire, la vraie.
Crois ou meurs !
Histoire incorrecte de la Révolution française
de Claude Quétel,
paru chez Tallandier,
à Paris, le 28 mars 2019,
507 pages.
ISBN-13 : 979-1021025721





























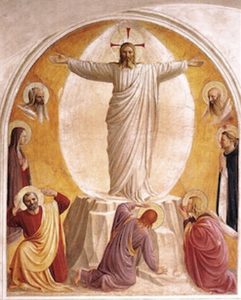

 Le 11 février 1979, l’ayatollah Khomeiny arrivait au pouvoir à Téhéran avec sa révolution islamique. Dans une société en crise, on observe aujourd’hui de nombreuses conversions au christianisme ! Point de la situation 40 ans après la révolution islamique.
Le 11 février 1979, l’ayatollah Khomeiny arrivait au pouvoir à Téhéran avec sa révolution islamique. Dans une société en crise, on observe aujourd’hui de nombreuses conversions au christianisme ! Point de la situation 40 ans après la révolution islamique.