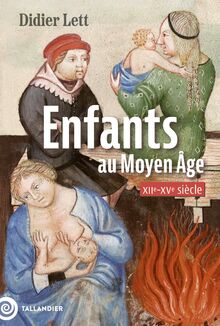De Stefano Gennarini, JD et Iulia-Elena Cazan sur C-Fam :
Les États-Unis à ONU Femmes : « Cessez de promouvoir l’idéologie du genre »

NEW YORK, 12 septembre (C-Fam) Des diplomates américains ont fustigé l'agence des Nations Unies pour les femmes pour avoir promu l'idéologie du genre et l'avortement, dénonçant les efforts de l'agence pour « éradiquer la réalité biologique du sexe ».
Sur instruction de l'administration Trump, les diplomates américains ont refusé d'approuver le nouveau plan stratégique quadriennal d'ONU Femmes et ont dénoncé le refus de l'agence de « protéger la réalité biologique ». La délégation américaine a voté contre la stratégie lors d'une réunion du conseil d'administration de l'agence mercredi. C'était la première fois que le plan stratégique de l'agence était soumis au vote, car il est généralement adopté à l'unanimité.
Alors que la délégation américaine a été la seule à voter contre le projet, dix autres délégations, principalement d'Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que l'Inde et la Russie, ont exprimé leurs inquiétudes quant au travail d'ONU Femmes sur le genre et les droits sexuels.
Un diplomate américain a déclaré à l'agence : « Nous ne pouvons pas approuver un plan qui comporte des éléments contraires à la politique américaine », notamment l'idéologie du genre. Il a affirmé que de telles politiques étaient « préjudiciables au bien-être des femmes et des filles ».
Le nouveau Plan stratégique d'ONU Femmes fait référence à « l'orientation sexuelle et l'identité de genre », à « la santé et les droits sexuels et reproductifs » et à l'intersectionnalité. Ces termes sont utilisés par les agences des Nations Unies pour promouvoir l'avortement, l'idéologie du genre et les droits sexuels des enfants. Bien que ces termes soient rejetés plusieurs fois par an par l'Assemblée générale des Nations Unies, les agences des Nations Unies et les donateurs occidentaux utilisent les plans stratégiques pour créer des mandats controversés pour les agences des Nations Unies, sans le soutien de l'ensemble des membres de l'ONU.
Le délégué américain a souligné qu’il n’existait aucun engagement international concernant ces termes controversés et qu’il n’existait aucun droit international à l’avortement.
« Au fil du temps, des idéologues radicaux ont utilisé un langage trompeur pour discréditer les femmes et déformer la réalité », a déclaré la déléguée américaine. « L'administration Trump rétablit la vérité en confirmant la réalité biologique et en défendant les femmes, les familles et les valeurs qui rendent l'Amérique plus forte que jamais. »
Les États-Unis ont spécifiquement demandé à ONU Femmes de reconnaître que « les femmes sont biologiquement des femmes et les hommes des hommes » et de « se concentrer sur sa mission principale, qui est de promouvoir la réussite des femmes et des filles. Les États-Unis s'opposent fermement à l'inclusion d'une idéologie sexiste néfaste, car nous estimons qu'elle nuit au bien-être des femmes et des filles. »
L’Arabie saoudite, le Burkina Faso, l’Ouganda, le Sénégal, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Paraguay, le Zimbabwe, la Mauritanie, la Russie et l’Égypte ont également fait des déclarations contre cette terminologie controversée.
Le délégué ougandais a souligné que « les organismes internationaux n'ont pas le pouvoir d'imposer de nouvelles obligations aux États souverains ». Il a pris ses distances avec les termes controversés du plan stratégique de l'agence des Nations Unies. « Mon pays, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, ne reconnaît pas ces notions comme des catégories juridiques. En fait, en raison de la fluidité et du caractère subjectif des concepts d'orientation et d'identité de genre, ces termes n'ont pas de signification juridique ou scientifique largement acceptée. »
Une déléguée indienne a également critiqué ONU Femmes. Elle a déploré que des questions telles que le genre et la pauvreté, l'éducation et le développement des compétences « semblent marginalisées » dans le nouveau plan stratégique.
« ONU Femmes doit également veiller à ne pas se laisser emporter par des discours qui s'appuient trop sur les points de vue des militants, des universitaires ou des groupes de défense, sans comprendre les réalités du terrain et les contextes sociaux. Si ces voix sont importantes, se fier excessivement à leurs contributions risque de négliger les complexités existantes », a-t-elle déclaré.
Un délégué russe a partagé les préoccupations exprimées par le gouvernement américain. « Nous comprenons et partageons pleinement les inquiétudes exprimées par la délégation américaine concernant le contenu du document », a-t-il déclaré. Il a accusé ONU Femmes de tenter d'isoler les peuples traditionnels par la censure, sous prétexte de lutter contre « un prétendu recul de l'égalité des sexes ». Il a également critiqué « l'utilisation d'une terminologie non approuvée en matière de genre », expliquant que « la promotion des concepts d'identité de genre et d'orientation sexuelle est absolument inacceptable pour notre délégation » et déplorant « la progression progressive des droits des minorités sexuelles ». Il a ajouté que ces questions « ne relèvent pas du mandat confié à ONU Femmes » et sèment « la discorde dans des sociétés qui choisissent de vivre selon des valeurs traditionnelles ».