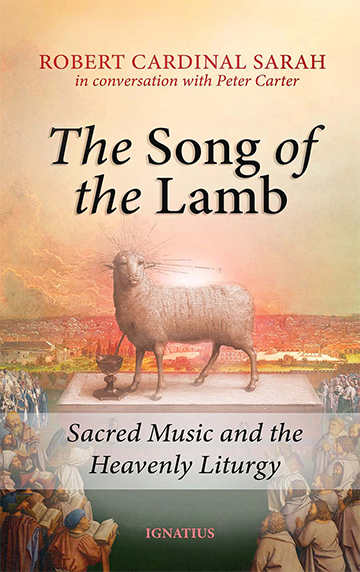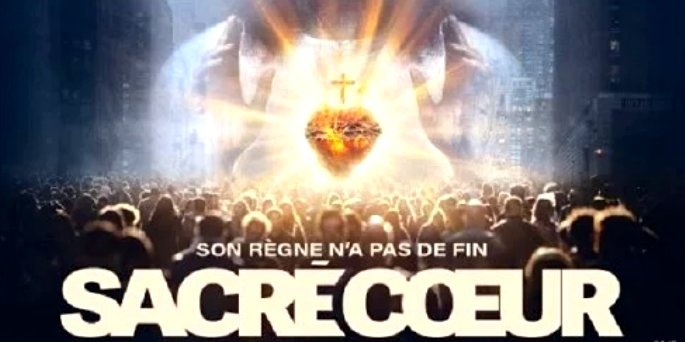De kath.net/news :

« La tragédie des 73 millions d'avortements pratiqués chaque année dans le monde est devenue la norme. »
19 novembre 2025
Argüello, président de la Conférence épiscopale espagnole : « Un groupe de médecins peut être déterminé à sauver un fœtus de cinq mois et demi, tandis qu’un autre groupe, juste à côté, tue délibérément un bébé du même âge. » Par Petra Lorleberg
Madrid (kath.net/pl) « Dans un même hôpital, un groupe de médecins peut décider de sauver un fœtus de cinq mois et demi, tandis qu'un autre groupe, dans la pièce voisine, tue délibérément un bébé du même âge. Ceci est parfaitement légal. De même, la loi peut punir la destruction d'un œuf d'aigle d'une amende de 15 000 euros et d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans de prison, mais autorise l'avortement d'un enfant atteint de trisomie 21 jusqu'à la fin de la grossesse. » C'est ce qu'a expliqué le président de la Conférence épiscopale espagnole, Luis Javier Argüello García, archevêque de Valladolid, dans son discours d'ouverture de la 128e Assemblée plénière à Madrid, mardi.
kath.net documente intégralement, la section « 6. L’inhumanité de l’avortement : derrière la fumée, les miroirs et les stratégies » du discours d’ouverture de l’archevêque Argüello :
Ces dernières semaines, la question de l'avortement a refait surface sous diverses formes : la tentative d'inscrire ce prétendu droit dans la constitution ; l'objection de conscience du personnel médical ; la divulgation aux mères de toutes les conséquences de l'intervention ; et les données du ministère de la Santé faisant état de 106 173 avortements et de 322 034 naissances pour 2024. La croissance démographique était négative, avec un déficit de 114 937 personnes.
Le débat a été critiqué – non sans raison – comme une manœuvre de diversion et un outil de polarisation. Qu’il s’agisse d’un repli sur soi ou d’un questionnement stratégique, il existe, en tout cas, une réticence sociétale et politique à aborder la question dans toute sa complexité dramatique. Comme le souligne Matthieu Lavagna, dont je m’appuie sur la pensée dans cette analyse, l’avortement demeure un sujet sensible et délicat dans notre société actuelle. En parler publiquement est devenu tabou, presque une atteinte à la vie privée. Quiconque déclare publiquement que l’avortement est objectivement immoral parce qu’il met fin à la vie d’une personne autre que ses parents s’expose à une sévère condamnation personnelle, sociale et politique : « Remettre en question ce acquis ? Douter de ce droit ? C’est le comble de la pensée fasciste et autoritaire et mérite d’emblée d’être qualifié d’extrême droite. »
Pire encore : l’idée même qu’il puisse exister des arguments non religieux contre l’avortement est inconcevable. Après tout, ne nous répète-t-on pas sans cesse que les opposants à l’avortement sont d’abominables obscurantistes qui veulent imposer leurs convictions religieuses à tous ? Fournir des informations aux femmes enceintes est considéré comme une maltraitance, et prier devant une clinique d’avortement est perçu comme une menace. Pourquoi ce refus de penser rationnellement et de laisser la science – ADN, génome, échographie, etc. – parler d’elle-même, nous informer et révéler la vérité ?
Un être humain est « un organisme vivant de l'espèce Homo sapiens ». Selon cette définition, le fait qu'un fœtus ou un embryon soit un être humain est un simple fait biologique. Il suffit de consulter n'importe quel manuel d'embryologie médicale pour constater que les scientifiques s'accordent à dire que, dès la fécondation, un organisme humain vivant et indépendant, doté de son propre patrimoine génétique, se développe dans le corps de la mère. Nul besoin de se référer à la Bible pour cela, bien qu'elle nous enseigne que la dignité humaine est sacrée et que les êtres humains possèdent une âme immortelle.
Peter Singer, philosophe de renommée mondiale et défenseur du droit à l'avortement, a au moins l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que l'embryon est un être humain : « Il ne fait donc aucun doute qu'un embryon conçu à partir d'un ovule et d'un spermatozoïde humains est un être humain dès le premier instant de son existence. » Cependant, il néglige le fait que tous les êtres humains, indépendamment de leur taille, de leur sexe, de leur stade de développement ou de leur degré de dépendance, possèdent la même valeur intrinsèque. Ceci ouvre la voie à l'effondrement de l'humanisme et à l'égalité radicale du droit à la vie pour chaque individu. Y parvenir exigerait des efforts argumentatifs similaires à ceux déployés par ceux qui défendent l'avortement comme une expression des droits de la femme. Or : « Si le fœtus n'est pas un être humain, aucune justification n'est nécessaire pour légaliser l'avortement. Si, en revanche, le fœtus est un être humain, aucune justification n'est suffisante pour le légaliser. »
Mattheu Lavagna cite Kelsey Hazzard, militante athée anti-avortement : « Je suis une athée de 29 ans, ayant reçu une bonne éducation dans des institutions laïques, et je défends des opinions progressistes sur de nombreux sujets, comme le mariage homosexuel et le changement climatique. Je suis également une militante anti-avortement engagée, qui œuvre pour que l’avortement devienne impensable. L’industrie de l’avortement veut nous faire croire que les personnes comme moi n’existent pas. Elle veut nous faire croire que le mouvement anti-avortement est composé presque exclusivement d’hommes blancs âgés et de quelques pratiquants récitant leur chapelet. Cette caricature est offensante pour les jeunes comme pour les moins jeunes. […] Nous ne considérons pas l’avortement comme un enjeu de guerre culturelle ou de guerre religieuse, mais comme une question de droits humains. »
La société occidentale a totalement occulté la question de l'avortement. La tragédie des 73 millions d'avortements pratiqués chaque année dans le monde, dont 100 000 en Espagne, est devenue la norme. Nous avons atteint un point d'irrationalité extrême en matière de bioéthique, qui sert les intérêts de la biopolitique.
Dans le même hôpital, une équipe de médecins peut décider de sauver un fœtus de cinq mois et demi, tandis qu'une autre, dans la pièce voisine, tue délibérément un bébé du même âge. Ceci est parfaitement légal. De même, la loi peut punir la destruction d'un œuf d'aigle d'une amende de 15 000 € et d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans de prison, mais autorise l'interruption de grossesse d'un enfant atteint de trisomie 21.
Toutefois, une perspective catholique ne saurait se contenter de réaffirmer la protection de la vie prénatale et de lutter contre l’avortement. Elle doit prendre en compte la mère, le père, ainsi que les circonstances environnementales, sociales et économiques qui accompagnent la grossesse, la naissance et les premières années de vie.
Nombreuses sont les femmes qui désirent des enfants, mais leur souhait se heurte à divers obstacles, notamment des barrières structurelles identifiées dans le rapport FOESSA : précarité de l’emploi, difficultés d’accès au logement, prédominance des femmes dans les soins aux enfants et insuffisance du soutien public à la maternité et aux familles. S’y ajoutent des facteurs culturels liés aux modes de vie, comme la faible valeur accordée à la maternité, voire son rejet catégorique dans certaines idéologies de genre. Il convient également de tenir compte des circonstances propres à chaque grossesse.
Rien ne justifie l'interruption de la vie prénatale, mais un véritable soutien à la vie exige la prise en compte de toutes les circonstances. L'Alliance sociale pour l'espérance et la naissance, initiée par cette Conférence des évêques, défend tous les facteurs pertinents et offre un soutien indéfectible à la vie humaine naissante.
Je tiens à exprimer ma solidarité avec toutes les femmes enceintes et à les encourager à ne pas hésiter à demander de l'aide face aux difficultés d'une grossesse potentiellement non désirée. L'interruption de grossesse ne saurait être la solution à une situation si souvent difficile à supporter seule. Je réaffirme l'engagement de l'Église, ainsi que de nombreuses femmes et de nombreux hommes de bonne volonté et de bonne volonté, à apporter leur aide dans cette situation. Les autorités ne doivent pas détourner le regard et, même si elles réglementent et facilitent l'accès à l'avortement, elles ne doivent pas se soustraire à leur devoir indispensable de protéger les plus vulnérables. La prétendue solution à des problèmes qui exigent des politiques favorables à la famille et à la vie est symptomatique de l'affaiblissement moral de notre démocratie.
Photo de cet événement (c) Conférence des évêques espagnols/Capture d'écran