La question est aussi vieille que le christianisme lui-même.
Est-il raisonnable de croire qu'un homme nommé Jésus est le Fils de Dieu qui, pleinement divin et sans renoncer à sa divinité, est né d'une Vierge, est mort, est ressuscité et est monté au ciel ? Est-il raisonnable de croire que le Dieu unique, indivisible, est composé de trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit ?
Ou bien ces vérités sont-elles un affront à la raison ? Devons-nous renoncer à notre raison pour les accepter ?
Les tentatives pour répondre à cette question abondent au fil des siècles. Certaines ne reçoivent pas l'attention qu'elles méritent. J'ai donc été heureux de voir Stephen P. White revenir sur la visite du pape Benoît XVI au Royaume-Uni en septembre 2010, où, à Westminster Hall, le Saint-Père a non seulement apporté l'une des réponses les plus originales et les plus finement articulées à cette question, mais l'a même inversée.
Bien que 15 ans se soient écoulés, le souvenir de ma collaboration avec une équipe exceptionnelle de la Secrétairerie d'État pour préparer cette visite au Royaume-Uni reste vif dans ma mémoire. Nous avons eu le privilège de travailler pour un pape qui avait consacré sa vie à la recherche de la sagesse théologique et au dialogue permanent avec l'Église et le monde, en tant que professeur d'université, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et successeur de saint Pierre.
Bien que j’aie déploré que Joseph Ratzinger n’ait pas eu l’occasion de se consacrer pleinement à la recherche, aujourd’hui, plus d’une décennie après sa démission et trois ans après sa mort, j’apprécie davantage la façon dont chaque phase de sa vie extraordinaire a façonné sa pensée et l’a imprégné d’une sagesse qu’il n’aurait pas atteinte autrement.
Son discours à Westminster Hall en témoigne. Il illustre une stratégie innovante que même saint Jean-Paul II n'a pas pleinement exploitée.
Quelle était cette stratégie ?
Il s'agissait tout simplement de renverser la question. Plutôt que de se demander si la foi est raisonnable, pourquoi ne pas se demander si l'Europe et son héritage le sont sans le christianisme ? Pourquoi ne pas se demander si les institutions politiques ancrées dans la « tradition occidentale », au sens large, sont compréhensibles indépendamment des marques distinctives que leur ont laissées la Révélation et la foi chrétiennes ?
Avec Joseph Ratzinger, nous disposions d'une matière abondante issue de ses recherches intellectuelles antérieures. Elles seraient trop nombreuses pour être énumérées, mais permettez-moi de mentionner son dialogue de 2004 avec le philosophe Jürgen Habermas, dans lequel Ratzinger exprimait notamment des réserves quant à la position de Habermas selon laquelle la communication interpersonnelle suffit à elle seule à permettre à la raison d'atteindre la vérité.
Ratzinger partageait l'avis de Habermas sur l'existence d' un tel fondement, mais soutenait que la raison humaine, en raison de ses limites inhérentes (même dans la communication interpersonnelle), ne peut constituer le fondement ultime de sa propre certitude. Selon lui, c'est précisément ce qui a conduit le christianisme à se considérer comme la religion de la raison ou « logos » et à développer une théologie du Logos .
Cela peut paraître ésotérique, mais comme Benoît XVI l'a démontré à Westminster Hall, ce n'est pas le cas. Cela a de réelles conséquences sur la sphère politique.
La première est que les limites de la vérité atteignables par la communication interpersonnelle justifient un gouvernement limité. Elles légitiment également les positions d'opposition au gouvernement, comme le refus de saint Thomas More de prêter le serment de suprématie.
Pour citer White citant Benoît XVI : « Si les principes moraux qui sous-tendent le processus démocratique ne sont eux-mêmes déterminés par rien de plus solide que le consensus social, alors la fragilité du processus devient tout à fait évidente — c’est là que réside le véritable défi pour la démocratie. »
Comme je l’ai noté ailleurs, le pape Léon XIV a commencé à réaffirmer l’importance d’un gouvernement limité dans ses discours publics, et il le fait d’une manière qui rappelle Benoît XVI.
Pour étayer cet argument, Benoît XVI a dû renverser une autre idée fausse répandue. À savoir, la loi naturelle est trop souvent perçue comme un simple tremplin vers la Révélation divine. Elle est trop facilement écartée de sa source divine. Autrement dit, ce n'est pas seulement la loi naturelle qui ouvre un horizon à la Révélation, mais la Révélation elle-même qui ouvre un horizon de compréhension de la loi naturelle.
J’ai plusieurs amis intellectuels catholiques qui sont mal à l’aise avec cette dernière interprétation parce qu’ils craignent qu’elle atténue le pouvoir de persuasion de la loi naturelle dans le discours public ou qu’elle cède la place à l’intégralisme , l’idée selon laquelle le spirituel et le temporel doivent être pleinement intégrés dans les structures politiques.
Ce n'est pas du tout ce que pensait Benoît XVI. Il pensait que la dignité humaine, la liberté d'expression et les autres droits fondamentaux, bien qu'accessibles à la raison humaine indépendamment de la Révélation, ne se révèlent pleinement qu'avec l'illumination de la Révélation. L'explication que White donne du discours de Benoît XVI le montre bien :
(Benoît XVI) a ensuite soutenu que la tradition catholique soutient que « les normes objectives régissant l'action juste sont accessibles à la raison, indépendamment du contenu de la Révélation ». Par conséquent, le rôle de l'Église n'est pas de dicter ces normes à la communauté politique comme si elles ne pouvaient provenir d'aucune autre source, mais de « purifier » et d'« éclairer » la manière dont le débat raisonné doit rechercher, découvrir et appliquer les principes moraux objectifs. La religion joue un « rôle correctif » dans la quête de la raison.
Si vous écoutez attentivement Benoît XVI, vous l'entendrez développer un argument convaincant en faveur du rôle incontournable de la religion dans le discours public. Au sein de la Secrétairerie d'État, nous avons travaillé assidûment à corroborer cet argument, un argument qui prend toute sa valeur si l'on compare le discours de Westminster à celui dit de Ratisbonne (2006) et au discours des Bernardins (2008) prononcés à Paris.
Je serai honnête en disant que j’ai été déçu lorsque l’élan du débat a été sérieusement ralenti en raison de la démission de Benoît XVI, mais il avait ses raisons .
Bien qu'il ne l'ait jamais dit ouvertement, je crois que l'une des raisons était que plusieurs facteurs malheureux l'empêchaient de se faire entendre, même pendant son règne de souverain pontife. C'est pourquoi il a consacré un temps considérable à terminer sa trilogie sur la vie de Jésus, la donnant même la priorité sur ce qui devait être sa dernière encyclique, car il était beaucoup plus facile de transmettre un tel document à son successeur.
Je serai tout aussi honnête en affirmant que nous ne pouvons pas laisser ce débat s'éteindre. Malgré sa subtilité et sa sophistication, il a des conséquences désastreuses sur la vie politique. À tout le moins, il nous aide à naviguer sur un chemin difficile entre des aspirations débridées à une interprétation purement laïque de la démocratie libérale et une nostalgie irréfléchie de la chrétienté pré-moderne. Ces deux phénomènes sont aujourd'hui d'une importance inquiétante.
Autrement dit, en nous ouvrant pleinement au plan de Dieu pour nous, révélé par la Révélation divine, nous sommes moins enclins à déformer l'Évangile en le forçant à se conformer au monde profane. Nous devrions plutôt permettre au monde profane d'être éclairé par l'Évangile.
Personne n’a exprimé cela avec plus de concision que George Weigel :
Vatican II n'a pas simplement appelé l'Église à « rencontrer le monde moderne ». Le Concile a appelé l'Église à convertir le monde moderne. Comment ? En offrant Jésus-Christ comme icône d'un humanisme authentique et l'Église sacramentelle comme icône d'une authentique communauté humaine.
Il y a des raisons d’espérer que, grâce à nos prières, le pape Léon XIV poursuivra l’appel conciliaire à convertir le monde plutôt qu’à simplement le rencontrer.
Daniel B. Gallagher est maître de conférences en philosophie et en littérature au Ralston College. Il a travaillé pendant dix ans à la Secrétairerie d'État du Vatican sous les papes Benoît XVI et François.
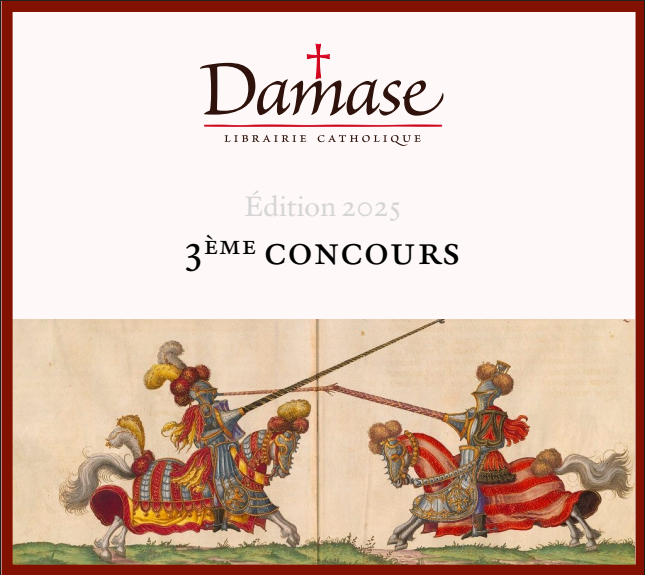
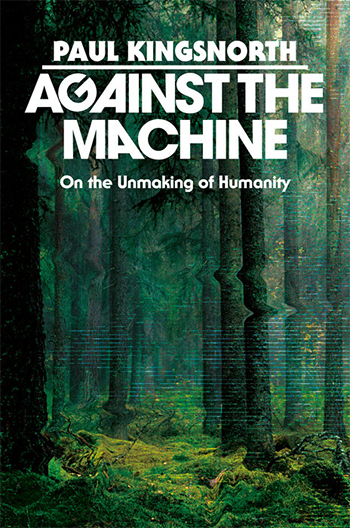
.jpg)

