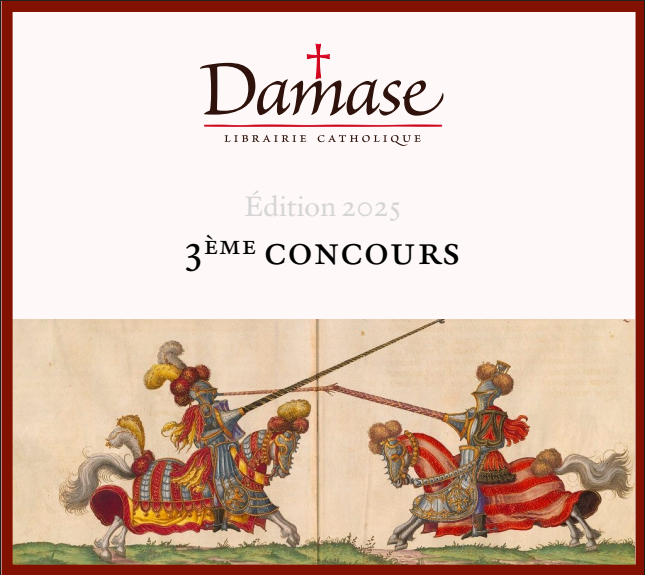Cardinal Gerhard Ludwig Müller, vous êtes préfet émérite de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Quel bilan tirez-vous de ces premiers mois de pontificat du pape Léon XIV ?
Nous étions tous heureux que le pape Léon XIV ait débuté son pontificat avec le Christ, centre de la foi chrétienne : ce christocentrisme est nécessaire. Nombreux sont ceux qui souhaitent que l’Église ne parle que de questions de vie sociale et politique. Bien sûr, ce sont aussi des questions de mission, mais sa mission première est de prêcher l’Évangile du salut et de la vie éternelle pour tous les hommes.
Selon vous, y aura-t-il plus d’attention à la collégialité avec ce pontificat ?
Oui, nous en avons discuté lors du pré-conclave. La collégialité des évêques est un élément de la foi chrétienne, du dogme. Le pape, en tant qu'évêque de Rome, n'est pas isolé comme un autocrate, mais dispose d'un collège de cardinaux qui constitue son sénat. Les conseils des cardinaux sont très importants, non pas pour leurs propres intérêts, mais pour soutenir le pape et sa mission intellectuellement et moralement.
Certains pensent qu’avec Léon XIV, il y aura un retour à la tradition.
Il ne faut pas faire de comparaisons avec les papes précédents. Léon XIV ne peut imiter François, tout comme François n'a pas pu imiter Benoît XVI, etc. Par exemple, on parle de Léon XIV portant la mozzetta : ce n'est pas seulement une façon de paraître mieux, mais une expression de sa fonction. En ce sens, je pense que beaucoup ont imaginé que le pape Léon XIV souhaitait se présenter davantage comme le successeur de Pierre, au lieu de privilégier sa personnalité. Bien sûr, on ne peut pas dissocier la fonction de la personne, mais, d'une certaine manière, il faut faire une distinction.
Le pape Léon XIV a déclaré avoir déjà reçu plusieurs lettres au sujet de la messe latine. Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'intervenir sur cette question ?
Partons du constat qu'il existe différents rites, dont le rite latin, le plus répandu. Les Pères conciliaires ont décidé de ne pas modifier la messe, mais simplement de modifier légèrement les rites afin de faciliter la participation active des fidèles. Certains, cependant, ont émis des réserves quant à la forme liturgique ; ils sont restés fidèles au rite latin tel qu'il existait jusqu'en 1962. Certains de ces soi-disant traditionalistes affirment que seule cette forme est valable. Nous ne pouvons l'accepter ; une solution plus pragmatique et plus tolérante doit être trouvée. Nous devons trouver une solution fondée sur la pensée catholique, qui distingue la substance des sacrements des rites partiellement modifiables.
Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Le problème ne peut être résolu par l'autoritarisme. Une médiation est nécessaire : les deux parties doivent se rapprocher. Une réflexion approfondie est nécessaire, théologique et pas seulement politique.
Parmi les nombreuses lettres, le pape Léon XIV a également reçu une pétition signée par de nombreux universitaires lui demandant des éclaircissements après la « confusion » générée par le Jubilé de la communauté LGBTQ+. Qu'en pensez-vous ?
J'ignore si le Pape dira quelque chose, mais la situation est très claire : l'Année Sainte et la Porte Sainte ne peuvent être instrumentalisées pour une telle idéologie. L'Église, au nom de Jésus-Christ, accueille tous les hommes et leurs problèmes, mais Dieu a créé l'homme et la femme, et seul ce mariage est la seule possibilité de vivre ensemble. La Porte Sainte ne peut être instrumentalisée à des fins politiques : je pense, par exemple, à ceux qui viennent en pèlerinage pour s'interroger sur le conflit entre Palestiniens et Israéliens. Mais quel est le rapport avec leur foi ? Le Christ est la Porte Sainte par laquelle nous entrons dans l'Église, la famille de Dieu. Nous, chrétiens, ne devons pas vaincre nos ennemis, mais l'inimitié elle-même.
Concernant la sexualité, le pape a déclaré que la doctrine ne changerait pas, mais qu'il confirmait le « Todos, todos, todos » de François. Pensez-vous qu'il ait trouvé un compromis ?
Tous les hommes sont appelés à trouver Jésus-Christ, l'unique Sauveur du monde, mais par un changement de vie. Le problème est que beaucoup veulent comprendre ce « tous, tous, tous » comme l'acceptation d'un mode de vie contraire au mode de vie chrétien. Pensons à la tradition, à l'Église de Rome au IIe ou IIIe siècle. Les membres de l'Église se demandaient : que faire des gladiateurs qui, malgré leurs meurtres, veulent être baptisés ? Pour entrer dans l'Église par le baptême, ils doivent changer de vie. Et il en va de même pour de nombreuses autres catégories de personnes…
Le Pape a parlé des pro-vie américains, affirmant qu'ils ne peuvent pas être contre l'avortement, mais en même temps en faveur de la peine de mort ou des politiques d'immigration actuellement en place aux États-Unis...
Le Pape n'a pas comparé ni relativisé ces situations objectivement différentes, mais a seulement évoqué la cohérence subjective requise dans tous les cas de protection de la vie. Avorter revient à tuer une personne innocente, et l'Église a toujours affirmé qu'il s'agissait d'un crime brutal. Mais on ne peut pas le mettre sur le même plan que la peine de mort pour un criminel qui a tué d'autres personnes. L'Ancien Testament lui-même parle de la peine de mort pour quiconque tue un autre être humain. Je suis personnellement opposé à cette peine, mais rappelons-nous que les enseignements de l'Église admettaient, dans certaines limites et dans des cas extrêmes, que les autorités civiles puissent l'appliquer. La question des migrants est une autre affaire : nous devons toujours traiter nos voisins comme des frères et sœurs, mais les États ont parfaitement le droit de réguler l'immigration clandestine et de protéger leurs propres populations, peut-être contre les criminels arrivant d'autres pays.
Selon vous, ce pontificat nous apportera-t-il des surprises ou sera-t-il un pontificat sans trop de bouleversements ?
Je m'attends à des surprises liées à la Parole de Dieu, et non à du sensationnalisme, comme dire : « Voici le premier pape à se rendre à Moscou », ou quelque chose du genre. Le pape n'est pas une figure de proue de l'intérêt général ; il ne se présente pas selon les codes d'une star hollywoodienne, mais comme un bon berger, qui donne sa vie pour les brebis du Christ.
Nous sommes tous convaincus que notre Pape a cet équilibre en ne se présentant pas comme une personnalité reconnue, comme la plus célèbre du monde. Tout cela n'a aucune valeur devant Dieu. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de nous, et non ce que les hommes pensent de nous. Comme le disait le Pape Léon XIV lui-même : « Faites-vous petit pour faire place au Christ. »