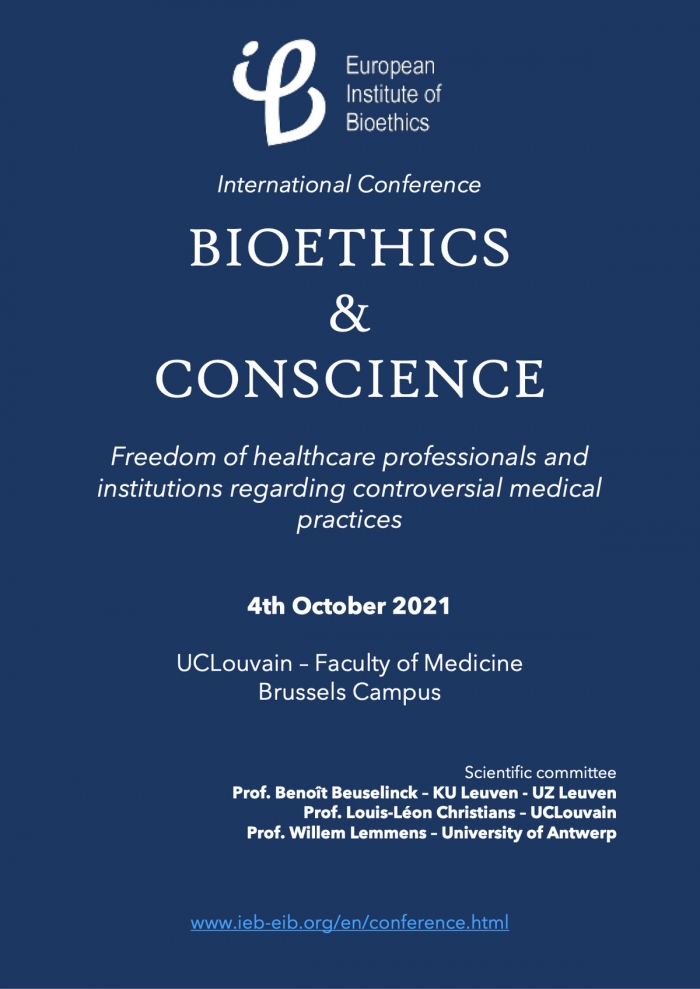Soumis depuis des mois à une jauge de 15 puis 200 personnes fin juin dans les églises et un espacement de 1,5 m entre chaque fidèle, les catholiques belges seront délivrés de ces restrictions sanitaires anti-covid19 à partir du 1er septembre. Pour les messes à Bruxelles, les règles ne sont pas assouplies. Un commentaire de l’hebdomadaire français « Famille chrétienne » signé Camille Lecuit :
Soumis depuis des mois à une jauge de 15 puis 200 personnes fin juin dans les églises et un espacement de 1,5 m entre chaque fidèle, les catholiques belges seront délivrés de ces restrictions sanitaires anti-covid19 à partir du 1er septembre. Pour les messes à Bruxelles, les règles ne sont pas assouplies. Un commentaire de l’hebdomadaire français « Famille chrétienne » signé Camille Lecuit :
« Enfin ! S’exclament sans doute en ce moment les catholiques belges. Alors qu’ils espéraient depuis des mois l’assouplissement des règles en vigueur pour les messes, celui-ci vient d’être autorisé par un arrêté ministériel du 26 août 2021. Dès mercredi 1er septembre, seule l’obligation du port du masque sera requise et « toutes les autres mesures seront supprimées : distanciation sociale, nombre maximal de participants, sens de circulation, organisation des chaises, gel hydro-alcoolique… », détaille le Vicariat général de Liège dans un communiqué du 31 août. Idem pour les activités pastorales.
Une liberté durement obtenue
Jusqu’alors, en plus des gestes barrières classiques en vigueur dans de nombreux pays, les fidèles belges étaient soumis à une jauge de 15 personnes dans les églises depuis la Toussaint et jusqu’au 27 juin, puis de 200 personnes (400 à l’extérieur). Ils devaient aussi respecter une distance de 1,5 mètres entre eux.
Un régime jugé très sévère et que certains ont dénoncé avec ténacité ce derniers mois, peinant beaucoup à faire évoluer la situation. Des tensions sont même apparues entre les évêques et plusieurs fidèles leur reprochant leur manque d’engagement. « Certains nous reprochent de ne pas nous faire assez entendre du gouvernement, mais on fait ce qu’on peut ! La pratique religieuse et l’impact de l’Eglise ne font guère le poids : nous devons bien constater une disparition du religieux hors du champ de vision des pouvoirs publics », déclarait à Famille Chrétienne Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, en mai dernier.
Bruxelles toujours en proie aux restrictions
À Bruxelles, toutes les restrictions demeurent, en raison de la situation sanitaire jugée encore trop critique. Dans tout le pays, « la prudence reste de mise, car le virus circule encore et toujours », insistent les évêques belges. Ils tiennent à « remercier encore une fois les personnes engagées dans la lutte contre le virus », invitent « au respect des mesures de sécurité proposées par le Gouvernement et à se faire vacciner. »
Le vicariat général de Liège donne quelques instructions supplémentaires : « Il est conseillé de conserver l’utilisation des pales et la désinfection des mains par le célébrant avant de donner la communion et le port du masque par ceux qui distribuent la communion. Il semble sage d’éviter pour le moment la communion au calice et de continuer à préférer la communion dans la main. »
Ref. Fin des restrictions pour les messes en Belgique
Même le rite prescrit de la communion "dans la main" se fait moins catégorique : il est conseillé "pour le moment", pas obligé…
JPSC
 Le gouvernement de la République démocratique du Congo a dévoilé jeudi un « Plan directeur d’industrialisation » à l’horizon 2040, d’un coût de 58 milliards de dollars, qui prévoit des infrastructures devant relier différentes régions de ce géant d’Afrique centrale, a-t-on appris de source officielle. Le plan, présenté officiellement aux membres du gouvernement, aux élus, diplomates, opérateurs économiques congolais et étrangers ainsi qu’aux universitaires et la presse, vise à atteindre « l’objectif de l’émergence de la RDC d’ici 2030-2040 », a déclaré Julien Paluku, ministre congolais de l’Industrie.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a dévoilé jeudi un « Plan directeur d’industrialisation » à l’horizon 2040, d’un coût de 58 milliards de dollars, qui prévoit des infrastructures devant relier différentes régions de ce géant d’Afrique centrale, a-t-on appris de source officielle. Le plan, présenté officiellement aux membres du gouvernement, aux élus, diplomates, opérateurs économiques congolais et étrangers ainsi qu’aux universitaires et la presse, vise à atteindre « l’objectif de l’émergence de la RDC d’ici 2030-2040 », a déclaré Julien Paluku, ministre congolais de l’Industrie.
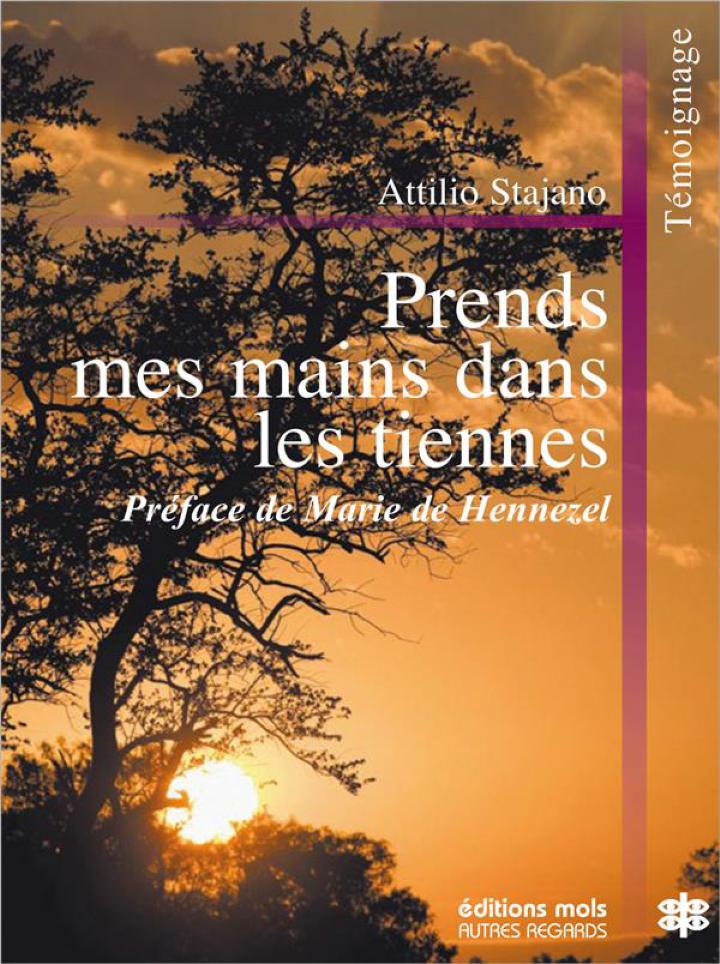



 Sursum Corda asbl
Sursum Corda asbl