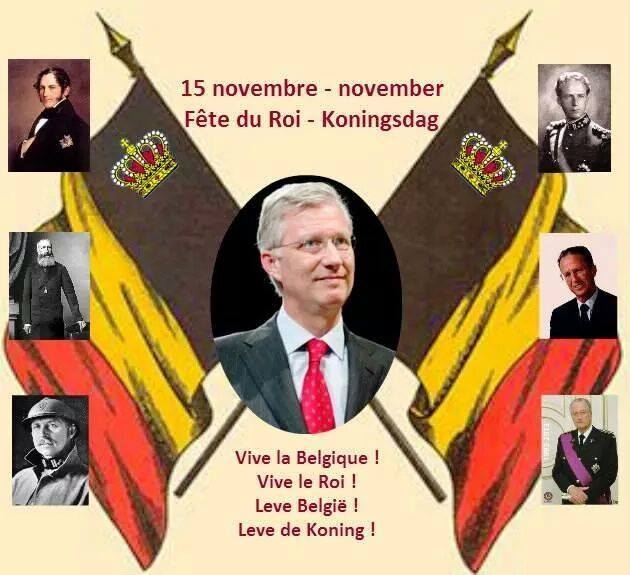De L. Vanbellingen sur le site de l'Institut Européen de Bioéthique :
Enquête pour euthanasies illégales en Belgique
24/11/2020
Le parquet de Louvain mène actuellement une information judiciaire au sujet d'une dizaine d'euthanasies suspectées d'avoir été réalisées de manière illégale.
Bien que l'enquête soit ouverte depuis maintenant plus d'un an, une lettre anonyme récemment transmise au quotidien flamand De Standaard vient seulement de dévoiler l'existence de celle-ci. Ce courrier est rédigé par les membres de la famille d'une personne dont l'euthanasie, réalisée il y a deux ans, est considérée comme suspecte aux yeux de la justice. La famille n'était pas au courant de tels soupçons jusqu'à ce qu'elle soit interrogée dans le cadre de l'enquête. Les personnes visées sont deux médecins généralistes ayant effectué ces euthanasies dans le cadre de leur pratique en cabinet privé.
Le parquet de Louvain préfère ne pas communiquer à ce stade, et réserve ses déclarations pour l'issue de l'enquête. Selon la famille, le dossier concerne plus d'une dizaine d'euthanasies, considérées comme de possibles infractions criminelles par la justice.
La loi belge prévoit en effet un régime de dépénalisation de l'euthanasie : dans l'hypothèse où le médecin qui met fin à la vie de son patient ne respecte pas les conditions légales, celui-ci peut être poursuivi pour meurtre par empoisonnement (art. 397 du Code pénal).
Rappelons que l'empoisonnement était précisément la qualification pénale retenue par le juge d'instruction au sujet des trois médecins ayant participé à l'euthanasie de Tine Nys, et jugés aux assises de Gand en janvier dernier. La Cour avait finalement acquitté les trois accusés (voy. bulletin IEB). Le médecin ayant effectué l'euthanasie, acquitté au bénéfice du doute, est maintenant poursuivi devant le tribunal civil.
Eu égard à l'enquête en cours, Wim Distelmans, président de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, précise au Standaard ne pas être en mesure de commenter les cas suspects. Celui-ci insiste sur le fait que certains médecins pratiquent – parfois ouvertement – des euthanasies sans les déclarer à la commission de contrôle, ce qui constitue pourtant une obligation légale. Par ailleurs, même à supposer que les euthanasies en question aient été déclarées à la commission, W. Distelmans rappelle que les formulaires restent a priori anonymes, et que les informations fournies par les médecins sont toujours réputées exactes par la commission.
Cette affaire soulève une nouvelle fois l'enjeu de l'effectivité du contrôle opéré par la Commission quant à la légalité des euthanasies déclarées. Ici comme dans le cas de Tine Nys, la justice se saisit d'euthanasies suspectes au sujet desquelles la Commission n'a pas émis le moindre questionnement – dans l'hypothèse où les euthanasies en question lui ont été soumises.

 « Alors que certaines mesures sanitaires s’installent dans le temps long, les demandes persistantes en faveur de la liberté du culte montrent que c’est l’ensemble des libertés publiques qui est en jeu.
« Alors que certaines mesures sanitaires s’installent dans le temps long, les demandes persistantes en faveur de la liberté du culte montrent que c’est l’ensemble des libertés publiques qui est en jeu. Par ailleurs, l’église du Saint-Sacrement a choisi d’ouvrir ses portes pour la prière individuelle devant le Saint-Sacrement exposé, avec disponibilité d’un prêtre: tous les mardis de 17h à 19h, tous les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h, tous les vendredis de 12h à 14h, tous les samedis de 15h à 18h et tous les dimanches de 15h à 18h. Venite, adoremus.
Par ailleurs, l’église du Saint-Sacrement a choisi d’ouvrir ses portes pour la prière individuelle devant le Saint-Sacrement exposé, avec disponibilité d’un prêtre: tous les mardis de 17h à 19h, tous les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h, tous les vendredis de 12h à 14h, tous les samedis de 15h à 18h et tous les dimanches de 15h à 18h. Venite, adoremus.


 Par ailleurs, l’église du Saint-Sacrement a choisi d’ouvrir ses portes pour la prière individuelle devant le Saint-Sacrement exposé, avec disponibilité d’un prêtre: tous les mardis de 17h à 19h, tous les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h, tous les vendredis de 12h à 14h, tous les samedis de 15h à 18h et tous les dimanches de 15h à 18h. Venite, adoremus.
Par ailleurs, l’église du Saint-Sacrement a choisi d’ouvrir ses portes pour la prière individuelle devant le Saint-Sacrement exposé, avec disponibilité d’un prêtre: tous les mardis de 17h à 19h, tous les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h, tous les vendredis de 12h à 14h, tous les samedis de 15h à 18h et tous les dimanches de 15h à 18h. Venite, adoremus.