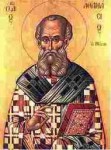De Jonathan Liedl sur le NCR :
Influences extérieures : comment l'Allemagne et la Chine tentent d'influencer le conclave
ANALYSE : Les dernières initiatives de la Voie synodale et du Parti communiste chinois visent clairement à influencer ce qui se passe à l’intérieur de la chapelle Sixtine, mais pourraient-elles se retourner contre eux ?
Tiré d'un mot italien signifiant « salle close », un conclave est littéralement isolé du monde extérieur. Mais cela ne signifie pas que les événements qui se déroulent au-delà de la chapelle Sixtine ne préoccupent pas les cardinaux électeurs alors qu'ils entament leur période de séquestration.
Deux questions seront probablement à l'esprit des 133 électeurs pontificaux lorsque le conclave commencera le 7 mai : la bénédiction des couples homosexuels allemands et l'accord Vatican-Chine.
Ce n'est pas un hasard. C'est plutôt le résultat de deux événements récents survenus hors de Rome, qui devraient sans aucun doute influencer les discussions en cours au Vatican, ainsi que les votes qui auront lieu dans moins d'une semaine.
Tout d'abord, le 23 avril, deux jours seulement après le décès du pape François, la Conférence épiscopale allemande a publié un guide pour les « cérémonies de bénédiction » des couples en « situation irrégulière », y compris les unions homosexuelles. Obtenir des bénédictions officielles pour les couples homosexuels est depuis longtemps un objectif de la campagne allemande très critiquée « Voie synodale », et cette dernière initiative va à l'encontre de la Fiducia Supplicans , les directives du Vatican de 2023 sur le sujet, qui n'autorisent que les bénédictions « spontanées » des personnes vivant une relation homosexuelle, et non la « légitimation du statut [du couple] ».
Puis, malgré l'absence de pape pour ratifier les nominations épiscopales, les autorités chinoises ont « élu » deux nouveaux évêques le 28 avril, dont un dans un diocèse déjà dirigé par un évêque reconnu par le Vatican. Cette décision est la dernière d'une série de résultats douteux depuis la signature par le Vatican, en 2018, d'un accord visant à engager un processus conjoint avec le gouvernement chinois sur les nominations épiscopales. Cet accord, dont le Vatican a reconnu les violations répétées, a néanmoins été renouvelé en 2024.
À ce stade du processus de sélection du prochain pape, il est difficile d’imaginer que l’un ou l’autre de ces événements se soit produit sans que les responsables aient eu l’intention d’influencer le conclave.
L' interrègne – qui signifie « entre les règnes » en latin – est une période où une grande partie de la vie institutionnelle de l'Église est paralysée. Les chefs des dicastères du Vatican cessent leurs fonctions, les processus de canonisation sont suspendus et la nomination de nouveaux diplomates pontificaux est temporairement interrompue. Tout mouvement durant cette période n'est pas accidentel : il revêt une importance accrue et est destiné à avoir un impact.
En fait, la période entre la mort du pape et le début de la séquestration est souvent marquée par des efforts intenses pour influencer les électeurs pontificaux — que ce soit par des campagnes médiatiques ou des provocations comme celles venant d’Allemagne et de Chine.
Et ce n’est pas sans raison : il existe de bonnes preuves que les événements qui se déroulent dans les jours précédant un conclave peuvent influencer qui en sortira vêtu de blanc.
Par exemple, en 2013, il était largement admis que les perspectives papales du cardinal Angelo Scola avaient été compromises après que la police italienne eut perquisitionné les bureaux de son archidiocèse dans le cadre d'une enquête pour corruption impliquant l'un des anciens associés du cardinal milanais - quelques heures seulement avant le début du conclave le 12 mars. Et en 1914, le conclave papal a commencé trois jours seulement après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ce qui a peut-être influencé les cardinaux à choisir le diplomate expérimenté, le cardinal Giacomo della Chiesa, qui est devenu le pape Benoît XV.
En fait, la possibilité que les cardinaux électeurs soient trop influencés par les événements et les campagnes de pression précédant le conclave a conduit certains à suggérer qu’ils devraient être séquestrés immédiatement après la mort d’un pape.
En Allemagne, le message adressé aux cardinaux électeurs semble clair : la voie synodale ne ralentit pas, et ils feraient bien d'élire un pontife prêt à « rencontrer les Allemands là où ils se trouvent » — ce qui dépasse de plus en plus le cadre de l'orthodoxie catholique.
Concernant la Chine, cette démarche pourrait viser à consolider son emprise sur l'accord avec le Vatican, rendant tout revirement trop risqué pour les catholiques chinois. Parallèlement, un analyste considère la tentative de la Chine de susciter le mécontentement des cardinaux à propos de l'accord comme une manœuvre stratégique visant à saper les perspectives papales de l'homme le plus associé à cet accord, le secrétaire d'État du pape François, le cardinal Pietro Parolin, afin de promouvoir le cardinal philippin Luis Antonio Tagle.
Si cela est vrai, la Chine n'est pas la seule à tenter de saper la réputation du cardinal Parolin juste avant le conclave. Le prélat italien a fait l'objet de plusieurs critiques négatives dans les médias cette semaine, notamment de la part de deux médias catholiques progressistes américains.
Quant aux actions menées par l’Allemagne et la Chine, elles peuvent toutes deux être considérées comme des tentatives de coincer les cardinaux électeurs et l’homme qu’ils choisiront comme prochain pontife.
Bien sûr, ils pourraient avoir l'effet inverse. Ce genre de rodomontade ecclésiastique pourrait inciter les cardinaux électeurs à privilégier un pape plus disposé que François à affronter l'intransigeance allemande et les intimidations chinoises.
François valorisait le dialogue avec les militants de la Voie synodale et les apparatchiks du Parti communiste chinois, convaincu que des avancées ne peuvent se produire que si l'on poursuit le dialogue. Mais à la suite de ces derniers développements, les cardinaux peuvent désormais plus facilement affirmer que cette approche n'a pas porté les fruits escomptés. Une nouvelle ligne de conduite, peut-être moins encline à accepter les ruptures d'accords ou le franchissement de lignes rouges, pourrait être privilégiée par les électeurs, ce qui, ironiquement, conduirait à l'exact opposé de ce que les dirigeants de l'Église allemande et les responsables chinois auraient pu espérer.
Bien sûr, c’est peut-être une telle confrontation que la Chine – si ce n’est les évêques allemands – recherche en fin de compte.
Mais si les motivations et leur impact réel restent flous, les remaniements du siège vacant en Allemagne et en Chine sont sans aucun doute destinés à influencer le conclave. Et à mesure que les 133 électeurs s'éloignent de plus en plus, il faut s'attendre à ce que les efforts visant à influencer les points de vue qu'ils apportent avec eux à la Chapelle Sixtine s'intensifient.