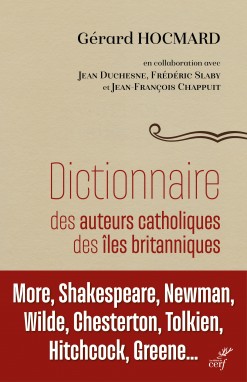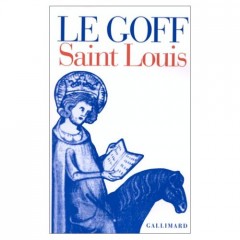De Gérard Leclerc sur le site de France Catholique :
Quel avenir pour le catholicisme ?
9 septembre 2021

- © P Deliss / GODONG
L’historien Guillaume Cuchet, qui s’est fait connaître pour un essai très éclairant sur la chute de la pratique religieuse en France dans la période qui coïncide avec le déroulement et les suites de Vatican II [1], vient de récidiver avec un autre livre qui interpelle forcément les chrétiens : Le catholicisme a-t-il encore de l’avenir en France ? (Le Seuil). Les données du problème paraissent plutôt simples. Il y aurait, aujourd’hui, 2 % des Français qui iraient à la messe chaque dimanche, alors qu’ils étaient 25 % dans les années 1950. Cette chute vertigineuse est significative d’un phénomène de portée historique, quelles que soient les interprétations qu’on lui donne. Certains critiques des idées ont pu parler de la disparition des grands systèmes de sens, caractéristiques de cette époque. Ainsi, le marxisme, qui fut pour plusieurs générations l’idéologie qui rendait compte du dynamisme inhérent à la marche de l’histoire, s’est-il effondré, rendant anachronique et injustifiable le mot de Sartre quant à son caractère « indépassable ». Mais il en serait de même de toutes les pensées se réclamant, tel l’hégélianisme, d’une philosophie totale de l’histoire.
Nouvelle forme du progressisme
Finis donc les lendemains qui chantent et les grands soirs qui ont fait rêver des générations de militants ! L’heure est à la déconstruction, et d’une façon générale au déni des héritages, tous suspects d’avoir provoqué discriminations et effets de puissance. On pourrait donc en déduire que le christianisme ne saurait échapper à cette logique du déclin et de la déconsidération, d’autant qu’à la chute des statistiques s’ajoute la révélation de nombre de scandales qui entachent jusqu’à la dignité du sacerdoce. Cela conduit certains à réinventer une autre forme de progressisme, assez différent de celui qui avait cours après-guerre et dans la période post-conciliaire. L’allure que prend en ce moment le synode de l’Église d’Allemagne laisse craindre une menace de schisme dont on peut se demander s’il aurait l’aval de Martin Luther.
Mais nos réformateurs ne sauraient nous tromper sur la nature de leur projet. Là où l’abandon de la discipline et des exigences doctrinales a été mené à terme, ce n’est pas l’afflux de nouveaux fidèles qui s’est manifesté mais une désertion généralisée. Ce qui veut se substituer à l’Église institution risque d’aboutir à des petits cercles, promis rapidement à des ruptures internes. Ce qui oblige à reposer la question en d’autres termes.
Ce n’est pas la première fois que l’Église se trouve face à un pareil défi. Il y a eu plusieurs rechristianisations de la France. Mais le regain est venu, comme aux XVIe et XVIIe siècles d’une réforme spirituelle radicale de l’Église dans sa tête et dans ses membres, ainsi que d’un renouveau mystique faisant briller de tous ses feux l’espérance du Salut qui ne proviendra que par la redécouverte intégrale de l’Apocalypse, c’est-à-dire de la Révélation trinitaire.
[1] Comment notre monde a cessé d’être chrétien, Points, 2020, 320 p., 8,80 €.
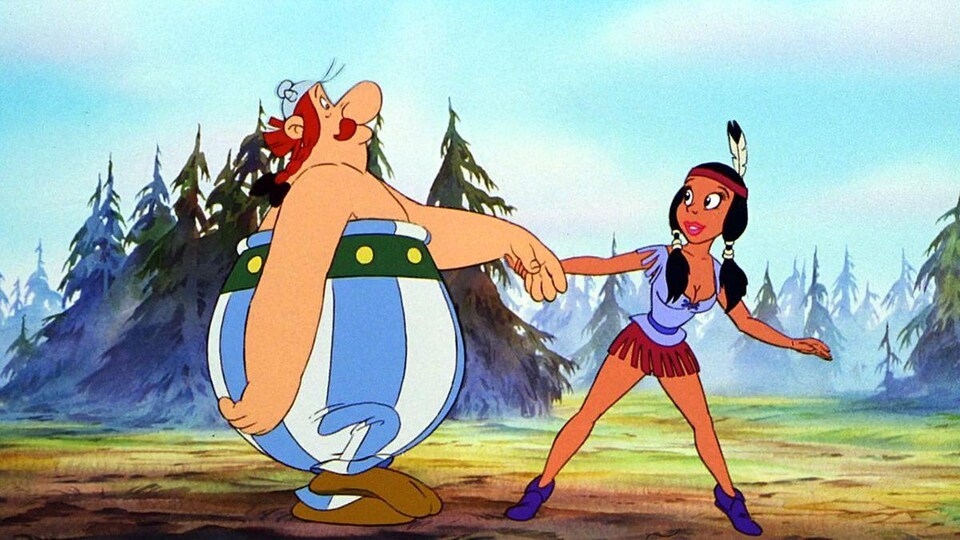

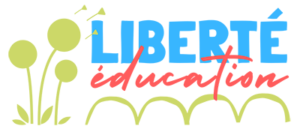
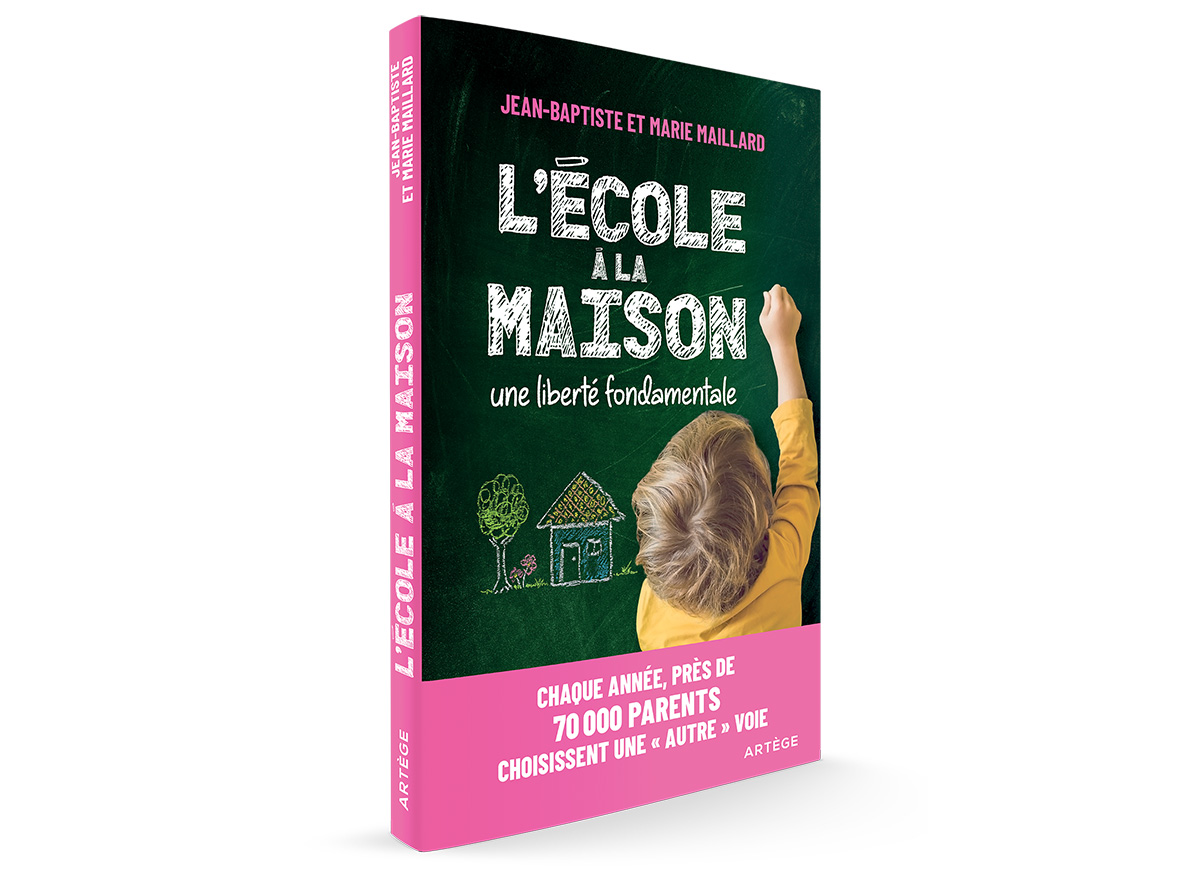
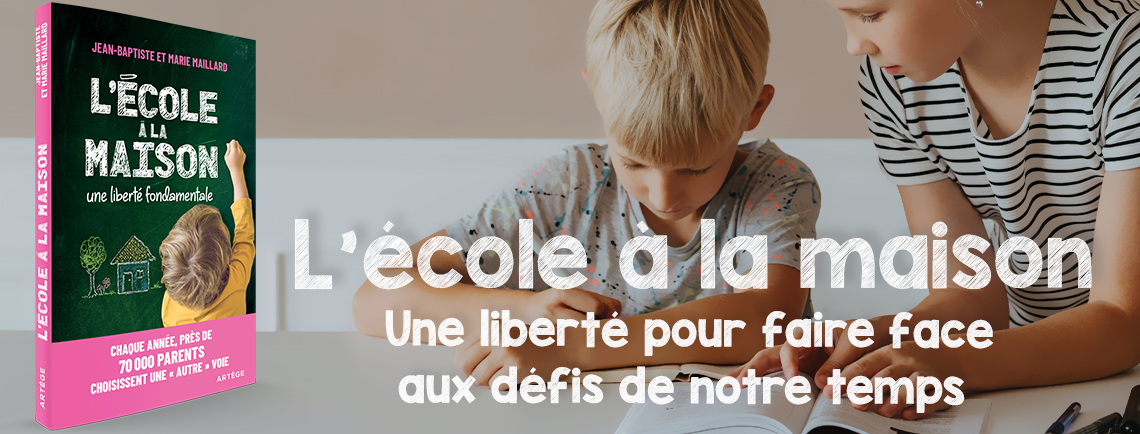
 Les auteurs :
Les auteurs :