 De Thibaud Collin, aujourd’hui sur le site web du bimensuel « L’Homme Nouveau » :
De Thibaud Collin, aujourd’hui sur le site web du bimensuel « L’Homme Nouveau » :
"Vingt-six théologiens viennent de publier leur contribution au Synode sur la famille, accompagnée d’une préface de Mgr Brunin, président du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France. Un livre qui met de côté le Catéchisme de l’Église catholique et l’enseignement de Jean-Paul II. Lecture d’un philosophe pour dénoncer un danger:
La Conférence des évêques de France, sous la responsabilité de Mgr Brunin, président du Conseil Famille et Société et lui-même Père synodal, a souhaité participer au débat synodal actuel en publiant un ouvrage collectif dans lequel 26 théologiens francophones répondent aux questions posées dans la Relatio Synodi. Ce volume, par nature composite, se signale cependant par sa très grande homogénéité : presque toutes les contributions sont en effet des critiques de l’enseignement de l’Église sur le mariage et la sexualité ! À croire qu’il y a eu un grand vide magistériel sur ces sujets entre la fin des années 1960 et aujourd’hui. Omissions, contresens, voire sophismes sont légion dans ces quelque 300 pages. Ainsi la bibliste Anne-Marie Pelletier, professeur aux Bernardins, ignorant l’enseignement de saint Jean-Paul II sur le passage d’Éphésiens 5 sur le rapport du Christ à l’Église et soulignant l’urgence d’affronter des questions sur « la soumission de la femme à son mari » (p. 59) que le pape polonais a traité avec minutie et profondeur voilà plus de trente ans !
Une nouvelle morale
On constate également le contresens récurrent consistant à accuser les encycliques Humanæ vitæ (1968) et Veritatis splendor (1993) d’être légalistes et naturalistes (p. 182, 186, 208) pour mieux les opposer au concile Vatican II censé être personnaliste et légitimer ainsi une morale du sujet attentive aux situations particulières et ouverte à la miséricorde. Comme si Paul VI et Jean-Paul II avaient moins bien compris le Concile que le Père jésuite Alain Thomasset, professeur au Centre Sèvres… On remarque encore l’omniprésence de certains mots sur lesquels cette nouvelle (mais en réalité très datée) morale s’articulerait. Un des plus significatifs est celui de « stabilité », en passe semble-t-il de devenir la clef de voûte de cette morale sexuelle, moyen de s’habituer à considérer comme légitime les couples de même sexe et les divorcés remariés.

 VERBATIM | La paroisse Saint-Symphorien de Versailles recevait ce dimanche 27 septembre le cardinal Raymond Leo Burke, à l’occasion de la sortie de son livre d’entretien (Artège) avec Guillaume d’Alançon. Le cardinal est un homme simple, ne rechignant pas à prolonger sa présence auprès de simples paroissiens, malgré son emploi du temps. « Mon espérance est que l’Église soit de plus en plus fidèle à son identité d’Épouse du Christ. J’espère communiquer cette espérance à travers mon livre. »
VERBATIM | La paroisse Saint-Symphorien de Versailles recevait ce dimanche 27 septembre le cardinal Raymond Leo Burke, à l’occasion de la sortie de son livre d’entretien (Artège) avec Guillaume d’Alançon. Le cardinal est un homme simple, ne rechignant pas à prolonger sa présence auprès de simples paroissiens, malgré son emploi du temps. « Mon espérance est que l’Église soit de plus en plus fidèle à son identité d’Épouse du Christ. J’espère communiquer cette espérance à travers mon livre. » À Cuba, la Vierge du Cuivre, sa sainte patronne, est un peu comme Notre-Dame de la Garde à Marseille. Un symbole national ! C’est dans son sanctuaire que pour la première fois les esclaves de l’île, emmenés par leur aumônier, conquirent leur liberté.
À Cuba, la Vierge du Cuivre, sa sainte patronne, est un peu comme Notre-Dame de la Garde à Marseille. Un symbole national ! C’est dans son sanctuaire que pour la première fois les esclaves de l’île, emmenés par leur aumônier, conquirent leur liberté.

 « On a dit que chaque Concile engendre un profil spécifique de sainteté. C’est ainsi que le Concile de Trente, en redéfinissant le sacerdoce catholique, a engendré une lignée de saints prêtres et évêques. Je pense en particulier à ces saints pasteurs qui ont éclairé le grand XVIIe siècle français et qui ont fondé l’École Française de spiritualité : saint François de Sales, Monsieur Vincent, saint Jean Eudes, saint Louis-Marie Grignon de Monfort... Ils ont en commun d’avoir été attentifs aux grandes pauvretés de leur temps, à la fois matérielles et spirituelles, parfois en fondant des oeuvres de charité gigantesques – les filles de la charité de saint Vincent de Paul, pour endiguer le paupérisme de son siècle, la congrégation de Notre-Dame de charité de saint Jean Eudes pour recueillir les prostituées repenties – et des sociétés de prêtres pour la formation du clergé, qui laissait tant à désirer, et pour l’évangélisation des campagnes, par la mise en oeuvre de missions populaires – comme la congrégation de la mission, plus connue sous le nom de lazaristes, ou la congrégation de Jésus et de Marie, appelée plus communément les eudistes. Qui ne verrait d’ailleurs l’actualité pour aujourd’hui de ces grandes intuitions du XVIIe s., en particulier pour ce qui est de la formation du clergé et des missions populaires, pour nous aider à relever le défi de la nouvelle évangélisation propre à notre époque ?
« On a dit que chaque Concile engendre un profil spécifique de sainteté. C’est ainsi que le Concile de Trente, en redéfinissant le sacerdoce catholique, a engendré une lignée de saints prêtres et évêques. Je pense en particulier à ces saints pasteurs qui ont éclairé le grand XVIIe siècle français et qui ont fondé l’École Française de spiritualité : saint François de Sales, Monsieur Vincent, saint Jean Eudes, saint Louis-Marie Grignon de Monfort... Ils ont en commun d’avoir été attentifs aux grandes pauvretés de leur temps, à la fois matérielles et spirituelles, parfois en fondant des oeuvres de charité gigantesques – les filles de la charité de saint Vincent de Paul, pour endiguer le paupérisme de son siècle, la congrégation de Notre-Dame de charité de saint Jean Eudes pour recueillir les prostituées repenties – et des sociétés de prêtres pour la formation du clergé, qui laissait tant à désirer, et pour l’évangélisation des campagnes, par la mise en oeuvre de missions populaires – comme la congrégation de la mission, plus connue sous le nom de lazaristes, ou la congrégation de Jésus et de Marie, appelée plus communément les eudistes. Qui ne verrait d’ailleurs l’actualité pour aujourd’hui de ces grandes intuitions du XVIIe s., en particulier pour ce qui est de la formation du clergé et des missions populaires, pour nous aider à relever le défi de la nouvelle évangélisation propre à notre époque ? Le 8 décembre prochain débutera pour l’Église l’année de la Miséricorde. Sans attendre cette date, il m’a paru important de souligner l’importance de celle-ci pour la vie des croyants. De plus, ayant besoin d’un angle d’approche très précis pour ce court article, j’ai choisi d’aborder le sujet de la miséricorde dans son rapport avec la justice.
Le 8 décembre prochain débutera pour l’Église l’année de la Miséricorde. Sans attendre cette date, il m’a paru important de souligner l’importance de celle-ci pour la vie des croyants. De plus, ayant besoin d’un angle d’approche très précis pour ce court article, j’ai choisi d’aborder le sujet de la miséricorde dans son rapport avec la justice.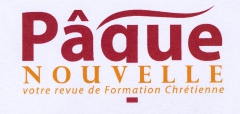
 Il est dans la campagne attique, sur la route qui mène d’Athènes à Eleusis, un patelin oublié aujourd’hui de tous, qui a nom Corydalle. Il importerait peu d’en ressusciter ici le souvenir, si l’endroit n’avait été le théâtre autrefois d’une affaire atroce ; mythologique sans doute, mais donc intemporelle, et, hélas ! ― par le fait même ― toujours bien d’actualité...
Il est dans la campagne attique, sur la route qui mène d’Athènes à Eleusis, un patelin oublié aujourd’hui de tous, qui a nom Corydalle. Il importerait peu d’en ressusciter ici le souvenir, si l’endroit n’avait été le théâtre autrefois d’une affaire atroce ; mythologique sans doute, mais donc intemporelle, et, hélas ! ― par le fait même ― toujours bien d’actualité...