Vers une dilution supplémentaire de l’identité du sacerdoce dans l’Eglise latine ? De l’abbé Claude Barthe sur le site du bi-mensuel « L’Homme Nouveau » :
 « On sait qu’une assemblée spéciale du Synode des évêques va se réunir, en octobre 2019, pour l’Amazonie, et qu’elle traitera de l’ordination d’hommes mariés pour répondre aux « nécessités pastorales » locales. De plus, le cardinal Stella, Préfet de la Congrégation pour le Clergé, personnage majeur de la Curie du Pape François, a confirmé, dans un entretien publié dans Tutti gli uomini di Francesco « Tous les hommes de François », de Fabio Marchese Ragona: (San Paolo, 2018), que le Saint-Siège est bien en train d’étudier la possibilité de « l'ordination d’hommes mariés pour un sacerdoce à temps partiel ». Le Cardinal Stella a en outre précisé que l'abolition de la règle du célibat pour les candidats à l’ordination ne concernerait pas seulement l’Amazonie, mais aussi « quelques îles du Pacifique, et pas seulement ». Cette atteinte gravissime à la structure spirituelle du sacerdoce dans l’Eglise latine a été relayée au Canada, par une discussion exploratoire des évêques du Québec, en Allemagne, au Mexique (région du Chiapas), au Brésil, en Afrique du Sud. Dans ce contexte, le cardinal Sarah (photo) a consacré un passage de son homélie prononcée, dans la cathédrale de Chartres, le 21 mai, lors de la messe conclusive du Pèlerinage de « Notre-Dame de Chrétienté », à la défense du célibat sacerdotal :
« On sait qu’une assemblée spéciale du Synode des évêques va se réunir, en octobre 2019, pour l’Amazonie, et qu’elle traitera de l’ordination d’hommes mariés pour répondre aux « nécessités pastorales » locales. De plus, le cardinal Stella, Préfet de la Congrégation pour le Clergé, personnage majeur de la Curie du Pape François, a confirmé, dans un entretien publié dans Tutti gli uomini di Francesco « Tous les hommes de François », de Fabio Marchese Ragona: (San Paolo, 2018), que le Saint-Siège est bien en train d’étudier la possibilité de « l'ordination d’hommes mariés pour un sacerdoce à temps partiel ». Le Cardinal Stella a en outre précisé que l'abolition de la règle du célibat pour les candidats à l’ordination ne concernerait pas seulement l’Amazonie, mais aussi « quelques îles du Pacifique, et pas seulement ». Cette atteinte gravissime à la structure spirituelle du sacerdoce dans l’Eglise latine a été relayée au Canada, par une discussion exploratoire des évêques du Québec, en Allemagne, au Mexique (région du Chiapas), au Brésil, en Afrique du Sud. Dans ce contexte, le cardinal Sarah (photo) a consacré un passage de son homélie prononcée, dans la cathédrale de Chartres, le 21 mai, lors de la messe conclusive du Pèlerinage de « Notre-Dame de Chrétienté », à la défense du célibat sacerdotal :
« Chers frères prêtres, gardez toujours cette certitude : être avec le Christ sur la Croix, c'est cela que le célibat sacerdotal proclame au monde ! Le projet, de nouveau émis par certains, de détacher le célibat du sacerdoce en conférant le sacrement de l’Ordre à des hommes mariés (les viri probati) pour, disent-ils, "des raisons ou des nécessités pastorales", aura pour graves conséquences, en réalité, de rompre définitivement avec la Tradition apostolique. Nous allons fabriquer un sacerdoce à notre taille humaine, mais nous ne perpétuons pas, nous ne prolongeons pas le sacerdoce du Christ, obéissant, pauvre et chaste. En effet, le prêtre n’est pas seulement un alter Christus, mais il est vraiment ipse Christus, il est le Christ lui-même ! Et c'est pour cela qu'à la suite du Christ et de l’Église, le prêtre sera toujours un signe de contradiction ! »
Ref. Célibat sacerdotal en péril : à Chartres, le cardinal Sarah est monté au créneau
On peut penser que, comme c’est déjà le cas dans l’Eglise grecque, une telle « ouverture » de la prêtrise aux hommes mariés serait reçue comme la création d’un sacerdoce de seconde zone et conduirait en outre à vider de son sens le diaconat permanent qui peine déjà à prendre ses marques depuis son exhumation par le concile « Vatican II ».
JPSC

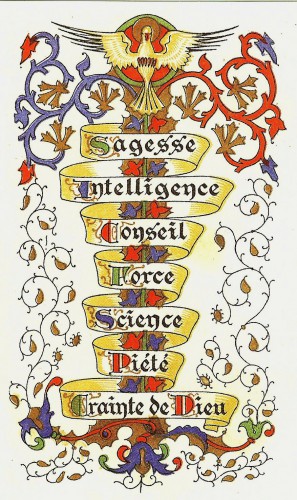
 On accuse à présent le cardinal Woelki (photo) d’avoir agi dans le dos de la Conférence des évêques d’Allemagne, ce dont il se défend dans une interview qu’on trouve sur le site internet du diocèse de Cologne, « Domradio ». Le cardinal déclare en effet avoir précisé sa position sur cette question dès le mois de mars 2017. A savoir que pour lui, il s’agit là d’une question fondamentale et tout à fait centrale : il y va de l’Eucharistie elle-même. Pour nous chrétiens catholiques, et aussi pour nos frères orthodoxes, c’est une question essentielle, car la compréhension de l’Eucharistie est toujours très étroitement liée à celles de l’unité de l’Eglise et de la confession de la foi. Et là, on ne peut pas détourner son regard des différences qui persistent entre les chrétiens catholiques et protestants : une autre conception de l’Eglise, une autre compréhension de la notion de sacrement.
On accuse à présent le cardinal Woelki (photo) d’avoir agi dans le dos de la Conférence des évêques d’Allemagne, ce dont il se défend dans une interview qu’on trouve sur le site internet du diocèse de Cologne, « Domradio ». Le cardinal déclare en effet avoir précisé sa position sur cette question dès le mois de mars 2017. A savoir que pour lui, il s’agit là d’une question fondamentale et tout à fait centrale : il y va de l’Eucharistie elle-même. Pour nous chrétiens catholiques, et aussi pour nos frères orthodoxes, c’est une question essentielle, car la compréhension de l’Eucharistie est toujours très étroitement liée à celles de l’unité de l’Eglise et de la confession de la foi. Et là, on ne peut pas détourner son regard des différences qui persistent entre les chrétiens catholiques et protestants : une autre conception de l’Eglise, une autre compréhension de la notion de sacrement. « La visite au Vatican d’une délégation d’évêques allemands désirant exposer la question de l’admission à la communion eucharistique du membre non catholique d’un couple mixte a suscité bien des commentaires, dont celui de Lucas Wiegelmann du journal « Die Welt ». Il écrit : « La communication publique que fit, le soir même de la rencontre, la Conférence épiscopale allemande - communication bien rapide et chiche - a donné l’impression que la grande confrontation attendue à Rome n’a tout simplement pas eu lieu. (…) Une minorité d’évêques réunis autour du cardinal Woelki, archevêque de Cologne, avaient apporté leur argumentation, à savoir qu’une question aussi importante que celle de la compréhension du sacrement de l’Eucharistie, pierre d’achoppement entre catholiques et protestants depuis 500 ans, ne peut pas être réglée comme ça, en passant, par quelques évêques allemands. »
« La visite au Vatican d’une délégation d’évêques allemands désirant exposer la question de l’admission à la communion eucharistique du membre non catholique d’un couple mixte a suscité bien des commentaires, dont celui de Lucas Wiegelmann du journal « Die Welt ». Il écrit : « La communication publique que fit, le soir même de la rencontre, la Conférence épiscopale allemande - communication bien rapide et chiche - a donné l’impression que la grande confrontation attendue à Rome n’a tout simplement pas eu lieu. (…) Une minorité d’évêques réunis autour du cardinal Woelki, archevêque de Cologne, avaient apporté leur argumentation, à savoir qu’une question aussi importante que celle de la compréhension du sacrement de l’Eucharistie, pierre d’achoppement entre catholiques et protestants depuis 500 ans, ne peut pas être réglée comme ça, en passant, par quelques évêques allemands. » 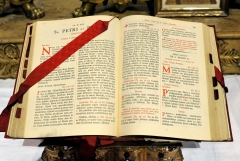 Que la langue du culte se distingue de celle de la vie courante est un phénomène sinon universel, du moins largement répandu dans beaucoup de liturgies.
Que la langue du culte se distingue de celle de la vie courante est un phénomène sinon universel, du moins largement répandu dans beaucoup de liturgies.