De l’abbé Christian Gouyaud, sur le site web du mensuel La Nef :
"Méditons sur Noël avec Benoît XVI…
 Noël peut d’abord être envisagé du côté du Père qui interpelle le Fils : « Le Seigneur m’a dit : “Tu es mon fils ; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré” » (Ps 2). Benoît XVI nous rappelle le fondement du mystère trinitaire. Dieu est unique, mais il n’est pas solitaire, il « n’est pas solitude éternelle mais cercle d’amour où il se donne et se redonne dans la réciprocité ». « Tu es mon Fils » passe ainsi de l’éternité à l’histoire : « L’aujourd’hui éternel de Dieu est descendu dans l’aujourd’hui éphémère du monde et il entraîne notre aujourd’hui passager dans l’aujourd’hui éternel de Dieu. »
Noël peut d’abord être envisagé du côté du Père qui interpelle le Fils : « Le Seigneur m’a dit : “Tu es mon fils ; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré” » (Ps 2). Benoît XVI nous rappelle le fondement du mystère trinitaire. Dieu est unique, mais il n’est pas solitaire, il « n’est pas solitude éternelle mais cercle d’amour où il se donne et se redonne dans la réciprocité ». « Tu es mon Fils » passe ainsi de l’éternité à l’histoire : « L’aujourd’hui éternel de Dieu est descendu dans l’aujourd’hui éphémère du monde et il entraîne notre aujourd’hui passager dans l’aujourd’hui éternel de Dieu. »
Noël, c’est l’Enfant. Ici, Benoît XVI commente Is 10, 23 : « Dieu a rendu brève sa Parole, Il l’a abrégée. » La Parole de la Sainte Écriture était devenue trop longue et complexe. Toute la Loi et les Prophètes ont ainsi été abrégés dans le double commandement de l’amour. La Parole incarnée a été raccourcie à la taille d’un petit enfant avant d’être réduite aux dimensions d’un morceau de pain. D’où cette abréviation : « Le Créateur qui tient tout dans ses mains, dont nous dépendons tous, se fait petit et nécessiteux de l’amour humain. » La dimension épiphanique de Noël peut aussi être mise en exergue à partir de Tt 3, 4 : « Apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes. » Apparaissant comme un enfant, il s’oppose à toute violence. Et Benoît XVI de s’exclamer : « En ce moment où le monde est continuellement menacé par la violence en de nombreux endroits et de diverses manières ; où il y a toujours et encore des bâtons de l’oppresseur et des manteaux roulés dans le sang, nous crions vers le Seigneur : Toi, le Dieu-Fort, tu es apparu comme un enfant et tu t’es montré à nous comme Celui qui nous aime et Celui par lequel l’amour vaincra. Et Tu nous as fait comprendre qu’avec Toi nous devons être des artisans de paix. Nous aimons Ton être-enfant. »
Noël, c’est l’étable, ce « palais un peu délabré », le trône de David qui préfigure la Croix, la « terre maltraitée » qui retrouve son harmonique avec le ciel, ainsi que les anges le chantent. Jusqu’à présent, les anges n’avaient connu Dieu qu’« à travers la cohérence et la beauté du cosmos qui proviennent de Lui et en sont le reflet » et ils avaient transposé la louange muette de la création en musique céleste. Mais l’entrée de Dieu dans l’histoire des hommes suscite chez eux un tel bouleversement qu’il donne lieu à un chant nouveau : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes. » Mais l’homme contemporain n’est-il pas « religieusement privé d’oreille musicale », atrophié qu’il est dans sa sensibilité pour Dieu ?
Les bergers, quant à eux, se distinguent par leur vigilance. Si celui qui rêve « est enfermé dans ce monde du rêve qui, justement, n’est que le sien et ne le relie pas aux autres », celui qui se réveille entre d’emblée dans la réalité commune. Benoît XVI remarque bien que les bergers se hâtent d’aller à Bethléem, ce qui pose la question de savoir si, nous aussi, nous considérons les affaires de Dieu comme prioritaires et si nous avons la liberté intérieure de mettre au second plan les autres occupations. Ils n’étaient du reste pas très loin de l’endroit de la nativité, ce qui a permis à des Pères de l’Église de voir dans les bergers les « voisins » par excellence, qui vivent dans la proximité de Dieu. Ces bergers, Benoît XVI ne leur fait pas seulement dire : « Voyons ce qui est arrivé » selon une pâle traduction du grec autrement plus vigoureux : « Voyons cette Parole qui, là, est advenue. » La Parole, en effet, « peut être contemplée puisqu’elle s’est faite chair ».
Le pape s’intéresse aussi à la concision du compte rendu du fait en Lc 2, 7 : « Marie mit au monde son fils premier-né. » Le plus grand événement de l’histoire du monde est raconté « de manière absolument privée de pathos » ! « Premier né » de par le statut des prémices en Israël, ce qui n’implique évidemment pas qu’il soit le premier d’une série d’autres enfants. He, 5-7 le qualifie de « premier-né » dans la perspective sacerdotale de l’Épître : voué au sacrifice. Les Lettres aux Colossiens et aux Éphésiens théologisent encore cette situation : premier-né d’entre les créatures car archétype de l’homme ; premier-né d’entre les morts en raison de sa résurrection qui « a abattu le mur de la mort pour nous tous ». À Noël, il est vraiment le « premier-né » car il nous offre sa fraternité par l’adoption divine.
Le pape, finalement, évoque l’ouverture basse d’un mètre et demi par laquelle on accède désormais à la Basilique de la Nativité à Bethléem : « L’intention était probablement de mieux protéger l’église contre d’éventuels assauts, mais surtout d’éviter qu’on entre à cheval dans la maison de Dieu. Celui qui désire entrer dans le lieu de la naissance de Jésus, doit se baisser. Il me semble qu’en cela se manifeste une vérité plus profonde […] : si nous voulons trouver le Dieu apparu comme un enfant, alors nous devons descendre du cheval de notre raison “libérale”. Nous devons déposer nos fausses certitudes, notre orgueil intellectuel, qui nous empêche de percevoir la proximité de Dieu. » Et Benoît XVI de nous inviter à suivre le chemin intérieur d’un saint François d’Assise, « le chemin vers cette extrême simplicité extérieure et intérieure qui rend le cœur capable de voir » ".
Abbé Christian Gouyaud
Ref.Joyeux Noël !
Docteur en théologie, curé dans le diocèse de Strasbourg, membre de Totus tuus, il est l’auteur notamment de La catéchèse, vingt ans après le Catéchisme (Artège, 2012), Quelle prédication des fins dernières aujourd’hui ? (La Nef, 2011). Il collabore régulièrement à La Nef.
JPSC

 Le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte divin, prononçait une conférence en anglais sur l’Europe, le 22 octobre dernier à Varsovie, invité par le mouvement Europa Christi. Nous remercions vivement le cardinal Sarah qui nous a confié la publication en français de ce texte remarquable.
Le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte divin, prononçait une conférence en anglais sur l’Europe, le 22 octobre dernier à Varsovie, invité par le mouvement Europa Christi. Nous remercions vivement le cardinal Sarah qui nous a confié la publication en français de ce texte remarquable. « À propos de ce qu’on connaît des lignes maîtresses du projet de présentation du volet historique par le MRAC rénové et de leurs conditions d’élaboration.
« À propos de ce qu’on connaît des lignes maîtresses du projet de présentation du volet historique par le MRAC rénové et de leurs conditions d’élaboration. Lu sur le site du Centre d’Action Laïque (C.A.L.)
Lu sur le site du Centre d’Action Laïque (C.A.L.)
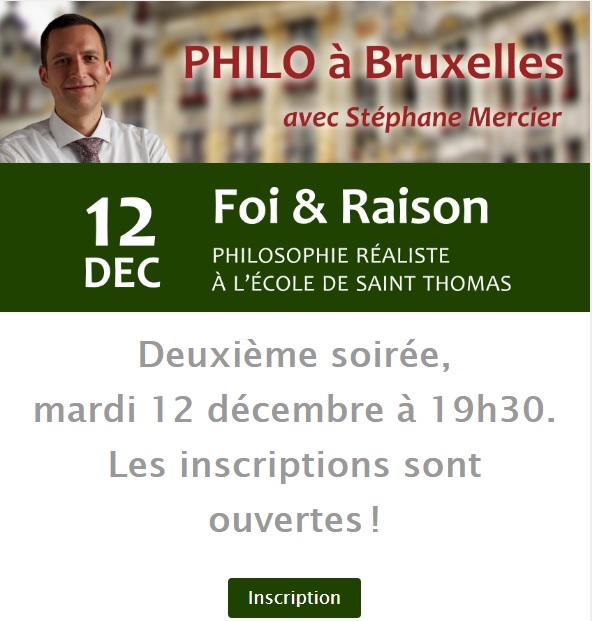
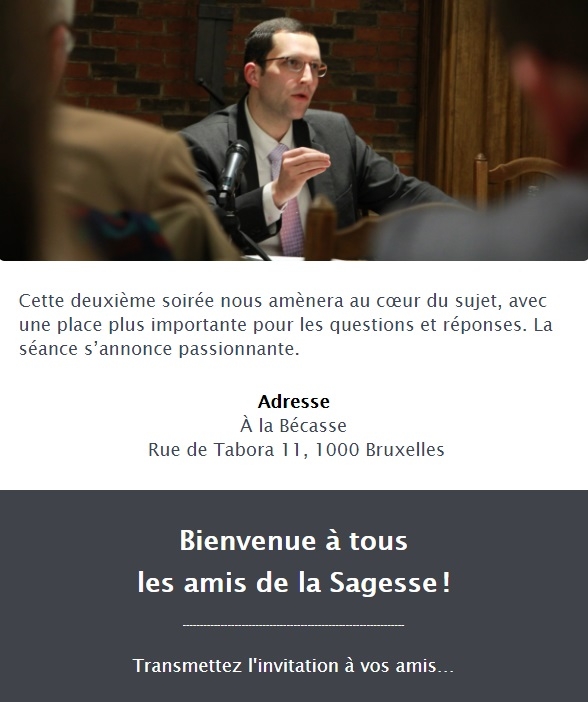
 « La parole de Dieu est claire
« La parole de Dieu est claire