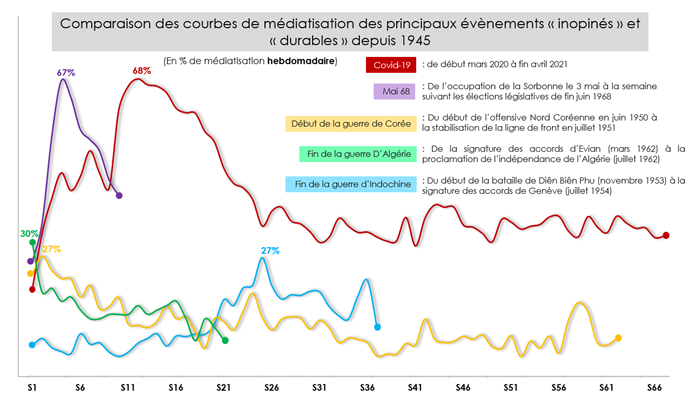Il vaut vraiment la peine de lire ce long article de Rachel Aviv, rédactrice en chef au New Yorker, dans une "Lettre de Belgique" parue le 22 juin 2015 sur le site de ce journal. Merci à Erwan Le Morhedec, sur twitter, d'avoir attiré notre attention sur cette publication à laquelle il ne semble pas que le moindre écho ait été donné dans la presse belge (traduction : https://www.deepl.com/translator) :

Le traitement de la mort
Quand faut-il aider les personnes atteintes d'une maladie non terminale à mourir ?
Dans son journal intime, Godelieve De Troyer classait ses humeurs par couleur. Elle se sentait "gris foncé" lorsqu'elle faisait une erreur en cousant ou en cuisinant. Quand son petit ami parlait trop, elle oscillait entre "très noir" et "noir !". Elle était affligée de la pire des "taches noires" lorsqu'elle rendait visite à ses parents dans leur ferme du nord de la Belgique. En leur présence, elle se sentait agressive et dangereuse. Elle craignait d'avoir deux moi, l'un "empathique, charmant, sensible" et l'autre cruel.
La loi belge autorise l'euthanasie pour les patients qui souffrent d'une détresse grave et incurable, y compris de troubles psychologiques.
Elle se sentait "gris clair" lorsqu'elle allait chez le coiffeur ou faisait du vélo dans les bois de Hasselt, une petite ville de la région flamande de Belgique, où elle vivait. Dans ces moments-là, écrit-elle, elle essayait de se rappeler toutes les choses qu'elle pouvait faire pour se sentir heureuse : "exiger le respect des autres", "être physiquement attirante", "adopter une attitude réservée", "vivre en harmonie avec la nature". Elle a imaginé une vie dans laquelle elle était intellectuellement appréciée, socialement engagée, parlant couramment l'anglais (elle suivait un cours), et avait une "femme de ménage avec qui je m'entends très bien."
Godelieve, qui enseignait l'anatomie aux infirmières, suivait une thérapie depuis l'âge de dix-neuf ans. Avec chaque nouveau médecin, elle s'engageait à nouveau dans le processus thérapeutique, adoptant la philosophie de son médecin et réécrivant l'histoire de sa vie pour qu'elle corresponde à sa théorie de l'esprit. Elle dissèque continuellement la source de sa détresse. "Je suis confrontée presque quotidiennement aux conséquences de mon enfance", écrit-elle à sa mère. Elle avait voulu être historienne, mais son père, dominateur et froid, l'avait poussée à devenir médecin. Sa mère, malheureuse dans son mariage, lui faisait penser à une "esclave". "Nouvelle vision", écrit-elle dans son journal. "Je ne veux pas toujours acquiescer comme elle et être effacée."
Godelieve était préoccupée par l'idée qu'elle reproduirait les erreurs de ses parents avec ses propres enfants. Elle s'est mariée à l'âge de vingt-trois ans et a eu deux enfants. Mais le mariage a été tumultueux et s'est terminé par un divorce, en 1979, alors que son fils avait trois ans et sa fille sept. Deux ans plus tard, leur père, Hendrik Mortier, un radiologue, se suicide. En tant que parent isolé, Godelieve est dépassée. Dans un journal intime datant de 1990, alors que ses enfants sont adolescents, elle se dit qu'il faut "laisser mes enfants être eux-mêmes, les respecter dans leur individualité". Mais elle s'est retrouvée à se battre avec sa fille, qui était indépendante et distante sur le plan émotionnel, et à dépendre de son fils, Tom, "victime de mon instabilité", écrit-elle. Elle s'inquiétait, disait-elle à son psychologue, que ses enfants "paient maintenant pour tout ce qui s'est passé des générations plus tôt."
La période la plus heureuse de la vie de Godelieve a commencé lorsqu'elle avait une cinquantaine d'années et un nouveau petit ami. Elle avait l'impression d'avoir enfin dépassé les drames de son enfance, un accomplissement pour lequel elle a crédité son nouveau psychiatre. "Il ouvre complètement la plaie, la nettoie à fond et la referme pour qu'elle puisse guérir", écrit-elle à un ami. Godelieve, qui avait des cheveux blonds et un sourire mélancolique, s'est fait de nombreux amis pendant ces années. "C'était la plus belle des femmes", m'a dit Tom. "Les gens me disaient : "Oh, je pourrais tomber amoureux de ta mère". "Christiane Geuens, une amie proche, a déclaré : "Les gens voulaient toujours la connaître. Quand elle entrait dans une pièce, tout le monde le savait."
Lire la suite