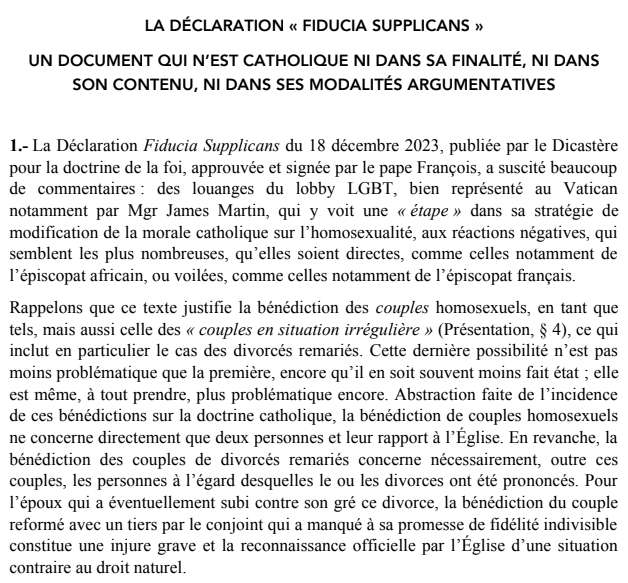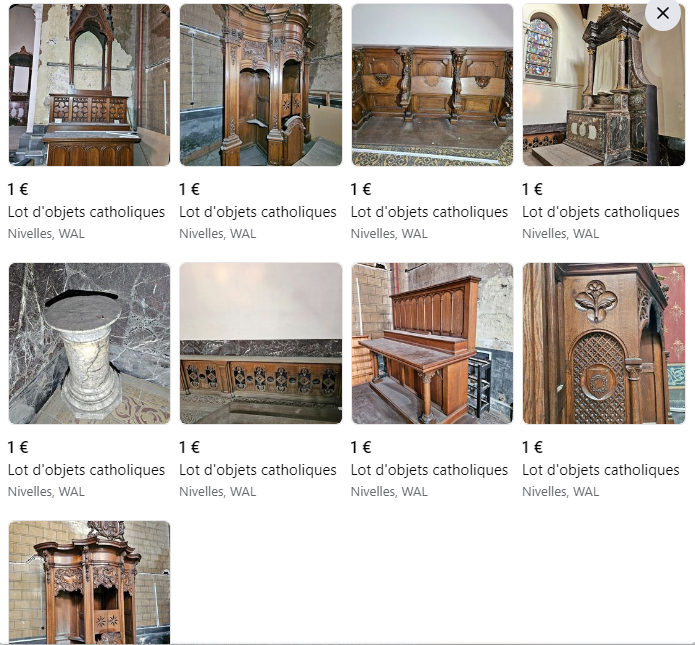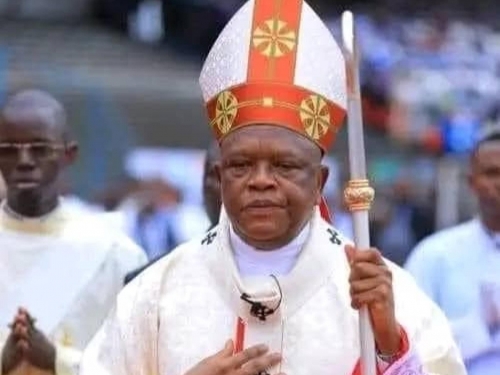De Rod Dreher sur The European Conservative :
Houellebecq, prophète de l'Europe post-chrétienne
Houellebecq est peut-être décadent dans sa vie personnelle, mais aucun romancier ne voit la crise religieuse de l'Europe avec des yeux plus clairs.
14 janvier 2024
Un clip vidéo accompagné de l'affirmation alarmante "Conquis : Les chrétiens français se rendent" a fait le tour de la toile ces derniers temps. On y voit un Arabe musulman chanter l'adhaan, l'appel islamique à la prière, à l'intérieur d'une église parisienne,
Enfin, pas vraiment. Dans ce cas, l'appel à la prière faisait partie d'une représentation de "L'homme armé : A Mass For Peace", une œuvre de musique classique de 1999 du compositeur gallois Karl Jenkins, qui l'a composée à la suite de la guerre du Kosovo. Elle combine des éléments de la messe catholique avec l'appel à la prière de l'islam, un poème profane et un texte hindou.
On peut débattre de la question de savoir s'il est juste ou non d'autoriser les prières de religions non chrétiennes dans une église chrétienne, quel que soit le contexte ; personnellement, je suis un puriste en la matière et je serais tout à fait favorable à ce qu'une mosquée ou une synagogue interdise l'exécution de prières chrétiennes à l'intérieur de ses murs, quelles que soient les circonstances. Mais pour être juste, il faut reconnaître que dans le cas célèbre de Paris, l'adhaan n'apparaît pas comme un culte, mais comme une partie d'une performance artistique.
Voici la traduction anglaise de l'adhaan :
Dieu est grand (4x)
Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre digne d'adoration que Dieu (Allah). (2x)
Je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah (2x)
Venez à la prière (2x)
Il est facile de comprendre pourquoi certains chrétiens, en particulier en France, trouvent cela si alarmant. Il faudrait être idiot pour ignorer ou minimiser les vives tensions entre la population islamique de France et les non-musulmans, sans parler des "chrétiens", car la France est le pays le plus athée d'Europe. Il semble que ces Français non croyants préfèrent qu'il n'y ait pas de religion du tout, et se sont laissés aller à croire au mythe du progrès conduisant inévitablement à une place publique désacralisée.
On ne combat pas quelque chose avec rien. Si les Français n'aiment pas l'islamisation de la vie publique française, ce n'est pas en redoublant de laïcisme qu'ils vont l'arrêter. Dans le roman controversé de Michel Houellebecq, Soumission, paru en 2015, le public français démoralisé et déchristianisé se tourne volontairement vers un gouvernement islamiste, dans ce qui équivaut à une vaste confession publique de l'inadéquation du matérialisme impie pour fournir une base solide à un mode de vie.
Houellebecq est peut-être décadent dans sa vie personnelle - ses frasques sont parfois sordides et il a l'air de vivre sous un pont - mais aucun romancier ne voit la crise religieuse de l'Europe avec des yeux plus clairs.
Louis Betty, universitaire américain spécialiste de la littérature française dont on a parlé récemment dans ces pages pour son travail de traduction et d'édition des essais de Rénaud Camus, a publié en 2016 une analyse pénétrante de la vision religieuse de Houellebecq, intitulée Without God : Michel Houellebecq et l'horreur matérialiste. Bien que Houellebecq ne soit pas personnellement religieux, Betty affirme qu'il est "un écrivain profondément et inévitablement religieux".