
Tristes Pâques au pied de la chaîne des Virunga et ailleurs. Lu sur le site de la Libre Afrique :
« Quand le pape viendra, nous lui dirons nos douleurs et nos misères… » En ce week-end de Pâques, dans un site de déplacés de Rutshuru, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), Stéphanie Aziza, 25 ans, n’a pas le coeur à la fête. Depuis les récents combats entre l’armée et les rebelles du Mouvement du 23 mai (M23) dans la province du Nord-Kivu, elle est sans nouvelles d’un de ses trois enfants, perdu dans le chaos de la fuite.
Comment célébrer Pâques, « quand en plus on n’a pas à manger? », ajoute tristement la mère de famille, un petit enfant à la main, dans la cour de l’école Rugabo, où sont réfugiés plusieurs centaines de villageois.
Non loin de là, une autre famille trie des haricots, pour le repas du dimanche de Pâques.
L’est de la RDC est en proie depuis plus d’un quart de siècle aux violences de multiples groupes armés. La venue du pape François début juillet à Goma, le chef-lieu du Nord-Kivu, est présentée par l’Eglise catholique comme « un signe de réconfort et de paix ».
« C’est la première fois qu’il foule notre terre, c’est une bénédiction divine », veut croire Heri Byiringiro, un autre déplacé.
Fin mars, dans la région de Rutshuru, le « Mouvement du 23 mars », une ancienne rébellion tutsi réapparue en fin d’année dernière, s’est emparé de plusieurs collines, dont les habitants se sont enfuis vers l’Ouganda tout proche et vers le centre du chef-lieu du territoire.
Les combats violents ont duré deux jours, se sont arrêtés une semaine et ont repris. Depuis quelques jours, c’est de nouveau l’accalmie, mais la tension est palpable, les militaires sont sur les dents.
Samedi, à environ 6 km de Rutshuru-centre, quelques fidèles catholiques ont fêté Pâques dans la chapelle du village de Rangira, assistant à la seule messe pascale organisée dans toute la paroisse de Jomba, très affectée par les combats.
Près du bâtiment de briques, un camp militaire a été installé, pour contrer l’avancée rebelle. Des camions remplis de soldats passent sur la route, des jeeps sont en patrouille.
« Nous remercions le Seigneur qui vient de permettre l’arrivée de notre curé. Nous pensions qu’il était mort », déclare Dusera Nyirangorengore, tout juste revenue de Rutshuru où elle s’était enfuie.
« Nous avons vécu le pire. Je priais, avec mon chapelet, pour que les bombes ne nous tombent pas dessus en brousse », raconte-t-elle.
Leur curé, l’abbé Juvénal Ndimubanzi, pris dans les affrontements entre l’armée et le M23, a eu la vie sauve lorsque la force de l’ONU en RDC, la Monusco, l’a évacué, le 28 mars. Sa paroisse de Jomba est encore sous le contrôle du M23, inaccessible.
« Prions pour les régions du monde qui souffrent de la guerre; et que la paix revienne ici chez nous, afin que les déplacés regagnent leurs villages! », déclare à l’assistance un servant, debout près de l’abbé.
A l’heure à laquelle se déroule généralement le Chemin de Croix, une grand-messe a eu lieu vendredi à Rutshuru-centre dans l’église Saint-Aloys, à laquelle ont assisté des centaines de fidèles, recueillis et silencieux.
Ailleurs dans le territoire, les célébrations ont été réduites. Les fidèles ont dû renoncer aux traditionnelles veillées du samedi soir, à cause de l’insécurité et de l’état de siège en vigueur depuis près d’un an dans le Nord-Kivu et la province voisine d’Ituri, qui a instauré un couvre-feu.
Dans la modeste chapelle de Rangira, Jean-Pierre Sebaganzi, un fidèle de 45 ans, se réjouit tout de même d’avoir pu fêter Pâques, « malgré la peur »
Ref. RDC: tristes fêtes de Pâques pour les déplacés du conflit avec le M23
Que pensez-vous de cet article et que fait entretemps l’ancienne métropole tutélaire ?

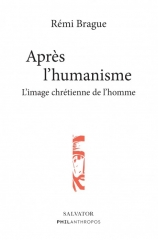 Rémi Brague est professeur émérite de philosophie médiévale, arabe et juive. Membre de l’Institut de France et auteur d’une œuvre importante. Voici, le texte de interview qu’il a accordée à Christophe Geffroy, fondateur et directeur du mensuel La Nef à propos de son dernier livre : « Après l’humanisme. L’image chrétienne de l’homme » Salvator, 2022, 210 pages, 20 € :
Rémi Brague est professeur émérite de philosophie médiévale, arabe et juive. Membre de l’Institut de France et auteur d’une œuvre importante. Voici, le texte de interview qu’il a accordée à Christophe Geffroy, fondateur et directeur du mensuel La Nef à propos de son dernier livre : « Après l’humanisme. L’image chrétienne de l’homme » Salvator, 2022, 210 pages, 20 € :


