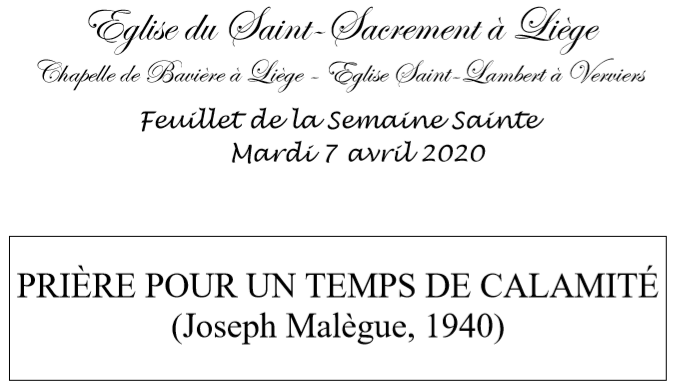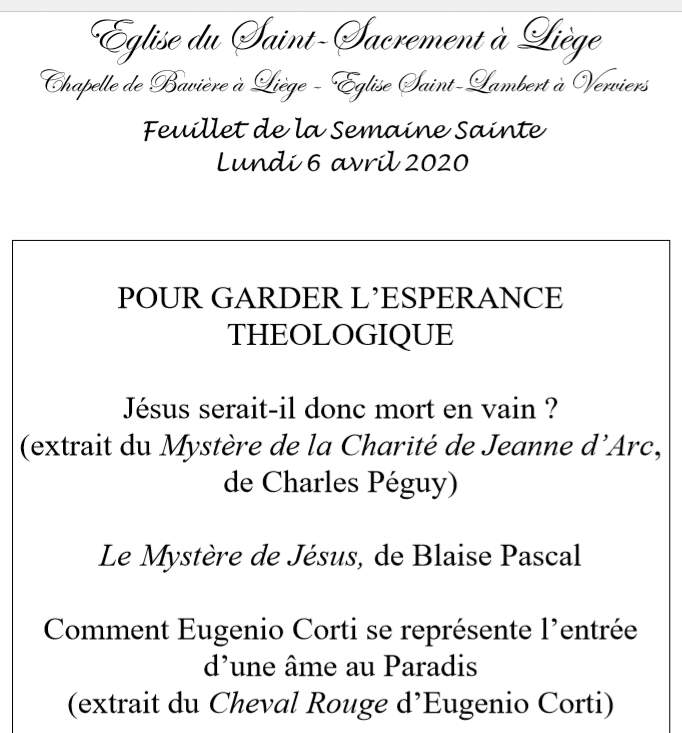Foi - Page 478
-
Semaine Sainte et confinement; feuillet du mardi 7 avril : Prière pour un temps de calamité (Joseph Malègue)
-
Témoignage : un séminariste-médecin au chevet des malades du coronavirus
D’Elisabeth Caillemer sur le site web de magazine « Famille Chrétienne »
 « L’abbé Thibaud Perruchot, 30 ans, est médecin et séminariste chez les Missionnaires de la Miséricorde Divine. Alors qu’il effectuait son stage inter-cycle (équivalent à la 4e année de séminaire) à Strasbourg, il s’est porté volontaire pour soigner les malades du coronavirus. Il a rejoint l’hôpital de Longjumeau dans l’Essonne.
« L’abbé Thibaud Perruchot, 30 ans, est médecin et séminariste chez les Missionnaires de la Miséricorde Divine. Alors qu’il effectuait son stage inter-cycle (équivalent à la 4e année de séminaire) à Strasbourg, il s’est porté volontaire pour soigner les malades du coronavirus. Il a rejoint l’hôpital de Longjumeau dans l’Essonne.« Lorsque l’épidémie a commencé, j’ai pris contact avec la chef de service auprès de laquelle j’avais effectué mon stage d’internat aux urgences pour lui proposer mon aide. Elle a immédiatement accepté. Je suis arrivé à l’hôpital de Longjumeau le 19 mars, jour de la saint Joseph. J’ai été impressionné par la vitesse de réaction et la capacité d’adaptation du personnel de l’hôpital face à l’afflux des malades. Il a fallu séparer les patients les uns des autres, créer des unités « spécial covid ». Peu à peu, la plupart des unités ont été transformées pour accueillir les malades atteints par le coronavirus, à savoir près de 110 lits. Les autres patients ont été renvoyés chez eux ou transférés dans d'autres hôpitaux.
Tous les matins, l’organisation de la veille doit être révisée. Nous vivons au jour le jour, face à l’afflux de malades l’hôpital a dû restructurer les urgences et même créer à l’arrache des lits de réanimation. Nous travaillons énormément avec un risque majeur de contamination. Nous manquons régulièrement de matériel : masques, tabliers, charlotte... et n’avons aucun stock d’avance. Hier j’ai dû attendre trois quart d’heure une charlotte pour prendre en charge un nouveau patient.
Ce qui se passe actuellement est la conséquence d’une politique gouvernementale de réduction des coûts dans les hôpitaux menée depuis plusieurs années. Le système était déjà en surchauffe avant l’épidémie, aujourd’hui nous assistons à une véritable catastrophe. Des gens meurent faute de moyens pour les soigner. Un patient grave reste trois semaines en réanimation ce qui pose un vrai problème de turn over : il n’y a pas la place pour tout le monde. Lorsqu’un nouveau malade grave arrive et qu’il n’y a plus de lit de réanimation disponible nous le transférons ailleurs et dans tous les cas nous limitons les indications de réanimation car il n'y a pas de place pour tout le monde. Parmi les patients graves, nous ne gardons que les personnes les plus susceptibles de s’en sortir, c'est à dire les plus jeunes. Nous renvoyons à domicile ceux qui peuvent avoir de l’oxygène à la maison, un suivi médical rapproché et l'attention nécessaire à la fin de vie. Dans le cas contraire, ils sont admis dans une démarche de soins palliatifs en gardant l’espoir qu'ils puissent passer le cap.
Malgré la tension psychologique et la fatigue qui arrive, les équipes tiennent le coup et gardent le moral. Il le faut de toute manière, car nous ne sommes pas encore parvenus au pic de l’épidémie qui va se produire dans quelques jours et qui nécessitera des besoins accrus en personnel. Espérons que ce dernier, particulièrement exposé dans les services de réanimations où les respirateurs sont de véritables distributeurs de microbes, sera opérationnel, sinon j'ignore comment nous allons faire pour gérer en même temps l’augmentation des hospitalisations et la baisse du nombre de personnel.
A l’hôpital, les soignants savent que je suis séminariste. C’est l’occasion, avec ces anciens collègues, de parler spiritualité. Cette épidémie doit offrir aux chrétiens l’opportunité missionnaire de rappeler que Dieu est là, au milieu de nos détresses, qu’il ne nous abandonne pas, que grâce au Christ, la vie a déjà vaincu la mort. Cette espérance peut et doit être un baume pour tous ceux qui ne croient pas et qui sont en proie au désespoir face à cette vague épidémique. Il faut que les chrétiens témoignent de leur foi, et pour cela, il faut avoir une vraie vie de prière, plus intense encore. En ces derniers jours qui nous séparent de Pâques, tournons vers le Christ afin de rayonner de Sa Lumière auprès de tous nos frères ! »
Élisabeth Caillemer »
Ref.un séminariste-médecin au chevet des malades du coronavirus
Un clic ici pour se connecter avec la communauté des missionnaires de la miséricorde
Vivez les offices la Semaine Sainte en direct avec les Missionnaires de la Miséricorde
JPSC
-
Messes et célébrations (radio, TV, Internet) pour ce Lundi Saint
Cliquer sur ce lien : https://www.egliseinfo.be/horaires/%2523internet%20all-celebration
Lien permanent Catégories : Actualité, Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, liturgie, Médias, Spiritualité 0 commentaire -
Le message du cardinal Burke pour "la semaine la plus sainte de l'année"
Du Blog de Jeanne Smits :
Cardinal Raymond Burke : Message pour la semaine la plus sainte de l’année (traduction intégrale)
Bien volontiers et à sa demande, je publie ci-dessous ma traduction du message adressé à l’occasion du Dimanche des Rameaux par le cardinal Burke à tous ceux qui le suivent sur son blog.Il s’agit d’une traduction provisoire qui pourra être amendée dans les heures qui viennent par Son Eminence. – J.S.Message pour la semaine la plus sainte de l'année
Chers amis,
Dès les débuts de mon service comme évêque d’un diocèse, il m’a semblé que chaque année, à l’approche des célébrations de Noël et de Pâques, un événement profondément triste se produisait dans le diocèse, ou une crise difficile à affronter pour le bien du diocèse. Alors même que j’anticipais avec joie les célébrations des grands mystères de notre salut, quelque chose se produisait qui, d’un point de vue humain, faisait planer un nuage sombre sur les célébrations, remettant en question la joie qu’elles inspiraient. Une fois, lorsque j’ai évoqué auprès d’un frère évêque cette pénible expérience, trop régulière, il m’a répondu simplement : « C’est Satan, qui essaie de vous voler votre joie. »Il est logique que Satan, que Notre Seigneur décrit comme « homicide dès le commencement,… menteur, et le père du mensonge » (Jn 8, 44) veuille cacher à nos yeux les grandes réalités de l’Incarnation et de la Rédemption, cherchant à nous distraire des rites liturgiques par lesquels nous célébrons non seulement ces vérités, mais où nous recevons les grâces incommensurables et incessantes qu’elles ont gagnées pour nous. Satan veut nous convaincre que la perte [de ceux que nous aimons] et la mort, ainsi que la tristesse et la peur qui accompagnent naturellement ces événements, démontrent que le Christ est faux, démentent Son Incarnation rédemptrice, et montrent que notre foi et la joie qu’elle inspire naturellement est un mensonge
Mais c’est Satan qui est faux. C’est lui, le menteur. Le Christ, Dieu le Fils, est en effet devenu homme, Il a souffert sa Passion et sa Mort, si terriblement cruelles, afin de racheter notre nature humaine, de nous rendre la vraie vie, la vie divine qui surmonte les pires souffrances et même la mort elle-même, et qu’Il nous conduit sûrement et en toute sécurité vers notre véritable destin : la vie éternelle avec Lui.
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
Carême et confinement; feuillet du lundi 6 avril : "Pour garder l'espérance théologique"
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
L'homélie du pape pour le Dimanche des Rameaux
L’homélie du pape François lors de la messe des Rameaux (source)
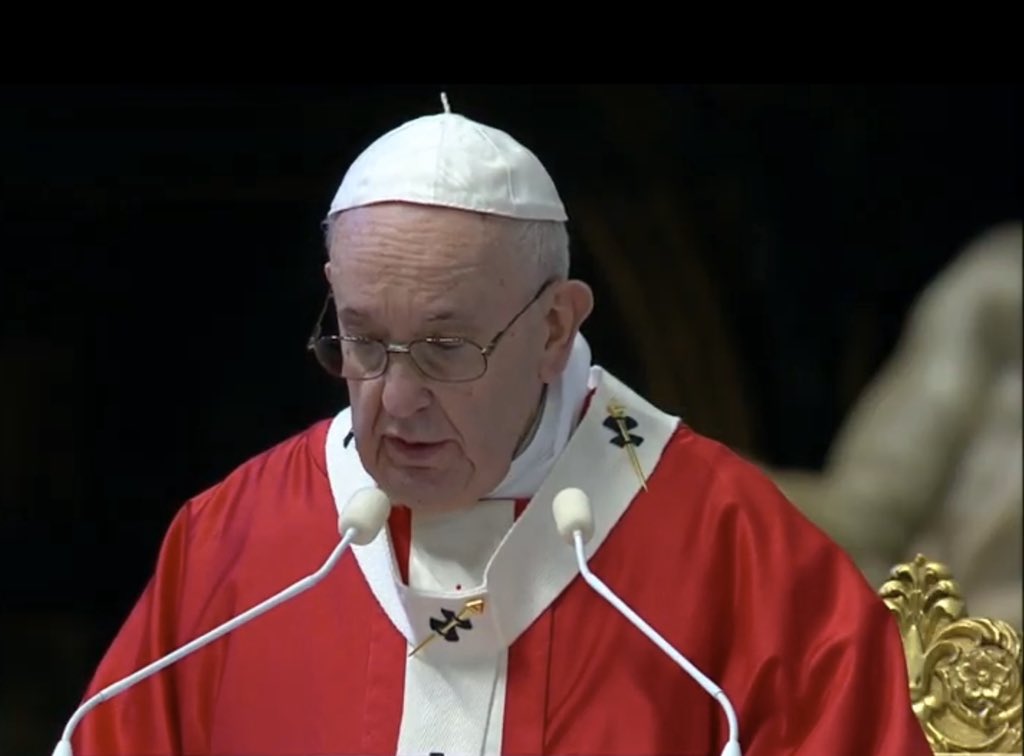
5 avril 2020
Homélie du pape François
Jésus « s’est anéanti, prenant la condition de serviteur » (Ph 2, 7). Laissons-nous introduire dans les jours saints par ces mots de l’apôtre Paul, où la Parole de Dieu, comme un refrain, montre Jésus comme un serviteur : le Jeudi saint il est le serviteur qui lave les pieds à ses disciples ; le Vendredi saint il est présenté comme le serviteur souffrant et victorieux (cf. Is 52, 13) ; et déjà demain, Isaïe prophétisera de lui : « Voici mon serviteur que je soutiens » (Is 42, 1). Dieu nous a sauvés en nous servant. En général nous pensons que c’est à nous de servir Dieu. Non, c’est lui qui nous a servi gratuitement, parce qu’il nous a aimé en premier. Il est difficile d’aimer sans être aimés. Et il est encore plus difficile de servir si nous ne nous laissons pas servir par Dieu.
Mais de quelle façon le Seigneur nous a-t-il servi ? En donnant sa vie pour nous. Nous lui sommes chers et nous lui avons coûté cher. Sainte Angèle de Foligno a témoigné d’avoir entendu de Jésus ces paroles : « Ce n’est pas pour rire que je t’ai aimée ». Son amour l’a conduit à se sacrifier pour nous, à prendre sur lui tout notre mal. C’est une chose qui nous laisse pantois : Dieu nous a sauvés en acceptant que notre mal s’acharne sur lui. Sans réagir, avec seulement l’humilité, la patience et l’obéissance du serviteur, exclusivement avec la force de l’amour. Et le Père a soutenu le service de Jésus : il n’a pas mis en déroute le mal qui s’abattait sur lui, mais il a soutenu sa souffrance, pour que notre mal soit vaincu seulement par le bien, pour qu’il soit traversé jusqu’au fond par l’amour. Jusqu’au fond.
Le Seigneur nous a servis jusqu’à éprouver les situations les plus douloureuses pour qui aime : la trahison et l’abandon.
La trahison. Jésus a subi la trahison du disciple qui l’a vendu et du disciple qui l’a renié. Il a été trahi par les gens qui l’acclamaient et qui ensuite ont crié : « Qu’il soit crucifié ! » (Mt 27, 22). Il a été trahi par l’institution religieuse qui l’a condamné injustement et par l’institution politique qui s’est lavé les mains. Pensons aux petites et aux grandes trahisons que nous avons subies dans la vie. C’est terrible quand on découvre que la confiance bien placée a été trompée. Naît au fond du cœur une déception telle que la vie semble ne plus avoir de sens. Cela arrive parce que nous sommes nés pour être aimés et pour aimer, et la chose la plus douloureuse c’est d’être trahi par celui qui a promis de nous être loyal et proche. Nous ne pouvons pas non plus imaginer comme cela a été douloureux pour Dieu, qui est amour.
Regardons-nous à l’intérieur. Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous verrons nos infidélités. Que de fausseté, d’hypocrisies et de duplicités ! Que de bonnes intentions trahies ! Que de promesses non tenues ! Que de résolutions laissées s’évanouir ! Le Seigneur connaît notre cœur mieux que nous, il sait combien nous sommes faibles et inconstants, combien de fois nous tombons, que de mal nous avons à nous relever et combien il est difficile de guérir certaines blessures. Et qu’a-t-il fait pour venir à notre rencontre, pour nous servir ? Ce qu’il avait dit par le prophète : « Moi je les guérirai de leurs infidélités, je les aimerai d’un amour gratuit » (Os 14, 5). Il nous a guéris en prenant sur lui nos infidélités, en enlevant nos trahisons. De sorte que, au lieu de nous décourager par peur de ne pas y arriver, nous pouvons lever notre regard vers le Crucifié, recevoir son embrassade et dire : “Voilà, mon infidélité est là, tu l’as prise, toi, Jésus. Tu m’ouvres les bras, tu me sers par ton amour, tu continues à me soutenir…Alors j’avance !”
L’abandon. Sur la croix, dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jésus dit une phrase, une seule : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27, 46). C’est une phrase forte. Jésus avait souffert l’abandon des siens, qui avaient fui. Mais il lui restait le Père. Maintenant, dans l’abîme de la solitude, pour la première fois il l’appelle par le nom générique de “ Dieu”. Et il lui crie « d’une voix forte » le “pourquoi” le plus déchirant : “ Pourquoi, toi aussi, m’as-tu abandonné ? ”. Ce sont en réalité les paroles d’un Psaume (cf. 21, 2) : on y dit que Jésus a aussi porté en prière l’extrême désolation. Mais il reste le fait qu’il l’a éprouvée : il a éprouvé l’abandon le plus grand dont les Evangiles témoignent en rapportant ses paroles originales : Eli, Eli lemà sabactani ?
Pourquoi tout cela ? Encore une fois pour nous, pour nous servir. Parce que lorsque nous nous sentons le dos au mur, quand nous nous trouvons dans une impasse, sans lumière et sans issue, quand il semble que même Dieu ne répond pas, nous nous rappelions que nous ne sommes pas seuls. Jésus a éprouvé l’abandon total, la situation qui lui est la plus étrangère, afin de nous être solidaire en tout. Il l’a fait pour moi, pour toi, pour te dire : “ N’aie pas peur, tu n’es pas seul. J’ai éprouvé toute ta désolation pour être toujours à ton côté ”. Voilà jusqu’où Jésus nous a servi, descendant dans l’abîme de nos souffrances les plus atroces, jusqu’à la trahison et à l’abandon. Aujourd’hui, dans le drame de la pandémie, face à tant de certitudes qui s’effritent, face à tant d’attentes trahies, dans le sens d’un abandon qui nous serre le cœur, Jésus dit à chacun de nous : “ Courage : ouvre ton cœur à mon amour. Tu sentiras la consolation de Dieu, qui te soutient ”.
Chers frères et sœurs, que pouvons-nous faire devant Dieu qui nous a servis jusqu’à éprouver la trahison et l’abandon ? Nous pouvons ne pas trahir celui pour qui nous avons été créés, ne pas abandonner ce qui compte. Nous sommes au monde pour l’aimer, lui et les autres. Le reste passe, cela demeure. Le drame que nous sommes en train de traverser nous pousse à prendre au sérieux ce qui est sérieux, et à ne pas nous perdre dans des choses de peu de valeur ; à redécouvrir que la vie ne sert à rien si on ne sert pas. Parce que la vie se mesure sur l’amour. Alors, en ces jours saints, à la maison, tenons-nous devant le Crucifié, mesure de l’amour de Dieu pour nous. Devant Dieu qui nous sert jusqu’à donner sa vie, demandons la grâce de vivre pour servir. Cherchons à contacter celui qui souffre, celui qui est seul et dans le besoin. Ne pensons pas seulement à ce qui nous manque, mais au bien que nous pouvons faire.
Voici mon serviteur que je soutiens. Le Père qui a soutenu Jésus dans sa Passion, nous encourage nous aussi dans le service. Certes, aimer, prier, pardonner, prendre soin des autres, en famille comme dans la société, peut coûter. Cela peut sembler un chemin de croix. Mais le chemin du service est le chemin vainqueur, qui nous a sauvés et qui nous sauve la vie. Je voudrais le dire spécialement aux jeunes, en cette Journée qui, depuis trente-cinq ans leur est consacrée. Chers amis, regardez les vrais héros, qui apparaissent ces jours-ci : ce ne sont pas ceux qui ont renommée, argent et succès, mais ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir les autres. Sentez-vous appelés à mettre en jeu votre vie. N’ayez pas peur de la dépenser pour Dieu et pour les autres, vous y gagnerez ! Parce que la vie est un don qui se reçoit en se donnant. Et parce que la joie la plus grande est de dire oui à l’amour, sans si et sans mais. Comme Jésus pour nous.
Lien permanent Catégories : Actualité, Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Solidarité, Spiritualité 0 commentaire -
Messe des Rameaux ce dimanche 5 mars célébrée par Mgr Delville à la Cathédrale Saint-Paul de Liège
Cette messe «sine populo», confinement prophylactique oblige, a été chantée en présence d’un nombre limité d’officiants : l’enregistrement video s’arrête malheureusement à la consécration. D’autres enregistrements sont prévus durant les offices de la semaine sainte.
JPSC
Lien permanent Catégories : Actualité, Au rythme de l'année liturgique, Belgique, Eglise, Foi, liturgie, Santé, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -
Le Docteur Xavier Dor, figure de proue du combat pour la vie, s'en est allé
Le docteur Dor a quitté ce monde (source : Contre-Info.com)
C’est un homme exceptionnel qui vient de nous quitter.
Âgé de 91 ans, Xavier Dor est mort ce samedi vers midi, victime du coronavirus (merci Macron…).
Ce véritable médecin – contrairement à d’autres qui ont renié le serment d’Hippocrate et donnent la mort sans scrupules – était spécialisé en embryologie, ayant exercé à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, enseigné à Paris VI et été chercheur en embryologie cardiaque à l’INSERM.
Il est connu pour avoir été pendant des décennies et jusqu’au bout un inlassable combattant du droit des bébés à naître.
Il organisa par exemple des centaines de rassemblements devant des « cliniques » avortoirs pour essayer de faire changer d’avis (parfois avec succès!) des femmes sur le point de commettre cette chose terrible et dont elles allaient souffrir le reste de leurs jours, ou alors simplement pour réciter le chapelet.
En effet, catholique convaincu, le docteur Dor croyait en la force de la prière et ne manquait pas, avec l’association SOS Tout Petits qu’il avait fondée, d’y recourir.
Il était infatigable (en dépit d’une quasi cécité depuis une quinzaine d’années) et très courageux, devant souvent faire face à des hordes d’« antifas » extrêmement haineux, violents et orduriers, ou bien aux procès…
A partir de 1986 et pendant près de 10 ans, il n’hésita pas à entrer dans les avortoirs pour essayer d’empêcher les tragédies qui s’y déroulaient.
Il fut, pour son respect de la vie et son amour des plus fragiles, persécuté par la justice républicaine (particulièrement à partir de la loi scélérate de « délit d’entrave à l’IVG » en 1993) et condamné 11 fois.

Tous ceux qui ont eu la chance de l’approcher n’ont pu qu’être frappés de sa gentillesse, de sa délicatesse, de sa jeunesse d’esprit (innocence et enthousiasme), de sa générosité pour la bonne cause et de sa joie, lui qui avait connu tant d’horreurs.
Ce saint homme laissera un grand vide.
Prions pour lui – ce sera une bonne façon de le remercier – afin qu’il soit vite au Paradis s’il n’y est pas déjà, et qu’il continue de là d’aider les bébés, leurs mères, et la France plus généralement.
PS : le docteur Dor avait écrit un livre à propos de l’avortement : le Crime contre Dieu.
PPS : ci-dessous une émission radio de 2017 à laquelle le Dr Dor avait été invité.
Lire aussi : https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2020/04/dr-xavier-dor-rip-un-hommage.html?
Lien permanent Catégories : Actualité, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, Foi, Politique, Société, Témoignages 2 commentaires -
Les célébrations du dimanche des Rameaux sur les ondes, à la TV et sur Internet
dim. 5 avr. 2020 - Rameaux - (source : EgliseInfo.be)10h00 - RameauxInternet: KTO (Télévision Catholique + Messe du pape + VaticaNews)1000 Bruxelles, beInternet : Internet et Médias (Direct et streaming)en direct de la grotte de Lourdes10h30 - Rameauxeglise: Saint-François-d'Assise1348 Louvain-la-Neuve, beParoisse : Paroisse Saint-François-d'Assisepage Facebook "Eglise Saint-François", à 10h30 précises11h00 - RameauxInternet: Emmanuel Play (Application + chaine YouTube de la Communauté de l'Emmanuel)1000 , beInternet : Internet et Médias (Direct et streaming)Sur l'application et sur YouTube11h00 - RameauxInternet: KTO (Télévision Catholique + Messe du pape + VaticaNews)1000 Bruxelles, beInternet : Internet et Médias (Direct et streaming)Messe du pape - Sur KTO, VaticaNews et YouTube11h00 - RameauxInternet: RTBF (Télévision - La Première - Cathobel)1000 Bruxelles, beInternet : Internet et Médias (Direct et streaming)En télé et internet.11h00 - RameauxInternet: RTBF (Télévision - La Première - Cathobel)1000 Bruxelles, beInternet : Internet et Médias (Direct et streaming)Depuis Nivelles, sur radio La Première11h00 - Rameaux - Radiocollégiale: Collégiale Sainte-Gertrude1400 Nivelles, beUnité pastorale : NivellesMesse radio - La Première11h00 - Rameauxeglise: Saint Jean-Baptiste1300 Wavre, beParoisse : Paroisse Saint Jean-BaptisteMesse internet en direct sur YouTube15h00 - Rameauxeglise: Marie-Médiatrice4800 Verviers, beUnité pastorale : Notre-Dame du Magnificat (Verviers-Sud)Messe internet sur la page youtube de l'abbé Thomas Sabbadini15h30 - ChapeletInternet: KTO (Télévision Catholique + Messe du pape + VaticaNews)1000 Bruxelles, beInternet : Internet et Médias (Direct et streaming)Chapelet médité depuis Lourdes18h00 - ChapeletInternet: Emmanuel Play (Application + chaine YouTube de la Communauté de l'Emmanuel)1000 , beInternet : Internet et Médias (Direct et streaming)18h30 - RameauxInternet: KTO (Télévision Catholique + Messe du pape + VaticaNews)1000 Bruxelles, beInternet : Internet et Médias (Direct et streaming)par Mgr Michel Aupetit, en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois20h30 - Veillée de prièreInternet: RCF (Radio Chrétienne Francophone - 1RCF)1300 Wavre, beInternet : Internet et Médias (Direct et streaming)Prière en direct de TaizéLien permanent Catégories : Actualité, Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, liturgie, Médias, Spiritualité 0 commentaire -
Carême et confinement; feuillet du Dimanche des Rameaux (5 avril)
Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
Homélie pour un Dimanche des Rameaux en confinement

DIMANCHE DES RAMEAUX Homélie du Très Révérend Père Dom Jean PATEAU Abbé de Notre-Dame de Fontgombault (Fontgombault, le 5 avril 2020)
Chers Frères et Sœurs, Mes très chers Fils,Voici que s’ouvre le chemin de la Semaine Sainte, une semaine douloureuse, à l’image des temps d’épidémie que nous traversons. Pour les cérémonies, les portes des églises, les portes des maisons aussi resteront fermées.Que le Seigneur vienne nous visiter comme il le fit pour ses disciples après sa Résurrection, « januis clausis – les portes fermées. »Lui se joue des portes fermées, si les portes des cœurs lui sont ouvertes. Loin des églises, ravivez votre liturgie familiale par la méditation des textes liturgiques si riches, par le chapelet, par la pratique d’une vraie charité entre vous.Les diocèses, les communautés mettent à vos dispositions bien des outils. Imitez les apôtres avant la Pentecôte : « Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. » (Act 1,14)Le pape Pie XII disait : « Une famille qui prie est une famille qui vit », et saint Jean-Paul II : « Une famille unie dans la prière, reste unie ».Dès ce matin, la Messe, et en particulier les lectures, nous plongent dans le mystère pascal : mort et résurrection du Seigneur. La foule hostile réclame la libération de Barabbas et obtient la crucifixion de celui qu’elle avait acclamé quelques jours plus tôt comme Fils de David, Roi d’Israël, le Béni venant au nom du Seigneur. Barabbas relâché manifeste, bien involontairement, l’effet de la rédemption accomplie par le Christ : par sa mort, le coupable est libéré. Mais la foule qui demande la libération de ce criminel se trompe d’interlocuteur.Ce n’est pas à Pilate, le gouverneur romain, qu’elle devrait s’adresser, mais à Dieu, source de tout pouvoir authentique. Pilate, en se lavant les mains, se fait, comme la foule, complice d’un geste en lui même inique, et qui cependant coopère au plan de Dieu. Au seuil de cette semaine, nous pouvons faire un examen de conscience, afin de reconnaître à la fois notre condition de créatures coupables, et la réalité de ce salut que le Seigneur nous a obtenu si souvent.Vivons-nous pour autant comme des êtres sauvés au prix de son Sang ? Ne sommes-nous pas responsables de ce que notre monde s’est détourné de Dieu ? Croyons-nous même avoir besoin d’un sauveur ?Saint Paul nous a recommandé d’avoir les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Au commencement de sa lettre, il avait encouragé ainsi les Philippiens : « Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. » (Ph 1, 6) Et il poursuivait : « Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. » (Ph 1,20-21)Le disciple n’est pas au-dessus de son maître. Le souvenir de la Pâque du Christ, de son passage de la mort à la vie, nous mène à notre propre pâque, ce passage qui doit être fait à la suite du Christ et avec son secours. Quelles dispositions devons-nous mettre en œuvre ? Nous les connaissons : amour, générosité, humilité, pardon, obéissance à Dieu, don de soi. Plus radicalement, si nous voulons que notre vie soit le Christ, c’est tout notre être qui doit se convertir, et pas seulement notre agir.Osons affronter cette question. Le Christ obéissant jusqu’à la mort, et la mort ignoble de la Croix, remet son âme au Père. Le Père lui donne le Nom au-dessus de tout nom. Mort et Résurrection du Christ, c’est tout le mystère pascal.Alors que nous mourrons au péché, la mort du Christ s’accomplit en nous. Alors que le Christ ressuscite, il nous ressuscite avec lui.En ces jours, prenons du temps, personnellement et en famille, avec le Crucifié. Demandons les uns pour les autres, pour nos familles, nos communautés, pour notre pays et pour le monde entier, par l’intercession de Marie au pied de la Croix, la grâce de vivre une semaine qui soit sainte non seulement par les événements qui s’y dérouleront, mais surtout par la conversion durable des cœurs et l’accueil de la grâce pascale. En ces jours sombres mais porteurs d’espérance, un monde vieilli s’en va. Que surgisse dans le Christ un monde renouvelé.Amen.Lien permanent Catégories : Actualité, Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -
Le dernier message de Don Cirillo : "Les moments difficiles arrivent ! Priez le rosaire"
De Gelsomino del Guercio sur aleteia.org (italien) :
Avant de mourir, Don Cirillo, les mains tournées vers le ciel et un message: "Nous nous reverrons au Ciel, priez le Rosaire"
30 mars 2020
Frappé par le coronavirus, le prêtre du "Centre Don Orione" de Bergame a passé les dernières heures de sa vie à encourager d'autres malades
Avant de mourir, il leva les mains au ciel avec exultation, comme s'il avait atteint le but. Un geste de courage, de détermination, qui vient d'une leçon de vie que Don Cirillo Longo, depuis quelque temps, a répété à tous ceux qui l'ont rencontré au "Centre Don Orione" de Bergame : "L'homme a deux mains, car pendant que l'une travaille, l'autre sert à faire glisser les grains de la couronne du chapelet."
"Nous sommes tous entre les mains de Dieu"
Le prêtre de 95 ans est décédé le 19 mars après avoir contracté le coronavirus. Mais son «slogan» résonne dans le cœur de ceux qui l'ont connu. Et dans les derniers jours de sa vie, il avait consolé ceux qui auraient dû le consoler en disant "n'ayez pas peur, car nous sommes tous entre les mains de Dieu".
Les miracles de Don Orione
Don Cirillo Longo, raconte Prima Bergamo (28 mars) est né à Saletto (Padoue) le 18 mars 1925: 78 ans de profession religieuse, 67 ans de sacerdoce. Il appartenait à la Province religieuse des Orionini "Mère de la Divine Providence". Il est entré dans la Congrégation le 23 octobre 1937 à Tortona (Alexandrie). Don Luigi Orione en personne, le saint fondateur de la Congrégation approuvée le 21 mars 1903, l'avait revêtu de sa "soutane" de prêtre.
Il a été le témoin des miracles du fondateur, quand pendant la Seconde Guerre mondiale, dans des moments désespérés de peur et de faim, une prière, récitée avec une foi ardente, avec un amour filial de tous les séminaristes, avait suffi pour voir venir une aide inattendue, une aide qui est venue du ciel, à travers les soldats.
L'épreuve
Son calvaire a commencé le 12 mars. Les huit jours suivants ont été remplis de prière et de souffrance: physique, mais surtout celle de ne pas pouvoir communiquer avec tout le monde, répondant aux messages de salutations venus du monde entier et de tous les continents: prêtres, religieuses, membres de la famille et de nombreuses personnes simples, familles, enfants, jeunes, employés de nombreuses structures qu'il a fondées et dirigées.
"Priez beaucoup, les moments difficiles arrivent"
Dans la nuit du 17 mars, lors d'un bref appel téléphonique, il a déclaré: "Nous nous reverrons là-bas, au ciel ... prions le chapelet ... saluez-moi tous". Dans un autre appel téléphonique, après une rémission miraculeuse en la fête de Saint Joseph, il a répété: "Priez beaucoup, les moments difficiles arrivent, priez le Rosaire".