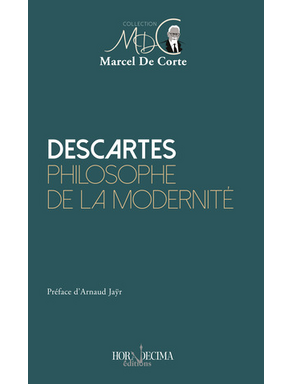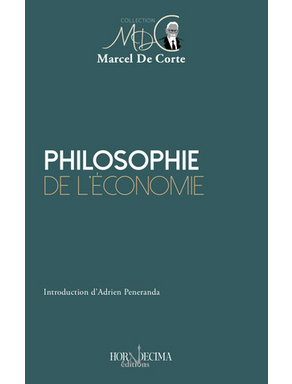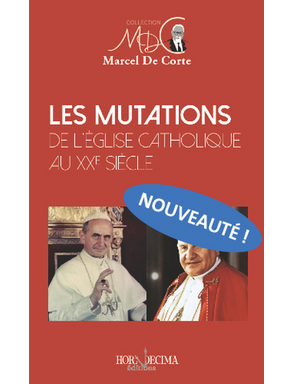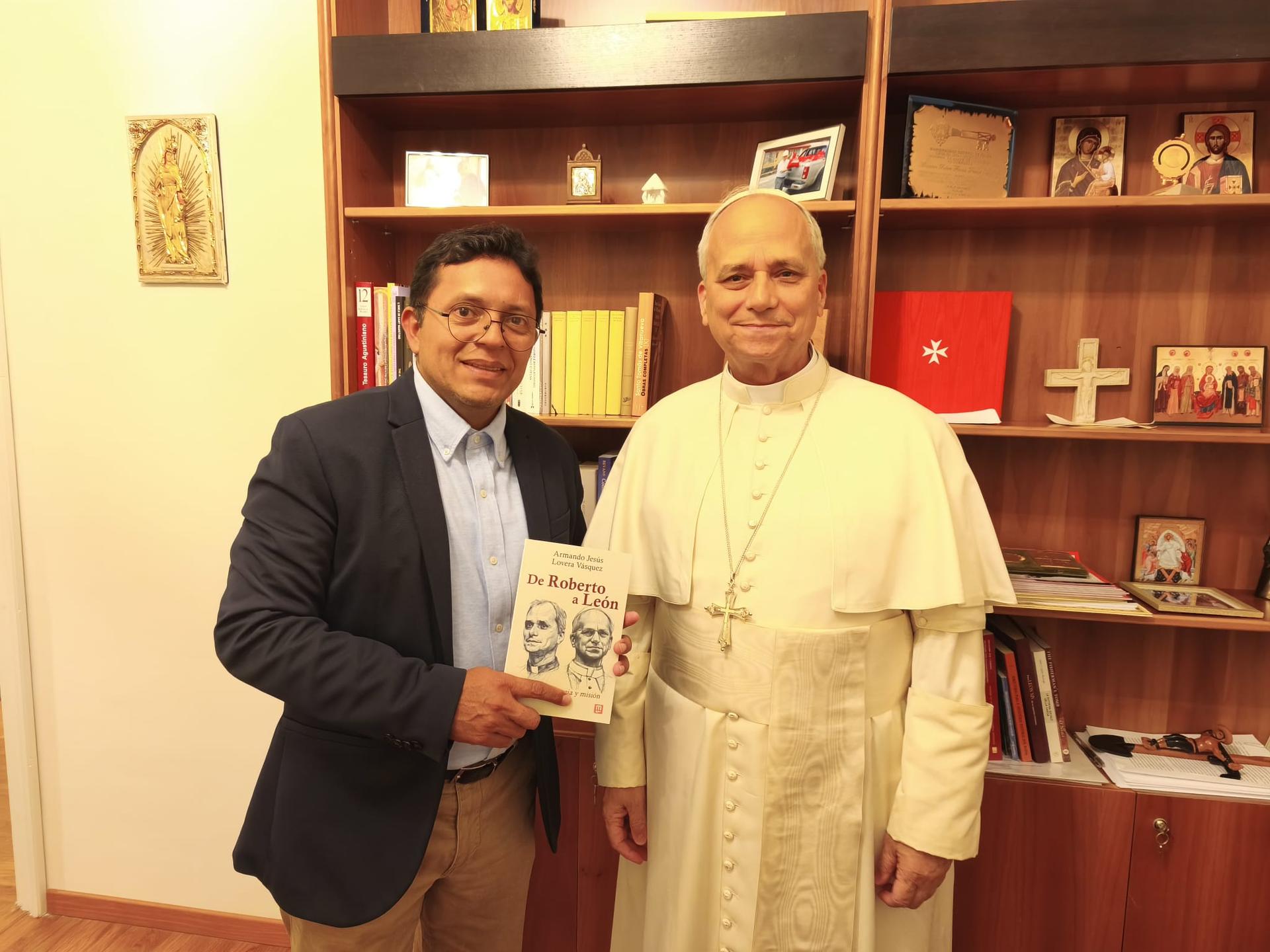N'en déplaise au cardinal Parolin qui considère qu'il s'agit d'un problème social et non religieux...
De Ngala Killian Chimtom sur le CWR :
Les dirigeants de l'Église nigériane saluent les conclusions confirmant le génocide des chrétiens
Les conclusions d’un nouveau rapport, couvrant la période de 2010 au 10 octobre 2025, révèlent une campagne de dévastation qui a coûté la vie à 185 000 personnes, dont 125 000 chrétiens et 60 000 musulmans non violents, dans cette nation africaine.
22 octobre 2025
Les dirigeants de l'Église au Nigeria se disent heureux de la conclusion à laquelle est parvenu un enquêteur américain selon laquelle il existe un plan systématique visant à effacer le christianisme dans ce pays africain.
Le 14 octobre, Mike Arnold a présenté ses conclusions sur une décennie de campagne de violence visant les chrétiens au Nigeria. L'ancien maire de Blanco City, au Texas, a déclaré qu'il recueillait ces informations depuis 2019.
Lisant une déclaration préparée intitulée « Déclaration sur la violence généralisée et les déplacements au Nigéria », Arnold a déclaré que « les villages sont systématiquement rasés, les églises rasées et des dizaines de milliers de personnes sont mortes ».
Il a rejeté l'affirmation selon laquelle la violence serait due à une lutte entre agriculteurs et éleveurs pour les ressources.
« Il s'agit de terreur systématique, et non de conflits de pâturage », a-t-il déclaré. « … l'expression « affrontements entre agriculteurs et éleveurs », dans bien des cas aujourd'hui, relève d'un double langage cynique. Elle instrumentalise des conflits fonciers historiques pour masquer une conquête djihadiste. Pendant des siècles, éleveurs et agriculteurs ont coexisté dans des conflits rares, rarement mortels. »
Citant l’article II de la Convention des Nations Unies sur le génocide, Arnold a affirmé que la situation au Nigéria répond au seuil juridique du génocide.
« La campagne de violence et de déplacement dans le nord et le centre du Nigeria constitue bel et bien un génocide planifié, actuel et durable, contre les communautés chrétiennes et autres minorités religieuses, sans aucun doute raisonnable. Continuer à le nier revient à se rendre complice de ces atrocités », a-t-il affirmé.
Il a déclaré que nier l’existence d’un génocide contre les chrétiens renforce la détermination des auteurs de ce crime à faire encore pire.
« Continuer à nier cela, c’est se rendre complice de ces atrocités. Je ne le dis pas avec colère, mais avec vérité et tristesse. »
« Je crois en l'harmonie entre chrétiens et musulmans. Je crois que les personnes de bien, toutes tribus, confessions et partis confondus, doivent s'opposer à ce fléau, mais il faut d'abord le nommer », a-t-il déclaré.
C’est un rapport qui n’a probablement pas plu aux autorités nigérianes qui l’ont invité.
Reno Omokri, ancien porte-parole présidentiel, a tenté de rejeter le rapport d'Arnold.
« Cette affirmation est fausse. Alors, si vous me demandez s'il y a un génocide au Nigeria, bien sûr que non. Cependant, si vous pensez que des représentants de l'État nigérian facilitent le terrorisme, mentionnez-les, nommez-les. Aidez-nous à les nommer », a déclaré Omokri.
Un rapport confirme les accusations de génocide
Les dirigeants de l’Église et diverses entités au Nigéria ont accueilli les conclusions d’Arnold comme une justification de ce qu’ils ont dénoncé pendant si longtemps.
« Il y a une joie particulière dans nos cœurs », a déclaré Emeka Umeagbalasi, directeur de l'ONG d'inspiration catholique et de la Société internationale pour les libertés civiles et l'État de droit, Intersociety.
Il insiste sur le fait que le gouvernement nigérian, qui a invité l'enquêteur américain, l'a fait dans l'intention de dissimuler les atrocités commises contre les chrétiens. Mais Arnold et son équipe avaient un autre plan.
« Ce que le gouvernement nigérian attendait de ces personnes n'a jamais été concrétisé. L'équipe a dit le contraire de ce que le gouvernement souhaitait », a-t-il déclaré à CWR.
Il a déclaré que lorsque Arnold a présenté ses conclusions lors de la conférence de presse, « toute la salle est tombée dans un silence de mort », car les responsables étaient déçus de voir la vérité documentée.
Umeagbalasi a déclaré à CWR que le rapport confirmait les conclusions antérieures d'Intersociety sur la persécution des chrétiens au Nigéria.
Dans son dernier rapport actualisé, l'ONG présente ce qu'Umeagbalasi qualifie de « statistiques profondément inquiétantes » illustrant l'ampleur de la violence au Nigeria. Les conclusions, qui couvrent la période de 2010 au 10 octobre 2025, révèlent une campagne de dévastation qui a fait 185 000 morts, dont 125 000 chrétiens et 60 000 musulmans non violents.
Le paysage religieux a également été ravagé : 19 100 églises ont été incendiées et 1 100 communautés chrétiennes entières ont été saisies et occupées par des forces djihadistes prétendument soutenues ou protégées par le gouvernement. Selon Umeagbalasi, ces violences ont alimenté une crise humanitaire, forçant environ 15 millions de personnes, principalement des chrétiens, à quitter leur foyer.
Le rapport met également en évidence un ciblage délibéré des chefs spirituels, avec 600 religieux enlevés et des dizaines d’autres tués ou disparus.
Umeagbalasi a averti que la terreur était loin d'être terminée, avec 40 millions de chrétiens du Nord menacés et des millions de chrétiens du Sud confrontés à des « menaces génocidaires ». Il a ajouté que le danger était amplifié par une force de sécurité devenue « radicalisée sur le plan ethno-religieux et déséquilibrée sur le plan laïc ».
Il a déclaré que si cette tendance n’est pas stoppée, « le christianisme pourrait disparaître du Nigeria dans les 50 prochaines années ».
Il a ajouté que le gouvernement a toujours cherché à occulter la question et, au lieu de présenter des données crédibles et contre-statistiques pour réfuter les allégations, il a choisi de manipuler le récit. Cette stratégie est vouée à l'échec en raison de son manque de fondement factuel, et, par conséquent, les tactiques du gouvernement ont dégénéré en chantage, insultes et dénégations persistantes.
Stan Chu Ilo, professeur de recherche en études africaines à l’Université DePaul, offre une perspective nuancée sur la situation actuelle au Nigéria.
Décrivant la scène politique nigériane comme « alambiquée », il affirme que les chrétiens sont également complices de leur propre perte, citant le fait que certains postes clés au sein du gouvernement sont en réalité occupés par des chrétiens.
« Ce gouvernement au niveau fédéral est composé à la fois de chrétiens et de musulmans, même si pour la première fois dans l'expérience politique démocratique du Nigeria, nous avons un président et un vice-président musulmans », a-t-il déclaré à CWR.
On pourrait simplifier le problème du Nigeria actuel en le qualifiant de « chrétiens contre musulmans », ou de génocide contre les chrétiens. Je n'aime pas formuler cet argument de cette façon. Les chrétiens sont-ils tués, pris pour cible ? Oui. Le gouvernement nigérian est-il complice de cela ? Oui. Mais quel gouvernement, quels agents des forces de l'ordre ou quelle branche du gouvernement tenez-vous pour responsable ? C'est donc une réalité très complexe.
Il a déclaré que l’architecture de la violence au Nigéria est liée au « gouvernement corrompu, insensible, irresponsable et destructeur que nous avons ».
Les chrétiens font également partie de ce gouvernement. Ils sont ministres et législateurs. La responsabilité incombe donc, à mon avis, à la classe politique nigériane. Je pense que les élites politiques et religieuses du Nigeria sont largement responsables de l'effondrement de la nation.
Le Nigeria est un État en faillite. Aujourd'hui, nous n'avons plus de gouvernement. Nous avons affaire à des individus qui ont en quelque sorte accaparé les ressources de ce pays et hypothéqué notre avenir en tant que peuple. Et dans cette compétition d'élites impitoyable, insensée et inconsciente, ils se moquent de la vie des gens. Et les chrétiens, malheureusement, en paient le prix fort.
Le rapport de Mike Arnold confirme toutefois les précédents rapports d'Intersociety, qui reliaient la persécution des chrétiens à une tentative bien planifiée de transformer le Nigeria en califat. L'implication du gouvernement est apparue au grand jour avec l'accession au pouvoir (pour la deuxième fois) de l'ancien président Muhamadou Buhari en 2015.
Selon Umeagbalasi, Buhari a placé ses compatriotes peuls à des postes clés au sein du gouvernement et de l'armée, et depuis, les massacres de chrétiens se sont intensifiés, le gouvernement détournant toujours le regard.
Ce que le Nigéria doit faire pour endiguer les massacres
Face aux preuves croissantes de persécution des chrétiens au Nigéria, le groupe de défense des droits de l’homme Intersociety a émis une demande en 21 points demandant au gouvernement de mettre fin à ce qu’il qualifie de « religicide ».
Les revendications portent sur la restauration des fondements laïcs du Nigéria par l'application de la Constitution de 1999, qui garantit la liberté religieuse et interdit toute religion d'État. Le groupe appelle à la fin de toute forme de djihadisme d'État et au retour à une gouvernance fondée sur des principes laïcs.
L'un des axes majeurs des propositions est la refonte radicale des forces de sécurité du pays. Intersociety exige la fin de ce qu'elle qualifie de « militarisme grossier, brutal et ethno-religieux », citant le cas de l'État d'Imo, où tous les postes clés de sécurité sont occupés par des officiers supérieurs musulmans du Nord, malgré une population chrétienne à 95 %. Le groupe exige également que les agences de sécurité rendent des comptes sur environ 5 000 habitants de l'Est, principalement des Igbos, qui auraient été secrètement enlevés et emprisonnés dans le Nord.
En outre, les propositions appellent à une action décisive contre les groupes djihadistes, en désarmant les éléments nationaux et étrangers et en demandant des comptes à leurs dirigeants. Sur le plan politique, Intersociety exige la fin de la « présidence musulmane », un nouveau recensement national crédible et une conférence nationale pour aborder les profondes divisions ethniques et religieuses du pays.
« Le Nigeria doit revenir à la laïcité », a déclaré Umeagbalasi à CWR. « Le Nigeria doit être gouverné de manière pluraliste, multiculturelle et multireligieuse. Les musulmans doivent être autorisés à pratiquer l'islam de manière pacifique et non violente. Les chrétiens doivent être autorisés à pratiquer le christianisme de manière pacifique et non violente. Il en va de même pour les adeptes de la religion traditionnelle, du judaïsme, etc. », a-t-il expliqué.
Le père Ilo a ajouté sa voix aux propositions de solution, affirmant que pour que les chrétiens nigérians puissent lutter contre la persécution, ils doivent forger un front unifié et développer ce qu’il appelle une « ecclésiologie de protestation, de résistance, d’interruption ou de perturbation qui soit prophétique, courageuse et audacieuse ».
Il a critiqué de nombreux prédicateurs pour avoir donné la priorité aux « dons monétaires » obtenus principalement auprès des puissants.
Il a déclaré que cela crée une « relation client-patron » avec le gouvernement. « Je pense que nos propres responsables religieux nigérians doivent commencer à s'exprimer davantage, plutôt que d'exploiter la situation à leur avantage personnel », a-t-il déclaré à CWR.
Ngala Killian Chimtom est un journaliste camerounais fort de onze ans d'expérience professionnelle. Il travaille actuellement comme reporter et présentateur de nouvelles pour la Radio Télévision Camerounaise (radio et télévision). Chimtom est également pigiste pour plusieurs organes de presse, dont IPS, Ooskanews, Free Speech Radio News, Christian Science Monitor, CAJNews Africa, CAJNews, CNN.com et Dpa.