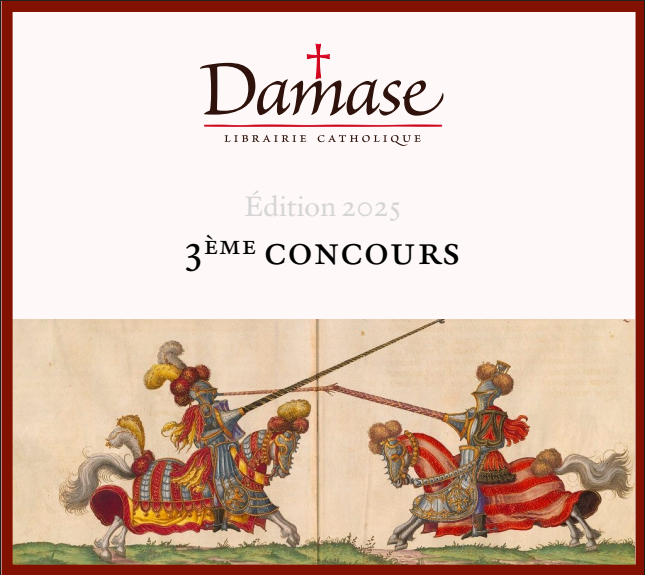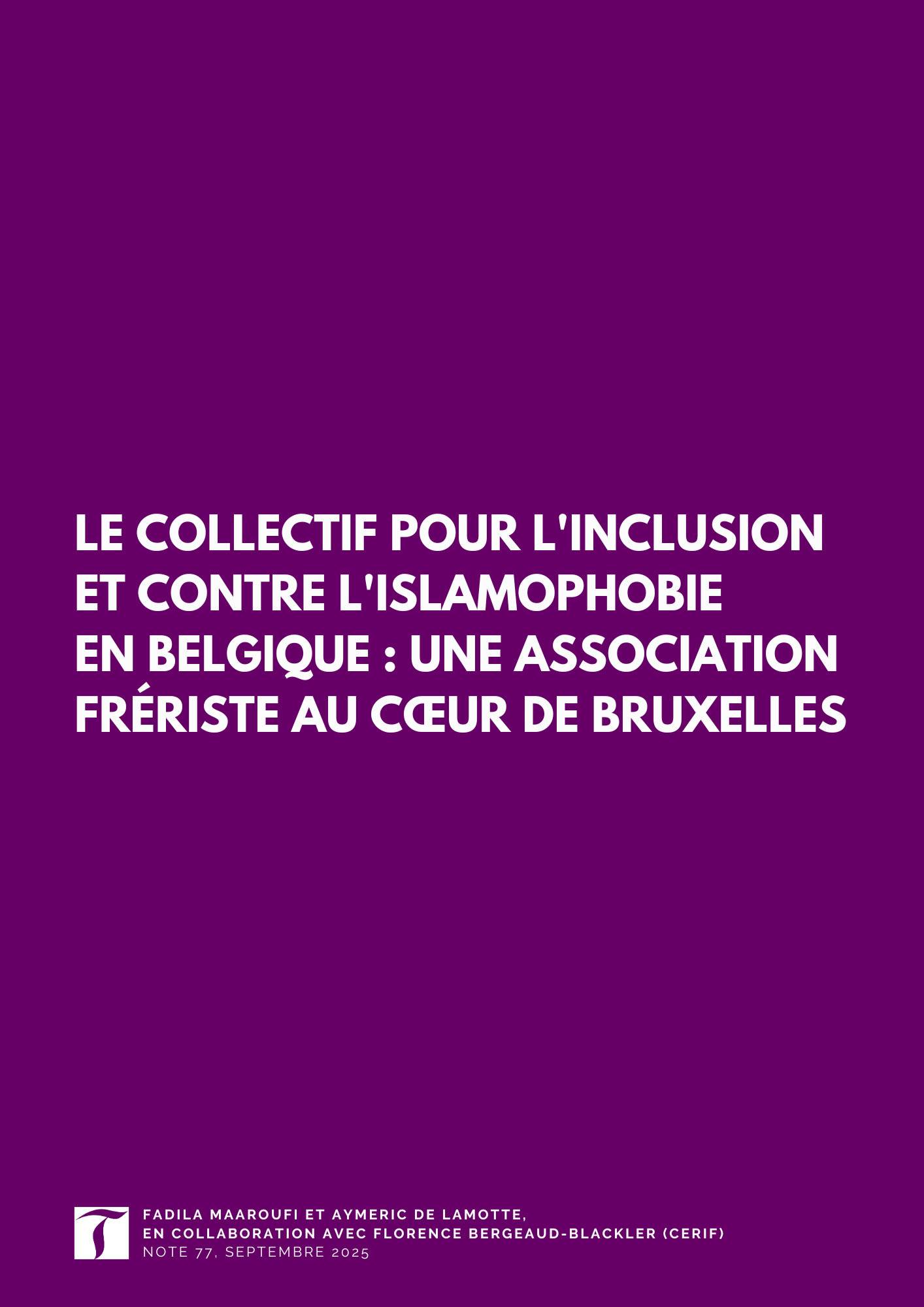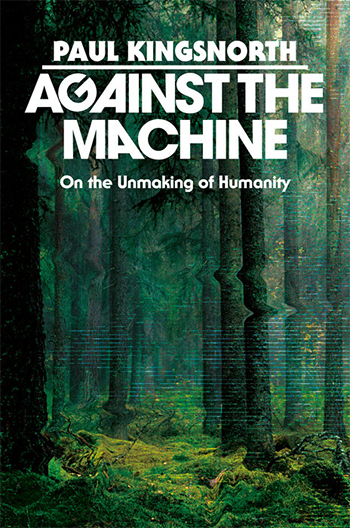Mon entretien avec Kingsnorth, réalisé il y a deux ans, est disponible ici. L'étendue de son œuvre est impressionnante. Son roman « Awake », paru en 2015 et écrit dans une langue de l'ombre mêlant anglais ancien et anglais moderne, est un récit formidable de la résistance anglo-saxonne, païenne et vouée à l'échec, face à l'invasion normande de l'Angleterre au XIe siècle . Son ouvrage « Abbey of Misrule Substack » est une mine d'or de textes de qualité, allant de réflexions sereines sur la nature et les saints à une critique culturelle urgente. Kingsnorth possède le don rare de transmettre un contenu profond dans un style élégant et d'une clarté simple.
Son histoire personnelle renforce l'attrait de son œuvre. Ancien militant écologiste sans convictions religieuses, il a migré vers la Wicca et le bouddhisme à l'âge adulte, avant de se convertir au christianisme en 2020. Il a été baptisé dans l'Église orthodoxe en 2021. Sa foi imprègne désormais presque tout ce qu'il écrit.
Et cela nous ramène à son dernier livre.
Contre la Machine s'appuie sur deux années d' essais préliminaires visant à peaufiner les idées de l'auteur. En bref, il s'agit d'une critique pénétrante de la culture faustienne, accro aux machines et à la technologie, des illusions que nous avons tissées autour de nous depuis 300 ans, un cocon d'artifices rutilants qui menace désormais d'étouffer et de supplanter l'humanité de ses créateurs.
Comme le note Kingsnorth dans ses premières pages, « il n'y a jamais eu d'organisation unitaire de la culture occidentale en dehors de l'Église chrétienne » – un cadre religieux qui donnait un sens à la vie quotidienne et constituait un fondement de cohésion sociale. « Derrière le modèle en constante évolution de la culture occidentale », écrit-il, « il y avait une foi vivante qui donnait à l'Europe un certain sentiment de continuité spirituelle, malgré tous les conflits, les divisions et les schismes sociaux qui ont marqué son histoire. »
Ce jour est désormais passé. Et il ajoute que
Lorsqu'une culture bâtie autour d'un ordre aussi sacré disparaît, des bouleversements s'ensuivent à tous les niveaux de la société, du politique jusqu'au niveau spirituel. La notion même de vie individuelle est bouleversée. La structure familiale, le sens du travail, les attitudes morales, l'existence même de la morale, les notions de bien et de mal, les mœurs sexuelles, les perspectives sur tout, de l'argent au travail, en passant par la nature, la parenté, la responsabilité et le devoir : tout est à prendre.
Aujourd'hui, comme on pouvait s'y attendre, alors que le christianisme recule en Occident, « nous [les modernes] – du moins si nous sommes parmi les plus chanceux – avons à notre disposition tous les gadgets, sites web, boutiques et vacances exotiques du monde », mais il nous manque les deux choses dont nous avons le plus besoin : un sens et des racines. Par conséquent, nous sommes à la dérive dans une époque que l'auteur présente comme « Le Grand Déstabilisation ». C'est le fruit de nos appétits et de nos vanités à courte vue, incarnés de façon éclatante par nos élites.
Kingsnorth est loin d'être le premier écrivain à décrire notre situation actuelle. Il n'est pas non plus le premier à utiliser la Machine comme métaphore des troubles spirituels et des menaces technologiques croissantes qui pèsent sur notre humanité. EM Forster a écrit sa nouvelle prophétique, « La Machine s'arrête », il y a près de 120 ans. Mais Kingsnorth apporte à son récit un mélange unique de passion, d'expérience, de richesse des sources et de logique persuasive.
L'auteur emprunte une phrase au théoricien social américain Craig Calhoun pour suggérer son propre esprit directeur : une sorte de « radicalisme réactionnaire ». Dans l'approche de Kingsnorth, il ne s'agit pas d'une idéologie politique. Elle opère en dehors des conflits habituels gauche-droite. Elle est « radicale » au sens premier du terme : elle s'attaque aux racines ; en l'occurrence, aux racines de ce que signifie être humain et de ce dont nous avons besoin.
Il s'agit d'une « tentative active de création, de défense ou de restauration d'une économie morale fondée sur les quatre P ». Ces quatre éléments incluent, premièrement, le passé : l'origine d'une culture, son histoire et ses ancêtres. Deuxièmement, le peuple, qui définit une culture : le sentiment communautaire d'être un « peuple » distinct. Troisièmement, le lieu, où se situe une culture, son sentiment d'appartenance, la nature dans sa beauté locale et ses manifestations particulières. Quatrièmement, et enfin, la prière, où une culture se dirige, sa tradition religieuse et sa destinée, sa compréhension de Dieu ou des dieux.
La culture machiniste annihile tous ces éléments d'une réalité saine, à échelle humaine, pour en faire une homogénéité mondialisée et consumériste. Ce faisant, elle assure l'abondance matérielle tout en aspirant l'âme de la Création. Kingsnorth ne prétend pas que la technologie soit intrinsèquement mauvaise. Au contraire, ses nombreux avantages sont évidents, à commencer par l'ordinateur qu'il utilise pour écrire. Mais lorsque nous laissons cette technologie devenir une forme d'idolâtrie – comme c'est le cas actuellement dans le monde postmoderne « développé » – l'idole dévore ses fidèles.
Il m'est impossible de choisir un chapitre préféré du texte. Trop nombreux sont ceux qui sont trop bons : Mille Mozart, Want Is the Acid, Come the Black Ships, You Are Harvest, Kill All the Heroes, The Abolition of Man (and Woman), What Progress Wants, et d'autres. Mais le dernier chapitre, The Raindance, est peut-être le plus important, car il offre une voie à suivre ; une voie difficile, mais qui, dans les temps apparemment sombres, fonctionne invariablement :
J'en suis arrivé au bout, et voici ce que je pense : l'ère de la Machine n'est finalement pas désespérée. En réalité, c'est l'époque pour laquelle nous sommes nés. Impossible de la quitter, il nous faut donc l'habiter pleinement. Il nous faut la comprendre, la défier, y résister, la subvertir, la traverser vers quelque chose de meilleur. Si nous pouvons la voir, nous avons le devoir de la dire à ceux qui ne la voient pas encore, tout en luttant pour rester humains. Les gens, les lieux, la prière, le passé. La communauté humaine, les racines dans la nature, le lien à Dieu, les souvenirs transmis de génération en génération. Voilà les choses éternelles.
En fin de compte, nous ne sommes pas impuissants. Aucun chrétien ne l'est jamais. La seule révolution qui compte est celle que nous menons dans notre cœur ; le choix de connaître, de vivre et d'agir réellement selon la foi que nous prétendons croire, quel qu'en soit le prix.
Quand cela se produit, le monde commence à changer. Dieu, en son temps, s'occupe du reste.
Contre la machine : sur la destruction de l'humanité
par Paul Kingsnorth
Penguin Random House, 2025
Relié, 368 pages