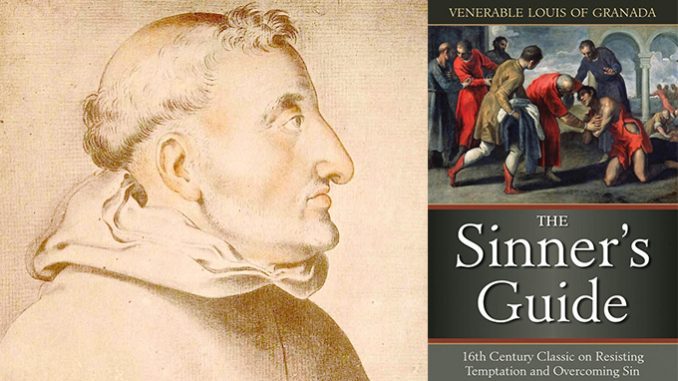Lorsqu'un journaliste demanda au romancier américain Walker Percy pourquoi il s'était converti au catholicisme, il répondit, avec son franc-parler légendaire : « Que faire d'autre ? » Son intelligence et son esprit analytique l'empêchaient de se montrer désinvolte. Il savait que les autres religions et philosophies, même si elles pouvaient receler des éléments de vérité et de sagesse, ne pouvaient satisfaire la soif humaine d'une vision globale qui embrasse toutes les exigences et les aléas de l'existence terrestre, et qu'elles contenaient souvent des erreurs et les germes de comportements déviants. Sans compter que certaines étaient, par nature, farouchement anti-catholiques.
Dans son dernier ouvrage, « Monstres modernes : Les idéologues politiques et leur guerre contre l’Église catholique », George Marlin met en lumière les aspects les plus obscurs de l’anticatholicisme qui ont imprégné la pensée de cinq siècles de religieux, philosophes, militants et hommes politiques influents. Comme le titre l’indique, ce livre ne vise pas à promouvoir le dialogue œcuménique ni à jeter des ponts entre les camps opposés. Il s’agit d’une analyse clinique des maux du monde moderne, de leurs causes et, implicitement, des solutions nécessaires à leur guérison.
S'appuyant sur une abondance de citations de sources primaires et secondaires – qui, à elles seules, justifient la lecture de cet ouvrage –, Marlin brosse des portraits saisissants de plus d'une douzaine de penseurs éminents dont les idées et l'anticatholicisme virulent ont façonné notre culture, le plus souvent à notre détriment. Qu'il écrive sur Martin Luther ou Machiavel, ou, plus près de notre époque, sur les nazis, les fascistes et les communistes, on retrouve à maintes reprises illustrés les propos du pape Pie XI dans son encyclique de 1937, Mit brennender Sorge :
Quiconque exalte la race, le peuple, l'État, une forme particulière d'État, les dépositaires du pouvoir ou toute autre valeur fondamentale de la communauté humaine – aussi nécessaire et honorable que soit leur fonction dans les affaires du monde – quiconque les élève au-dessus de leur valeur normale et les divinise jusqu'à un niveau idolâtre déforme et pervertit un ordre du monde planifié et créé par Dieu : il est loin de la vraie foi en Dieu et des conceptions de la vie que cette foi soutient.
L'ouvrage documente également l'assurance quasi mégalomaniaque des propagateurs de ces idées idolâtres, persuadés que leur mise en œuvre mènerait à un monde bien supérieur à celui que nous connaissons, voire à un paradis terrestre. En bref, la plupart des individus décrits par Marlin se révèlent être des utopistes qui, face à l'opposition à leur vision, se muent en totalitaires déterminés à anéantir tout ce qui entrave la réalisation de leur société idéale.
Cela explique leur hostilité invariable envers l'Église catholique, toujours prêts à combattre la tendance des idéologues à réduire l'individu à un simple moyen ou à un rouage de la machine et, avec un réalisme parfait, à affirmer également qu'aucun individu ni groupe n'est capable de créer le paradis dans ce monde déchu.
Du début à la fin, Marlin se heurte à ceux qui, absolument certains de leur vision d'un monde parfait, ne tolèrent aucune opposition à la mise en œuvre de leurs plans. Comment le pourraient-ils ? Ils se sont arrogé le rôle de Dieu, mais sans sa miséricorde ni son amour. Quiconque s'oppose à eux doit être éliminé par tous les moyens. Leur arrogance est stupéfiante.

Martin Luther, qui a compris la Bible comme personne auparavant.
Machiavel, le premier à avoir perçu la véritable nature de la politique.
Thomas Hobbes, qui souhaitait remplacer l'Église catholique par une Église du Commonwealth fondée sur la science.
Les idéologues des Lumières, qui avaient perçu la vérité derrière tout ce qui avait précédé, ont jeté les bases de la Terreur de la Révolution française.
Jean-Jacques Rousseau, qui affirmait la bonté naturelle de l'homme et le mal inhérent à la civilisation.
Les libéraux du XIXe siècle, qui pensaient que l'homme était perfectible par des moyens scientifiques et purement rationnels.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, qui pensait avoir découvert le secret pour déchiffrer le code de l'histoire.
Auguste Comte, qui prétendait fonder une nouvelle Église de l'Humanité.
Karl Marx, qui a combiné la dialectique de Hegel avec le matérialisme de Comte, a inspiré la montée du communisme athée et le massacre de millions de personnes.
Les fascistes européens, qui vénéraient l'État et s'étaient eux-mêmes confortablement installés à sa tête.
Hitler et les nazis, qui vénéraient leur sang et leur race, considéraient tous les autres comme des sous-hommes et, par conséquent, comme des êtres jetables.
Les révolutionnaires de la justice sociale du XXe siècle, qui nous ont apporté la révolution sexuelle, la théorie critique de la race et la théorie critique du genre.
Tous infectés par un égocentrisme titanesque, sûrs de leur propre rectitude, intolérants à toute opposition ; tous parfaitement à l'aise avec l'élimination, d'une manière ou d'une autre, de ceux qui s'opposent à eux, leur fin grandiose justifiant les moyens les plus abominables.
Le livre de George Marlin n'est pas une lecture réjouissante. Les spécialistes de l'un ou l'autre de ses sujets pourraient contester certaines de ses caractérisations et conclusions. Cependant, son thème central, l'hostilité manifeste envers le catholicisme chez ceux dont il examine la vie et la pensée, est difficilement réfutable et devrait, à tout le moins, ouvrir un débat important.
Hélas, les woke et autres idéologues contemporains semblent peu intéressés par une telle discussion. Ils sont comme la reine de Blanche-Neige , malheureux et remplis de haine envers quiconque ou quoi que ce soit qui oserait suggérer qu'ils ne sont pas les plus beaux de tous. Tant pis pour eux. Tant pis pour notre société.
Je dirais du livre de Marlin : « Lisez-le et pleurez », mais je ne veux décourager personne de le lire. Permettez-moi donc de terminer sur une note d'espoir en citant, comme le fait Marlin, le grand historien catholique Christopher Dawson :
Inévitablement, au cours de l'histoire, il arrive des moments où l'énergie spirituelle [de l'Église] est temporairement affaiblie ou obscurcie… Mais vient toujours un moment où elle renouvelle ses forces et met de nouveau son énergie divine inhérente au service de la conversion des nouveaux peuples et de la transformation des anciennes cultures.
Puisse le livre de George Marlin contribuer à l'avènement prochain de ce temps.